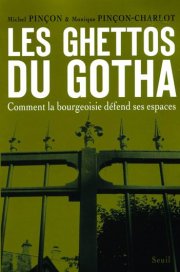Séparatisme social: un écran de fumée ?

Mieux vaut gérer des groupes plutôt qu’un seul. Dans les quartiers, cette méthode a un nom : le séparatisme social. Comment les acteurs de terrain ont-il favorisé ou non une forme de fracture dans les cités? Début de réponse…
Diviser pour mieux régner. Et si c’était la règle dans les quartiers? Pour Saïd Bouamama, sociologue, la théorie est tout sauf grotesque. «Dans les milieux populaires, il existe un clivage pour empêcher le développement d’une conscience commune.» On appelle cela le séparatisme social. Et le concept se traduit, selon lui, à travers «la construction idéologique, politique et matérielle de consciences séparées». Si le séparatisme social existe théoriquement dans les quartiers, est-il réel dans la pratique? «Sans aucun doute !», affirme Wajdi, éducateur à Garges-lès Gonesse (Val d’Oise), membre fondateur d’Emergence, une association de quartier très active. «L’un des premiers symptômes du séparatisme social dans les cités renvoie aux rapports filles-garçons», analyse t-il. «Depuis les années 80, la plupart des municipalités ont tourné leurs actions vers les garçons: vacances et sorties entre mecs…»
Filles vs garçons
Une stratégie politique peu assumée. «On envoie les garçons au ski pour éviter qu’ils mettent le bordel dans le quartier», ajoute t-il. La paix sociale en créant des groupes. « En ignorant les filles, surtout», explique t-il. Un constat appuyé par Leïla, 34 ans, originaire d’une cité du Val d’Oise. «A la fin des années 80, la mairie a ouvert un lieu d’accueil dans le centre culturel du quartier.» Exclusivement fréquenté par les jeunes garçons. «Si la mairie ne l’a jamais avoué, il est évident avec le recul que c’était un moyen de ramener les jeunes mâles dans son giron», suggère t-elle. Soutenir pour mieux contrôler, en d’autres termes. « D’ailleurs, le lieu est rapidement devenu un territoire exclusivement masculin sans que les élus n’y voient de problème. Je n’y ai jamais vu à cette époque d’activités susceptibles d’intéresser un public féminin…», regrette Leïla. Un exemple de fracture…entre les genres entretenue par les pouvoirs publics. Bouamama dresse lui un constat sans appel. «Cette attitude politique reflète des images mentales sexistes et/ou coloniales.» Et le sociologue de poursuivre, « les femmes sont plus raisonnables, plus intégrées et moins revendicatrices.» Un imaginaire bien ancré mais pas vraiment l’objet d’attention médiatique.
La décennie 2000 et NPNS
C’est à partir des années 2000 que le tournant s’opère. La question des filles dans les quartiers populaires s’invite dans le débat public au sens large. Avec un discours en toile de fond. « L’oppression dont elles sont victimes.» Les accusés ? «Les frères, les pères, les époux…», répond Saïd Bouamama. Symbole de leur libération: l’association Ni Putes Ni Soumises, fondée par Fadela Amara en 2003 suite à l’immolation de Sohane Benziane, une jeune fille de la cité Balzac à Vitry-sur-Seine (Val de Marne). Parmi ses soutiens, Mercédès Erras, présidente de BETC Euro RSCG, qui ne tarit pas d’éloge à propos du mouvement. « Il y a un problème entre les femmes et les hommes dans notre société. Mais c’est plus lourd dans les quartiers», relève t-elle. Une situation aggravée par «la problématique de l’intégration et la lecture de l’Islam parfois biaisée dans les cités», enchérit, celle qui préside également le conseil d’administration de la Cité nationale de l’Histoire de l’immigration. Et pour Mercédès Erra, «les leaders de NPNS ont posé les vrais problèmes à travers un lobbying courageux.» Preuve de leur crédibilité, selon elle, «le statut consultatif dont l’association jouit auprès de l’ONU.» Un propos que nuance Assia Benziane, 21 ans, élue à la municipalité de Fontenay-sous-Bois (Val de Marne). «J’habite une cité, le Bois Cadet. De ma propre expérience, je pense que l’on a créé la division hommes/femmes dans les quartiers à travers les médias.» Cousine de Sohane Benziane, Assia pose un regard sans concession sur l’épisode « fondateur » de NPNS. «Je ne nie pas les problèmes entre les filles et les garçons. Pour autant, l’affaire Sohane a été récupérée...» Pas étonnant. Car «le séparatisme social est un bon fond de commerce électoral.» C’est l’avis de Saïd Bouamama. « Une vision du monde qui permet avant tout de faire l’impasse sur les vrais problèmes rappelant la fonction première du séparatisme social : créer des débats écran pour masquer des enjeux et des problèmes réels.» Car si ces dernières années, le rapport hommes/femmes dans les cités est apparu comme la pierre angulaire du séparatisme, la question sociale reste le symptôme majeur du phénomène.
Nourrir la fracture sociale
Trente ans de politique de la ville auraient pourtant dû empêcher le séparatisme social. Or, c’est tout l’inverse qui s’est produit. Saïd Bouamama va même plus loin. «Les dispositifs de la politique de la ville sont même coproducteurs de séparatisme social», juge t-il. En cause, «leur incapacité à faire tomber les frontières dans lesquelles les habitants sont enfermés à travers les discriminations, la stigmatisation ou l’immobilité résidentielle ascendante.» Revalorisation des quartiers, actions destinées aux jeunes, promotion de l’égalité des chances, autant d’expressions qui sonnent plutôt creux aujourd’hui. La situation va même de mal en pis. Selon le dernier rapport de l’Observatoire des zones urbaines sensibles (Onzus), un tiers de habitants des quartiers vit sous le seuil de pauvreté (1). «D’autant que le silence des politiques de la ville sur des thèmes comme la lutte contre les discriminations ou le centrage sur la seule rénovation urbaine renforce ces barrières», remarque Bouamama. Comment favoriser dans ces cas là une conscience commune dans les quartiers si la fracture sociale se creuse? Ancienne militante de NPNS, aujourd’hui sympathisante de République solidaire, le mouvement de Dominique de Villepin, Bouchera Azzouz partage ce point de vue. «On assiste à une racialisation des rapports sociaux dans les quartiers. Or la question est avant tout sociale!», lance t-elle. En novembre dernier, elle a inauguré à l’Assemblée nationale, « République allant droit !», un collectif engagé dans la lutte contre les inégalités sociales. Un des cœurs du problème. Eric Maurin, sociologue et auteur du « Ghetto français, enquête sur le séparatisme social (2)» revient sur la structure de la société française. Selon lui, chaque groupe social se protège du groupe inférieur à travers des stratégies d’évitement. Peur de l’autre et ignorance culturelle en somme? Pas vraiment, la lecture de l’ouvrage balaie ces poncifs. En réalité, ce cloisonnement repose sur de vraies inégalités sociales : chômage, discriminations, échec scolaire…Une théorie qui va à l’encontre des analyses à la mode et largement admises quand on parle des quartiers. «Mais si cette logique de séparatisme atteint pour l’instant ses objectifs, selon Bouamama, en maints endroits elle se fissure.» Fort est à parier que «les discours sur la diversité ne permettront plus de cacher ces assignations à des places inégalitaires», souffle t-il. Mais comme l’adage le dit : le temps a horreur de ce qui se fait sans lui…
(1) Rapport annuel de l’Observatoire des zones urbaines sensibles, décembre 2009
(2) Le ghetto français, enquête sur le séparatisme social, Eric Maurin, La République des idées, Seuil, 2004
Nadia Henni/ RU