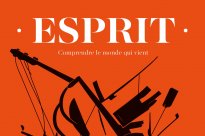« Jusqu’ici tout va bien », archéologie contemporaine de la haine
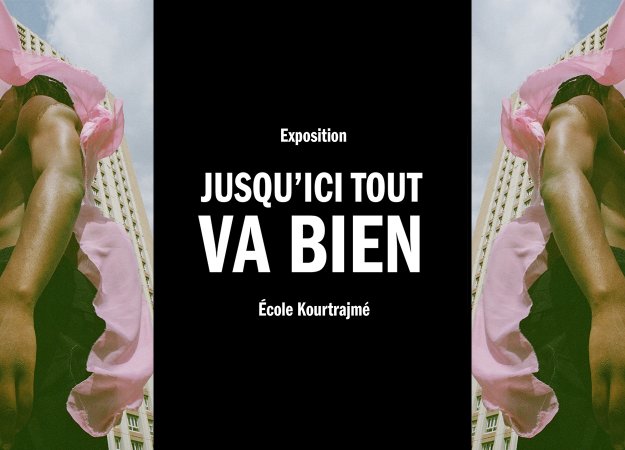
Depuis le 29 août, le Palais de Tokyo accueille une exposition capsule qui explore la filiation
entre La Haine et Les Misérables (le film). Les artistes - une trentaine d’étudiants de l’école
Kourtrajmé - proposent des œuvres plastiques et cinématographiques, sur lesquelles ils
travaillent depuis début juin sous la direction artistique de Ladj Ly, JR et Mathieu Kassovitz.
Les installations s’attaquent au regard médiatique et politique, rendent hommage aux
victimes de violence policières, dénoncent un passé colonial trop peu documenté, l’absence des femmes et l’homophobie.
En 1995, La Haine arrivait sur nos écrans, en noir et blanc. Une réponse du réalisateur
Mathieu Kassovitz et des acteurs Vincent Cassel, Hubert Koundé et Saïd Taghmaoui, aux
violences policières et sociales, mais aussi une dénonciation de la stigmatisation
grandissante des banlieues. Presque 25 ans après, Ladj Ly revient à la charge avec Les
Misérables, en couleur cette fois, face à une époque de « capitalisme carcéral ». 25 ans, le
temps de laisser la place à une nouvelle génération qui questionne la haine et son évolution.
Qu’est-ce qui vous fout la haine ?
C’est la question qu’a posée l’artiste Bastienne Rondot à une vingtaine de jeunes de son
entourage. Son idée est d’aborder l’émotion, d’un point de vue très personnel. Qu’est-ce qui
génère un sentiment aussi violent chez une personne ? Une situation en particulier ? Quel moment de la vie touche à l’intime et génère la haine ?
« Mon petit frère s’est fait tirer dessus », « ma mère a un cancer du cerveau parce qu’elle a pris un médicament qui n’a pas été testé sur les femmes ».
Placer ces personnes et leur histoire dans des télés, « c’est une réappropriation du discours
médiatique ultra formaté qui nous impose un angle, un prisme et qui n’écoute
pas les gens en réalité. Qui nous fait être des robots ».
Sa seconde installation - une cage dans lesquelles sont diffusées ses images filmées
pendant des émeutes - s’attaque à la sensation de haine dans le corps, le ressenti physique.
« J’ai essayé de recréer l’espèce d’oppression, de cage que t’as en toi quand t’as la haine.
L’expression avoir la haine en fait, cette espèce de montée où t’as envie de tout niquer, que
tu sois la meilleure ou la pire des personnes. Quand t’as cette espèce d’injustice face à toi et
que t’es emprisonné par la haine. On ne naît pas avec la haine, on nous la met. L’idée, c’est de montrer où mène la haine ».
Redonner vie aux victimes
De son côté, Aristide Barraud fait la démarche de rendre hommage aux victimes de la haine.
Pour cela, il passe par la fiction, en retraçant la vie imaginaire d’Abdel, un personnage de La
haine, qui tombe dans le coma suite à la tentative d’assassinat commise par un inspecteur
du commissariat. « Les victimes de bavures policières, c’est toujours un nom, un visage. Une
photo - toujours la même. C’est le cas dans le film, qui commence avec les émeutes et la
mise en garde à vue d’Abdel. Ensuite, on le voit trois fois et on a cinq petits indices dans le film. Je les ai utilisés pour tisser une vie imaginaire, pour casser cette déshumanisation
du nom et de la photo. Là, je voulais rentrer dans le concret, dans le quotidien, dans des
émotions, dans des amitiés, dans des petits choses qui font nos vies et qu’on oublie
souvent avec ce côté désincarné de la victime de bavures policières ».
Après avoir revu le film de nombreuses fois ces derniers mois, il l’estime « ultra
contemporain », dans une période où les mouvements sociaux s’accélèrent et où la colère se
légitime. Quand on lui demande s’il estime que la haine est saine, il répond que notre
génération n’est pas dupe : « la haine ne va faire qu’amplifier, la colère, la volonté de réparer, la volonté d’aller dans la rue et de demander justice pour tous. Ce sont des choses
extrêmement saines si elles sont dirigées, intelligentes et collectives ».
Collecter les débris : ce qu’il restera de haine
Tigiano Fucogini a 24 ans. Sa démarche est celle d’un archéologue contemporain de
l’émeute. Il fait le lien encore plus loin, partant d’un extrait des Misérables de Victor Hugo
« De quoi se compose l’émeute ? De rien et de tout. D’une électricité dégagée peu à peu,
d’une flamme subitement jaillie, d’une force qui erre, d’un souffle qui passe. Ce souffle
rencontre des têtes qui pensent, des cerveaux qui rêvent, des âmes qui souffrent, des
passions qui brûlent, des misères qui hurlent, et les emporte. Quiconque a dans l’âme une
révolte secrète contre un fait quelconque de l’état, de la vie ou du sort, confine à l’émeute, et, dès qu’elle paraît, commence à frissonner et à se sentir soulevé par le tourbillon ».
Très tôt, il filme et photographie les émeutes, les manifestations et les évolutions de certains
mouvements sociaux. « Je pars toujours d’images de la réalité, que je fais ou que je récupère,
que je compose et assemble. On s’est dit (avec Aristide Barraud NDLR), il y a ces révoltes,
ces manifs et 24h après, ça part ? On s’est demandés ce qu’il restait 24h après :
grenades lacrymos, fumigènes, grenades de désencerclement, objets brûlés ? »
Alors, méthodiquement il se rend sur les lieux des manifestations 24h après pour effectuer ce travail de collecte, regarder ce qu’il reste et questionner à travers ces objets, la légitimité de la violence, son usage, les rapports de force, l’utilisation de l’armement. « Pour faire ces
dessins, j’ai mêlé au graphite, la poudre qui restait sur ces grenades, la poudre noire, ce qui
permet d’avoir une vraie sensation et des noirs plus profonds, mais aussi de penser
le fond et la forme ».
Quelle force de frappe pour la violence ?
A la fin de l’exposition un petit bureau recouvert d’ouvrages politiques et de feuilles volantes nous attend. C’est le bureau des démissions, où elle invite en premier lieu, policiers, médias et politiques à dégager.
Dernière installation du parcours, c’est surtout le lieu où Bastienne Rondot propose aux visiteurs de se positionner face à la violence. De prendre une action. « C’est une sorte invitation : là, t’as vu tout ça, toute cette violence… Maintenant, ton rôle à toi, qu’est-ce que c’est ? Où en es-tu ? ».
Sa volonté : questionner chacun sur son rôle dans le système pour que violence
et haine engendrent une action utile, qui ferait sens. « Je l’ouvre à tout le monde, à toutes les personnes qui veulent quitter le rôle qu’ils endossent dans ce système. Parce qu’on a le droit de réfléchir à qui on est et à quoi on sert. Mais, en fin de compte, il s’agit de savoir si on est à l’aise avec ce rôle-là ».
L’exposition est prolongée jusqu’au 11 septembre minuit.
Laure Playoust et Firas Abdullah, de Guiti news