
Richesse des métropoles et misère des périphéries : combler la fracture électorale écologiste
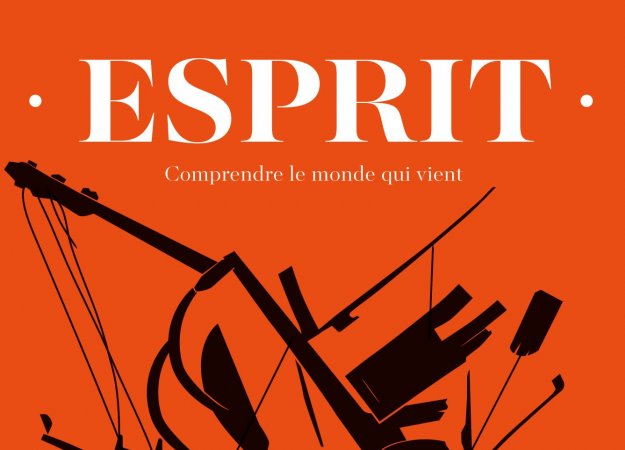
On brocardait naguère les « écolos des villes », d’autant plus proches de l’écologie qu’ils vivaient loin de la nature. Cette réalité perdure en 2020 sous une forme renouvelée, avec l’écologie des métropoles. Les récentes élections municipales (ainsi que les européennes) ont confirmé ce phénomène jusqu’à la caricature. La fracture écologique, une fracture française de plus ? Que dit cette caricature de la disjonction entre question sociale et question environnementale, entre « fin du mois » et « fin du monde » ? Quelles pistes pour tenter d’y remédier ?
20 villes, 2 millions d’administrés. Bon nombre des plus grandes villes de France sont dirigées par les écologistes, ou des forces écolo compatibles (Paris, Rennes…). Ingénieur et spécialiste de la finance, médecin, responsable associative, avocat, consultante juridique… les maires écologistes sont à l’aune de leurs électeurs, en plus prononcé : cadres supérieurs, issus des professions libérales (alors que leur électorat est plutôt issu de la fonction publique). Globalement, on a affaire à des catégories qui ont moins souffert que d’autres de la mondialisation néolibérale depuis les années 80. Qui plus est, les métropoles qui ont voté écologiste sont pour la plupart des villes qui ont concentré la création de valeur au cours des dernières décennies. Le cas de Bordeaux est éloquent. Cette métropole dite « endormie » s’est réveillée d’un long sommeil de droite, et se rend compte qu’elle a changé : ses couches populaires ont déserté le centre pour les périphéries. Accroissant les phénomènes de congestion automobile, d’étalement urbain pavillonnaire et d’attrait pour les hypermarchés périphériques. Faut-il s’étonner si cette agglomération est devenue l’un des bastions des Gilets jaunes ? On le voit, les fractures sont bien là. Les classes moyennes supérieures qui sont restées, vues comme conservatrices, épaulées par une nouvelle base électorale centriste gentrifiée (au même titre qu’à Lyon) a parachevé l’homogénéisation sociale de la ville, et voté pour l’amélioration du cadre de vie. Dans toutes ces villes, cette question devient prioritaire, pas la décroissance ni même l’émergence d’un nouveau système économique issu d’une collaboration de classes.
Doit-on donc y voir l’illustration de ce vote des métropoles tendance « bobo » versus celui des villes petites et moyennes et des zones rurales, bref des « périphéries » ? Il va être difficile de se départir de cette caricature, car elle fait sens politiquement. D’autant que ces victoires électorales se doublent d’une légitimité écornée par un abstentionnisme record (en particulier dans les couches sociales impactées par la crise sanitaire, qui semblent de plus en plus refuser la démocratie représentative). Si donc son influence augmente, en particulier chez couches moyennes favorisées, la base sociale de l’écologie reste étique. Elle peut certes constituer une majorité électorale (ce qui est nouveau et doit être salué), mais ne peut cristalliser une majorité politique, car elle est socialement minoritaire. L’écologie est dorénavant en situation de rêver au contrôle de certaines institutions. Mais cette légalité institutionnelle a pour corollaire une très faible légitimité sociale.
Car cette écologie et les villes qui l’accueillent, fondamentalement centristes, profitent de la mondialisation. Elles en voient certes les dangers, et c’est tout à leur honneur que de les dénoncer (et d’une certaine manière, de prétendre voter contre leurs propres intérêts). Mais ce « vote dans les urnes » se double d’un « vote géographique » inverse, qui évide le contenu politique du premier : en vivant dans des zones privilégiées qui sont les plus dynamiques économiquement (là où la création de valeur est la plus forte, dans l’économie tertiaire de la communication et du savoir), en occupant des emplois et en ayant des activités culturelles spécifiques, cette catégorie vit à côté des soutiers de la société de consommation (les fameux « travailleurs essentiels »), qui en sont la base productive. On est donc en face d’une minorité sociale (écologiste) qui semble déconnectée de ce que Braudel nommait la « civilisation matérielle », puisqu’elle bénéficie de la captation par les métropoles des retombées positives de « l’économie-monde » (tout en étant protégée de ses effets négatifs). Ce faisant, elle semble déconnectée des réalités du « premier étage » de la société (alors que justement l’écologie promeut ce premier étage, celui de l’économie domestique, locale, de proximité, valorisant plutôt la valeur d’usage des biens et services échangés). Le plus ironique étant que leur relative protection vis-à-vis de la mondialisation la plus brutale permet à cette population de recréer un « premier étage » économique micro-local dans les centres-villes (AMAPS, artisans, petits commerçants…). Mais à des prix tels qu’en général les couches populaires, qui traditionnellement étaient les porteuses de cette économie, en sont dorénavant exclues, rejetées vers la société de consommation standardisée.
L’opposition supposée entre deux lignes (Eric Piolle versus Yannick Jadot) n’apparaît ainsi que comme une illusion politique. Elle est sans doute pertinente en termes de stratégie de conquête du pouvoir (faut-il s’allier à la gauche ou viser le centre ?). Mais elle ne dit rien de la manière de gouverner un pays lorsque l’on est socialement minoritaire. Et encore moins de la manière de changer un pays lorsqu’on ne représente qu’une fraction infime de la société.
Le mantra de la convergence « fins de mois/fin du monde » est évidé de tout sens socio-économique profond. Le changement ne peut s’opérer que par l’action de catégories sociales majoritaires qui portent ce mouvement et en profitent matériellement parlant, a fortiori quand il implique un changement de système productif et de société1. Les mouvements sociaux qui ont changé la France se sont tous appuyés sur des populations en rébellion. Quelle classe sociale porte aujourd’hui l’idée écologique comme un besoin vital pour son existence propre, à l’instar de la manière dont le mouvement socialiste a été porté par la classe ouvrière ? Aucune.
La transformation écologique du pays ne se fera que si la base sociale du pays y trouve un intérêt concret. La question est donc : quel intérêt peuvent trouver à l’écologie ceux qui ont été victimes de l’industrialisation de l’agriculture (les paysans) ; ceux qui ont été éradiqués du paysage économique sans bruit (mis à part quelques révoltes dites poujadistes) par la grande consommation, à savoir les artisans et les petits commerçants ; ceux qui ensuite ont été dissous par la désindustrialisation (la classe ouvrière) ; et alors que maintenant la classe moyenne elle-même se désagrège en une myriade de monades sans autre idéologie que celle d’un consumérisme anomique ? Comment rassurer ces couches populaires de la pertinence d’une nouvelle révolution économique, alors que toutes les précédentes n’ont produit que leur déclin ? Alors qu’aujourd’hui, toutes se disent : le déclassement, la misère, sera-ce pour moi ou pour mes enfants ?
C’est pourquoi il faut à tout prix mettre ces populations majoritaires au coeur des réflexions sur le nouveau modèle productif que les écologistes espèrent voir advenir, celui de l’économie circulaire. Il faut même leur en confier les clefs. Si l’écologie des « sachants » ne sait pas comment faire appel à la France des « faisants », elle s’affaissera dans un chaos social qui l’empêchera d’emprunter ce chemin.
Pour ce faire, le premier impératif est de réencastrer les métropoles dans une économie locale, territorialisée. De casser tous les Rungis et tous les périphériques qui les déconnectent de leur environnement proche, pour que dans leur vie quotidienne, celle de la « civilisation matérielle », une économie de proximité se substitue à leur dépendance envers « l’économie-monde ». C’est le premier objectif d’une relocalisation au profit d’activités motrices dans la transition écologique. Le tout mené par des agglomérations faisant travailler en symbiose villes-centress et communes limitrophes en matière de logement, de transports, d’échanges économiques et de foncier, d’éducation, de sport, de loisirs, de culture, sans chercher à externaliser leurs difficultés vers les périphéries.
Faute de quoi, on pourra clairement à nouveau parler de sécession des élites (cette fois-ci écologistes). Tel est l’enjeu de la constitution d’un écologisme municipal cohérent, à l’aune de ce que fut le socialisme municipal, l’ébauche d’une contre-société utile au peuple.
1 - Il est risible d’objecter qu’en améliorant l’isolation thermique des bâtiments on touche à la question sociale : cette mesure ne fait pas programme (d’autant que le caractère tant social qu’écologique de celle-ci reste ténu, aussi les couches populaires n’en ont jamais fait un impératif).
Erwan Ruty



