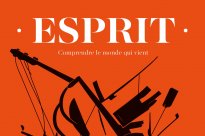Les soulèvements du ter-ter

En 1983, il y a exactement 40 ans, s'élançait la Marche pour l'égalité. Elle faisait suite, déjà, à une "bavure" policière contre un jeune habitant d’un « quartier » à Vénissieux, Toumi Djaïdja, quelque temps après les premières émeutes urbaines, apparues sur ce territoire. Cette marche traversant la France parvint à transformer la colère en geste politique, jusqu'à rassembler 100 000 personnes, à son arrivée à Paris, à mener ses organisateurs à l'Elysée, et à obtenir quelques avancées légales. Elle changea surtout le visage de la société française, pendant au moins dix ans, grâce à un vaste mouvement culturel, caricaturé par le terme « beur », voire à politiser une génération entière d’habitants des quartiers et du reste de la France, via des organisations comme SOS Racisme.
En quoi cette marche, vaste mouvement d’indignation, pacifique, est-elle différente des révoltes de 2005 et de 2023, alors que les causes sont identiques ?
Pourquoi le pacifisme en 1983, pourquoi la violence en 2023 ?
Le contexte a changé : les mouvements d’éducation populaire et syndicaux qui avaient alors pu accompagner et organiser la marche et pacifier les tensions existantes, sont aujourd’hui exsangues, quasi oubliés des « plans banlieue » et des milliards déversés sur ces quartiers pour refaire le bâti (certes nécessaire). Par ailleurs, les décideurs politiques n’ont plus le pouvoir qu’ils avaient alors, éparpillé en mille et un niveaux de décision, d’institutions dotées chacune de son propre agenda, d’autorités indépendantes. Le pouvoir s’est dilué dans une mégamachine bureaucratique, avec laquelle les faibles corps intermédiaires associatifs ne parviennent plus à construire un projet sur le temps long. Les lieux de débat, dans les organismes en charge du soutien aux acteurs des quartiers, ont le plus souvent laissé place, comme partout ailleurs, à des échanges via des plate-forme numériques. Cette déshumanisation des rapports sociaux préside à leur brutalisation. Faute d’interlocuteur visible, fiable, pérenne pour les uns, d’autres laissent exploser leur colère, sans limites. Comme le dit Hugo dans Les misérables, « il y a des rages folles ». Et de rappeler : « L’émeute frappe au hasard, comme un éléphant aveugle, en écrasant. (…) Quelquefois le peuple se fausse fidélité à lui-même. La foule est traître au peuple. Le bruit du droit en mouvement se reconnaît, il ne sort pas toujours du tremblement des masses bouleversées ».
La mémoire de la peur
Facteur aggravant, la police est toujours moins présente sur le terrain, au quotidien, du fait des modes d’intervention qui lui sont imposés depuis la dislocation de la « police de proximité », au profit d’une police d’intervention, toujours mieux équipée et plus « efficace » dans les situations violentes. Cela a pour conséquence de régulièrement raviver la douloureuse mémoire post-coloniale d’une force qui réprime les jeunes hommes des quartiers, plus souvent qu’elle ne parvient à protéger l’ensemble de leurs habitants. A tel point que la peur de la police est devenue coutumière dans cette jeunesse-là. Rarement bonne conseillère, cette peur peut provoquer des accès de panique, parfois mortels chez des innocents (comme en 2005) ou des contrevenants, auxquels peuvent succéder des accès de haine chez ceux qui s’identifient à eux. Les « forces de l’ordre » paraissent ainsi, aux yeux de beaucoup, défendre un ordre inique et n’être que le bras armé de la violence verbale droitière. Violences verbales et physiques à laquelle répondent les violences urbaines, qui se déportent maintenant hors de leurs foyers d’origine -témoignage inédit que leurs auteurs ont tiré certaines leçons des précédentes violences sociales, Gilets jaunes et manifestations pour les retraites en particulier. Ainsi se vengent les mal-aimés de la République, boucs-émissaires de maux qui les dépassent, en premier lieu desquels la désindustrialisation et le chômage de masse.
Quand les banlieues seront la cheville ouvrière de la transition écologique
Car que dit de la société du XXIè siècle des deux générations de chômeurs et du précariat qui s’est installé dans les banlieues ? Puisque l’identité commune ne passe plus par le travail, des identités de substitution la remplacent, en particulier celle liée au territoire, d’autant plus forte qu’il est ghettoïsé. C’est d’abord la reconquête de celui-ci qui est à l’oeuvre dans ces émeutes. Un renversement de l’ordre social dans lequel une fraction de la jeunesse se réapproprie la cité que la République lui dispute, souvent via ses forces de l’ordre, tout en l’ayant délaissée, en en éloignant l’économie et les services publics. Le ré-arrimage de ces périphéries avec le centre de la société française (comme celui des banlieues pavillonnaires qui ont enfanté la révolte des Gilets jaunes), ne se fera, sur le long terme, qu’avec le retour du travail. On parle enfin de réindustrialisation à tous les niveaux de l’État. Celle-ci doit d’une part se faire prioritairement sur ces territoires, qui disposent d’un véritable dynamisme entrepreneurial (puisque c’est là qu’existe l’un des plus fort taux de création d’entreprise, certes micro-), mais aussi du foncier et de la ressource humaine nécessaire (majoritairement passée par l’enseignement professionnel et technique, qu’il faut réorienter vers les métiers productifs, de la main, et non plus du commerce). Cette réindustrialisation doit surtout se faire via les métiers de la transformation écologique de l’économie, celle du low tech. Et non celle de la high tech, qui est encore la plus largement financée par les pouvoirs publics, dans la même logique qui nous mène depuis toujours à la catastrophe sociale et environnementale (à l’instar de la réindustrialisation telle qu’on la voit à l’oeuvre avec ST Microélectronics, en périphérie de Grenoble, laquelle épuise la nature, les finances publiques, et n’embauchera jamais dans les périphéries). Or, dans la construction écologique et la rénovation du bâti, dans l’économie de la réparation et dans celle du recyclage, résident des gisements de centaines de milliers d’emplois, qualifiés et de haute qualité environnementale, souvent novateurs et valorisants, dans de petites unités de production, seules susceptibles de s’adapter à leur territoire d’élection sans l’écraser. Des TPE et PME qui pourraient faire de ces territoires les fers de lance d’un nouveau système productif d’avenir, rendant à leurs habitant la dignité et l’identité que le monde ouvrier a perdu avec la désindustrialisation.
Depuis 40 ans, la France se cache les yeux pour ne pas voir ses banlieues, condensé sur un même territoire de toutes ses crises, économique, sociale, politique, culturelle, environnementale. Alors, régulièrement, ces territoires viennent se rappeler à son bon souvenir, par un geste magnifique (sportif, culturel, entrepreneurial, social...) ou tragique. Elles n’ont pourtant jamais cessé de constituer l’épicentre du destin politique national, tant les Le Pen en ont fait leur cible, fracturant la société. Délinquance, émeutes, djihadisme : les différents gouvernements et présidents ont buté sur les maux associés aux banlieues, ne parvenant pas à les agréger à une vision d’ensemble de l’avenir du pays, et en en faisant même le symptôme d’un échec : l’incapacité de réintégrer ces périphéries au centre de la société française, alors qu’elles étaient hier au coeur de son système productif.
On a besoin d’un syndicat des banlieues
Par l’entrepreneuriat, Macron s’y est à timidement employé en début de mandat : « c’est Uber ou le deal », déclarait-il naguère, à Stains. Mais lorsque les libéraux s’opposent à la transformation en salariés des travailleurs indépendants des plate-forme, il les précarisent. Ce faisant, ils obligent non pas à choisir entre Uber ou le deal, mais à juxtaposer Uber et le deal dans ces territoires. Au XIXè siècle, la société française avait projeté ses paysans et artisans de province dans l’infra-monde industriel, avant que le mouvement ouvrier ne parvienne à l’organiser et à en faire un des piliers de la République et du progrès social, après tant de révoltes et de luttes. Nous en sommes revenus à cet âge-là, celui des émeutes proto-politiques. Ce soulèvement des banlieues, véritable soulèvement, non de la terre mais du « ter-ter » (cad du terrain, du quartier, dans l’argot des banlieues), en témoigne : on a besoin de véritables « syndicats des banlieues », dotés de fonctions tribunitiennes et organisationnelles, exprimant leurs besoins et revendications quotidiennes, au-delà des conseils citoyens, simples maillons d’une « politique de la ville » devenue « machin » administratif illisible, sans politique, ni ville, ni urbanité.
Il ne faut jamais oublier les banlieues. C’est une faute morale, politique, et osons le dire, civilisationnelle. Car elles nous racontent la France de demain, qu’on l’aime ou qu’on la redoute.
Pourquoi le pacifisme en 1983, pourquoi la violence en 2023 ?
Le contexte a changé : les mouvements d’éducation populaire et syndicaux qui avaient alors pu accompagner et organiser la marche et pacifier les tensions existantes, sont aujourd’hui exsangues, quasi oubliés des « plans banlieue » et des milliards déversés sur ces quartiers pour refaire le bâti (certes nécessaire). Par ailleurs, les décideurs politiques n’ont plus le pouvoir qu’ils avaient alors, éparpillé en mille et un niveaux de décision, d’institutions dotées chacune de son propre agenda, d’autorités indépendantes. Le pouvoir s’est dilué dans une mégamachine bureaucratique, avec laquelle les faibles corps intermédiaires associatifs ne parviennent plus à construire un projet sur le temps long. Les lieux de débat, dans les organismes en charge du soutien aux acteurs des quartiers, ont le plus souvent laissé place, comme partout ailleurs, à des échanges via des plate-forme numériques. Cette déshumanisation des rapports sociaux préside à leur brutalisation. Faute d’interlocuteur visible, fiable, pérenne pour les uns, d’autres laissent exploser leur colère, sans limites. Comme le dit Hugo dans Les misérables, « il y a des rages folles ». Et de rappeler : « L’émeute frappe au hasard, comme un éléphant aveugle, en écrasant. (…) Quelquefois le peuple se fausse fidélité à lui-même. La foule est traître au peuple. Le bruit du droit en mouvement se reconnaît, il ne sort pas toujours du tremblement des masses bouleversées ».
La mémoire de la peur
Facteur aggravant, la police est toujours moins présente sur le terrain, au quotidien, du fait des modes d’intervention qui lui sont imposés depuis la dislocation de la « police de proximité », au profit d’une police d’intervention, toujours mieux équipée et plus « efficace » dans les situations violentes. Cela a pour conséquence de régulièrement raviver la douloureuse mémoire post-coloniale d’une force qui réprime les jeunes hommes des quartiers, plus souvent qu’elle ne parvient à protéger l’ensemble de leurs habitants. A tel point que la peur de la police est devenue coutumière dans cette jeunesse-là. Rarement bonne conseillère, cette peur peut provoquer des accès de panique, parfois mortels chez des innocents (comme en 2005) ou des contrevenants, auxquels peuvent succéder des accès de haine chez ceux qui s’identifient à eux. Les « forces de l’ordre » paraissent ainsi, aux yeux de beaucoup, défendre un ordre inique et n’être que le bras armé de la violence verbale droitière. Violences verbales et physiques à laquelle répondent les violences urbaines, qui se déportent maintenant hors de leurs foyers d’origine -témoignage inédit que leurs auteurs ont tiré certaines leçons des précédentes violences sociales, Gilets jaunes et manifestations pour les retraites en particulier. Ainsi se vengent les mal-aimés de la République, boucs-émissaires de maux qui les dépassent, en premier lieu desquels la désindustrialisation et le chômage de masse.
Quand les banlieues seront la cheville ouvrière de la transition écologique
Car que dit de la société du XXIè siècle des deux générations de chômeurs et du précariat qui s’est installé dans les banlieues ? Puisque l’identité commune ne passe plus par le travail, des identités de substitution la remplacent, en particulier celle liée au territoire, d’autant plus forte qu’il est ghettoïsé. C’est d’abord la reconquête de celui-ci qui est à l’oeuvre dans ces émeutes. Un renversement de l’ordre social dans lequel une fraction de la jeunesse se réapproprie la cité que la République lui dispute, souvent via ses forces de l’ordre, tout en l’ayant délaissée, en en éloignant l’économie et les services publics. Le ré-arrimage de ces périphéries avec le centre de la société française (comme celui des banlieues pavillonnaires qui ont enfanté la révolte des Gilets jaunes), ne se fera, sur le long terme, qu’avec le retour du travail. On parle enfin de réindustrialisation à tous les niveaux de l’État. Celle-ci doit d’une part se faire prioritairement sur ces territoires, qui disposent d’un véritable dynamisme entrepreneurial (puisque c’est là qu’existe l’un des plus fort taux de création d’entreprise, certes micro-), mais aussi du foncier et de la ressource humaine nécessaire (majoritairement passée par l’enseignement professionnel et technique, qu’il faut réorienter vers les métiers productifs, de la main, et non plus du commerce). Cette réindustrialisation doit surtout se faire via les métiers de la transformation écologique de l’économie, celle du low tech. Et non celle de la high tech, qui est encore la plus largement financée par les pouvoirs publics, dans la même logique qui nous mène depuis toujours à la catastrophe sociale et environnementale (à l’instar de la réindustrialisation telle qu’on la voit à l’oeuvre avec ST Microélectronics, en périphérie de Grenoble, laquelle épuise la nature, les finances publiques, et n’embauchera jamais dans les périphéries). Or, dans la construction écologique et la rénovation du bâti, dans l’économie de la réparation et dans celle du recyclage, résident des gisements de centaines de milliers d’emplois, qualifiés et de haute qualité environnementale, souvent novateurs et valorisants, dans de petites unités de production, seules susceptibles de s’adapter à leur territoire d’élection sans l’écraser. Des TPE et PME qui pourraient faire de ces territoires les fers de lance d’un nouveau système productif d’avenir, rendant à leurs habitant la dignité et l’identité que le monde ouvrier a perdu avec la désindustrialisation.
Depuis 40 ans, la France se cache les yeux pour ne pas voir ses banlieues, condensé sur un même territoire de toutes ses crises, économique, sociale, politique, culturelle, environnementale. Alors, régulièrement, ces territoires viennent se rappeler à son bon souvenir, par un geste magnifique (sportif, culturel, entrepreneurial, social...) ou tragique. Elles n’ont pourtant jamais cessé de constituer l’épicentre du destin politique national, tant les Le Pen en ont fait leur cible, fracturant la société. Délinquance, émeutes, djihadisme : les différents gouvernements et présidents ont buté sur les maux associés aux banlieues, ne parvenant pas à les agréger à une vision d’ensemble de l’avenir du pays, et en en faisant même le symptôme d’un échec : l’incapacité de réintégrer ces périphéries au centre de la société française, alors qu’elles étaient hier au coeur de son système productif.
On a besoin d’un syndicat des banlieues
Par l’entrepreneuriat, Macron s’y est à timidement employé en début de mandat : « c’est Uber ou le deal », déclarait-il naguère, à Stains. Mais lorsque les libéraux s’opposent à la transformation en salariés des travailleurs indépendants des plate-forme, il les précarisent. Ce faisant, ils obligent non pas à choisir entre Uber ou le deal, mais à juxtaposer Uber et le deal dans ces territoires. Au XIXè siècle, la société française avait projeté ses paysans et artisans de province dans l’infra-monde industriel, avant que le mouvement ouvrier ne parvienne à l’organiser et à en faire un des piliers de la République et du progrès social, après tant de révoltes et de luttes. Nous en sommes revenus à cet âge-là, celui des émeutes proto-politiques. Ce soulèvement des banlieues, véritable soulèvement, non de la terre mais du « ter-ter » (cad du terrain, du quartier, dans l’argot des banlieues), en témoigne : on a besoin de véritables « syndicats des banlieues », dotés de fonctions tribunitiennes et organisationnelles, exprimant leurs besoins et revendications quotidiennes, au-delà des conseils citoyens, simples maillons d’une « politique de la ville » devenue « machin » administratif illisible, sans politique, ni ville, ni urbanité.
Il ne faut jamais oublier les banlieues. C’est une faute morale, politique, et osons le dire, civilisationnelle. Car elles nous racontent la France de demain, qu’on l’aime ou qu’on la redoute.
Cet article est la version intégrale de la tribune parue dans Le Monde en date du mercredi 5 juillet 2023 et sur lemonde.fr sous le titre "Il ne faut jamais oublier les banlieues":
À lire aussi... Société
Le 04-12-2020