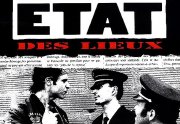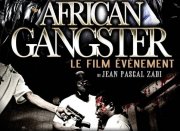Regard de banlieue sur la bataille de l’image
Les articles du dossier:

Vers où Cannes regarde-t-il en 2013 ? Vers son nombril, ou au fond de son verre de mousseux ? Ou enfin droit dans les yeux d’une une époque qui a offert à Intouchable près de vingt millions d’entrées ? Que dit le premier festival de ce cinéma qui se penche sur les quartiers et les minorités et où le rire semble avoir remplacé « La haine » ?
A-t-il remarqué que des cinéastes issus des marges du récit national, qu’ils s’appellent Abdellatif Kéchiche, Djamel Bensallah, Rachid Bouchareb, Lucien Jean-Baptiste, maintenant, touchent le grand public, contrairement aux premiers Malik Chibane ou Mahmoud Zemouri ?
S’est-il aperçu que la vision sociale (chez Kassowitz, Ameur-Zaimeche ou Richet) semble avoir été supplantée par une vision « raciale », dirait-on aux Etats-Unis, c’est-à-dire où la couleur de peau paraît être le principal critère de différence ? Que dit-il des images qui ont envahi l’univers policé du cinéma de papa, via les blogs, les réseaux sociaux : Facebook, Skyrock, via Daily Motion et You Tube et on en passe ; et dont se sont emparés les jeunes générations, qui font le monde de l’image et ne se contentent plus de le regarder ?
Une nouvelle génération émerge qui filme comme elle respire
Là est pourtant aujourd’hui le cinéma du réel. Entre la télé, la vidéo numérique, le web, le mobile. Des formats plus courts. Des projets cosmopolites, métisses. Des supports nouveaux. Des canaux de diffusion inédits. Et des langages plus rugueux souvent. Une nouvelle génération émerge qui filme comme elle respire. Partout dans les quartiers la jeunesse qui n’a pas accès à la Fémis (pourtant dirigée par l’incroyable Raoul Peck, cinéaste haïtien) s’empare de ses petites caméras numériques pour des productions low cost mais haute intensité. Des Djaïdani et son « cinéma RSA », des Carrénard et son « cinéma guérilla », des associations, des maisons de quartier, des collectifs de réalisateurs se lancent tous les jours dans la bataille de l’image, mais vue des marges. Des Générations courts, des Engraineurs, des Cité Arts, des Urban Prod, des R Style, des Alakissmen, et même des Kaïna TV qui racontent leur quartier grâce au webdocumentaire, courent les rues des cités sensibles… sensibles aux images surtout. Des marges qui s’y connaissent en la matière, à force justement d’être brûlées par les images du quotidien des JT. Si bien que les plus grands s’y intéressent (Besson et sa « Cité du cinéma » de Saint-Denis, épaulée d’une « Ecole de la cité »), comme les plus « auteurisants » (Gondry et son « Usine à films » rêvée à Aubervilliers).
Au milieu des années 60, une Nouvelle vague s’était imposée, puis avait accompagné une révolution des mœurs et des consciences. Elle avait bouleversé jusqu’au-delà de l’Atlantique, faisant émerger le « Nouvel Hollywood ». Au moment où un nouvel accord de libre-échange fait planer un risque de remise en cause de « l’exception culturelle », la France saura-t-elle s’abreuver à la fontaine de Jouvence de sa diversité culturelle, afin de se créoliser et d’ainsi pouvoir mieux parler à l’ensemble de la « francophonie », et à s’exporter dans le monde entier ?
En un temps où l’audiovisuel a pris le pas sur les autres formes de communication, notamment dans l’expression médiatique issue des quartiers (la presse étant jalousement protégée par une élite qui s’enferme dans un très rassurant entre-soi), un enjeu paraît crucial : parvenir à parler de soi à la première personne du singulier (ou du pluriel), pour s’imposer dans le récit que notre pays fait de lui-même. Les quartiers, les minorités arrivent sans doute mieux à se faire entendre, à se faire voir. Dans les périphéries prolifère le cinéma du futur. Peu de gens les « calculent » aujourd’hui ; ils sauront se faire voir demain.