
Tewfik Farès : « Il faut que les quartiers eux-mêmes racontent leur histoire. »
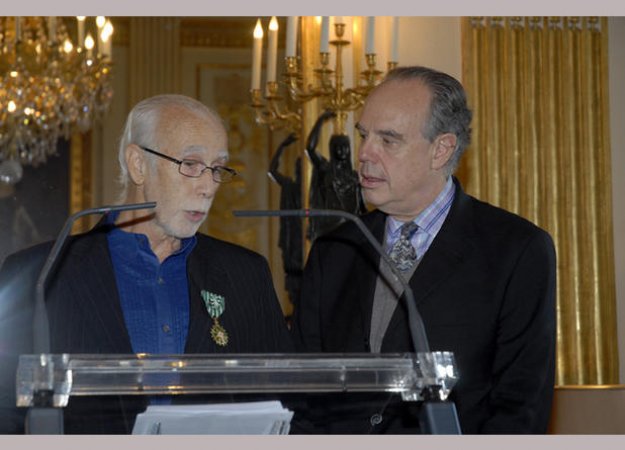
Tewfik Farès n'est pas né de la dernière pluie, mais dans l'Algérie kabyle et coloniale, en 1937. Après un parcours dans le monde de l'image essentiellement sur le sol français, il s'est fait remarquer par une des premières réalisations algériennes post-révolutionnaire (« Hors-la-loi »).
Mais sa carrière ne s'est pas arrêtée là : il a aussi bien été scénariste d'une Palme d'or à Cannes (en 1975), assistant de grands noms comme Rossellini ou Chabrol, ensuite réalisateur de documentaires sur les sujets les plus variés, et enfin producteur de l'ancêtre télévisuelle des émissions dédiées à l'immigration et aux « invisibles » d'alors, au sens large : Mosaïques. Avant de lancer l'opération Télécité avec plusieurs équipes de jeunes réalisateurs en herbe issus des quartiers, pour France 3 pendant cinq ans. Rapide revue d'un parcours ébouriffant.
Ses débuts, Tewfik Farès les faits comme rédacteur dans les « actualités cinématographiques » algériennes, qui se montaient à Gennevilliers, après 1963 ; et étaient alors diffusées dans les quelques 400 cinémas du pays (il n'en existe plus aucun), avant le films, comme en France. « C'est ça le miracle algérien ! Malgré sept ans de guerre, de souffrance, il n'y avait aucun ressentiment ! » glisse-t-il en passant, de son sourire très discret. Il y a alors des relations dans tous les domaines. Il entre à l'IDHEC, ancêtre de la Fémis, et des études universitaires de cinéma, mais à la méthode française. Il en rigole encore : « Il n'y avait pas de caméra ! On ne faisait que de la théorie ! Je me suis dit, tant qu'à faire autant faire des études d'histoire et de lettres à la Sorbonne ! »
Un ulcère et pas de cinéma algérien
Mais il cesse sa collaboration avec les actualités algériennes au moment de la chute de Ben Bella, après 1965. Pour mieux revenir dans la foulée. Son premier film : « Hors la loi », sur les « bandits d'honneur » algériens précurseurs de la révolution comme Krim Balkacem, fait un tabac dans un pays tout juste remis de la guerre. Avec la sympathie du gouvernement d'alors, qui a besoin de récits héroïques, d'un cinéma populaire, et lui demande de venir travailler en Algérie. « Il voulait que j'organise le cinéma là-bas. Mais moi, je ne voulais pas ! Je voulais réaliser des films ! Ceux qui ont accepté ont fait les deux, et se sont bien enrichis ! Je suis seulement revenu avec quatre scénarios. » Avec « Hors la loi », il espère inventer un nouveau genre, dans la lignée de Sergio Leone : « Je voulais faire un « western couscous », comme à l'époque il y avait un « western spaghetti » en Italie ! » Un genre qui n'aura que peu de descendance ! Et qui éloignera même à tout jamais son auteur de son pays natal : « L'expérience de « Hors la loi » m'a vacciné sur le cinéma, en Algérie : je suis revenu avec un ulcère ! Tous les gens me foutaient des bâtons dans les roues : ils voulaient tous être réalisateurs, mais la superstructure bureaucratique faisait tout, c'est Ben Yahia qui décidait. Je me suis dit : « les algériens ont une fascination pour l'échec ». Il y a bien des réalisateurs, des films, des techniciens, mais pas de cinéma algérien... »
Identité franco-algérienne et franco-militante
« A la maison, on parlait kabyle. L'arabe était ma première langue étrangère. Mon père, professeur, était un ami de Germaine Tillon. Il avait apporté les méthodes de l'Education nouvelle en Algérie, et travaillé dans les centres sociaux. Et c'est la même, toute auréolée encore de son statut de résistante française, qui l'a tiré des griffes des parachutistes français. » Sans doute fort de cet atavisme militant, Tewfik Farès enchaîne alors quelques films engagés : « Le retour » (sur l'immigration), « La génération de la guerre » (sur les enfants des rues qui sniffaient de la colle... déjà), ou « Des jours difficiles » (sur le premier crime raciste anti-algérien recensé et commis par des civils, en 1971, dans les Vosges). Vient alors l'expérience de Mosaïques, en 1977, première émission de télé sur les « invisibles », mais qui a dépassé sa cible d'origine. « C'est la naissance de ma fille, de mère espagnole, qui m'a amené à ces questions, alors qu'il n'y avait rien, alors sur les écrans. On s'est dit, à l'occasion d'une conversation avec Sayad [le sociologue de l'immigration, auteur notamment de « La double absence, ndlr] : Il faut parler de ces gens qui sont là et cassent des cailloux, mais qui ont aussi une culture ».
Mosaïques
L'émission dure dix ans, et s'arrête à cause des convoitises nées autour, en raison de son succès. Mais c'est l'époque de la cohabitation. Le pouvoir, qui avait la main sur l'émission notamment via un financement lié au ministère de l'immigration, veut alors « démaghrebiser » l'émission. 90 minutes par semaine sur l'immigration qui étaient regardées par tout le monde... un vrai enjeu. Paradoxe violent : « La seule chaîne avec qui j'ai toujours travaillé dans un confort total, c'est TF1 : quand ils savent ce qu'ils veulent, ils mettent l'argent pour, contrairement au service public. Ils l'ont fait avec moi pour mes films sur Reagan, ou sur l'Abbé Pierre. » Une réalité qui laisse songeur, venant de la part d'un engagé de toujours comme Tewfik Farès...
Et aujourd'hui, quelle filiation ?
« La meilleurs façon de faire surgir la vie des quartiers, c'est de le faire avec ceux qui y vivent, en leur donnant des caméras. » Et il ne s'en privera pas : avec Télécité, financé par le FAS, le CNC, la région Île-de-France, les municipalités... une émission de proximité, sur une chaîne régionale. Pas comme Sagacités, où, selon lui « la vérité venait d'en haut », les quartiers sont vus par des professionnels. « Il faut que les quartiers eux-mêmes racontent leur histoire. C'est ce que je disais aux gamins : c'est votre vie, votre quotidien. A vous de vous impliquer. » L'expérience dure un peu plus de quatre ans, jusqu'en 2003. « J'ai décidé d'arrêter quand on m'a demandé de diviser par trois le nombre d'émissions à réaliser [après plus de 200 réalisations, ndlr...]. Pourtant, cela ne coûtait pas un centime à la chaîne... Avant, il y avait la pub, alors on nous disait qu'il ne fallait pas être « segmentant ». Maintenant, on dit qu'il n'y a pas de budget ! Le service public doit faire des économies, il va y avoir des charrettes... En plus les boîtes de production trustent tout, et font le chantage au chômage si on leur propose de nouveaux programmes qui remettent en cause leur domination. Et puis il y a les habitudes des techniciens fonctionnaires de France 3 : on a failli faire le coup de poing entre jeunes et eux, quand ils voulaient replier le matériel au milieu d'une prise parce qu'il était 18 heures, alors que les jeunes travaillaient sans être payés et voulaient continuer... » Et d'assèner : « Maintenant, sur ces questions, c'est la déshérence. Il n'y a plus d'Etat, plus rien... Mais l'espace n'est pas vide. Il est rempli par les religions, par les mafias... »
Télécité avait un rôle éducatif et culturel... Pour lui, c'est la banlaité de la vie quotidienne qui devrait nous intéresser, « pas besoin de drogue et de violence, comme « Les experts à Miami » et toutes les séries policièrs nous l'imposent, si bien qu'on n'a plus envie de faire autre chose... On est assommé par ce que les JT et la radio racontent : attentats, délinquance, désespérance, faits divers... » Et les succès récents façon « Intouchables » ne sont pas là pour le rassurer. « C'est des comédiens absolument formidables, mais surtout une belle histoire de milliardaire... quand on voit qu'on ne peut même pas prendre le métro en fauteuil roulant ! » « Indigènes » ? « Chanter « C'est nous les Africains » à Cannes, c'est ne rien comprendre à l'histoire et à la politique, ça veut juste exprimer le joie de monter sur scène... » 76 ans, et encore toutes ses incisives pour mordre là où ça fait mal !



