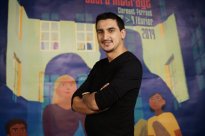Sauvages libertés avec les mots
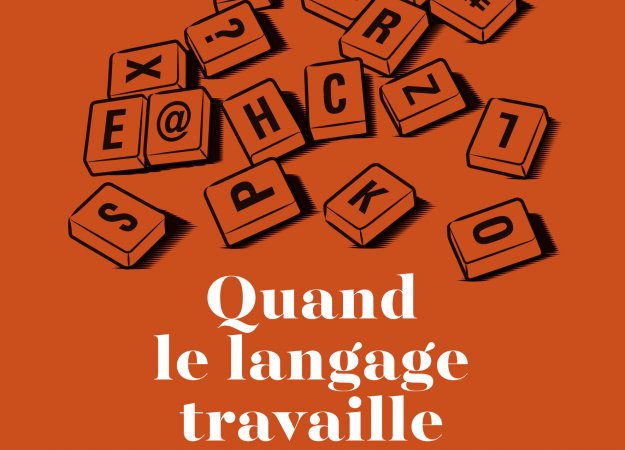
En décembre 2007, Time magazine faisait sa couverture sur « La mort de la culture française ». Mais c’était aussitôt pour juger que la « diversité » et les cultures urbaines pouvaient seules provoquer l’indispensable renouveau de cette culture jugée moribonde, estimant que ces cultures étaient une des rares formes d’expressions artistiques à évoquer la « condition française ». Des auteurs et linguistes français estiment aussi que l’avenir de la culture passe « par le bas », que les différentes formes d’expressions issues des banlieues revivifient tant langage que pensée. L’histoire a même prouvé qu’elles étaient un rempart face à une américanisation accélérée qui depuis les années 80 se développerait plutôt « par le haut » : le management, l’entreprenariat, la communication, la publicité en particulier, apanage des nouvelles élites.
Une culture qui s’enracine aussi dans la culture populaire traditionnelle
En se réappropriant une forme d‘expression pourtant elle-même d’origine largement américaine, paradoxe remarquable, les cultures urbaines ont transformé la culture populaire française. Cette réappropriation par les habitants des banlieues de grands ensembles, essentiellement issus de l’immigration postcoloniale, d’une culture née dans les quartiers ghettoïsés new-yorkais, n’est cependant pas arrivée sur un terrain vierge. Ce terrain, Jalil Naciri, acteur, auteur, réalisateur, le décrit comme « une tradition orale, un folklore, des influences américaines, une façon de parler, un argot, des métaphores, des codes (le tatouage, les bagnards de Cayenne…), nés du métissage et qui vont à l’encontre du communautarisme (…) qui ressuscite les Apaches, Audiard, Jean Gabin voire l’époque du Balajo, de Casque d’Or, lié à la voyoucratie, aux balloches et aux guinguettes1. » Une culture dont se revendique également l’ex-rappeur et écrivain Mc Jean Gab’1 (alias Charles M’Bouss)2. Les rappeurs de cette époque sont bien à la fois enracinés dans leur territoire, révoltés à la manière des chansonniers du 19è ou 20è siècle (NTM ; Assassin), mais aussi parfois tournés vers d’autres racines que leurs homologues américains ignorent : IAM et surtout le collectif Bisso na Bisso (du Secteur Ä avec des stars des musiques de tout le continent africain en 1999) en témoigne, qui produit un « Racines » ouvert notamment sur le Congo, mêlant les musiques et les langues de divers pays. Suivront de la même manière d’autres succès comme ceux du 113 au Maghreb (« Tonton du bled ») à la fin des années 90 ou de MHD au milieu des années 2010.
Un hip-hop 100% français
Mais cette culture connaît vraiment son envol en 1994, année paradoxale du rap -un art qui aurait pu rester confiné dans les marges musicales et commerciales françaises pendant encore quelques années, si un ministère ne lui était pas venu en aide bien involontairement : celui de la Culture et de la francophonie, que dirige alors Jacques Toubon. La divine surprise viendra en effet de l’appui involontaire de sa loi sur les quotas (40% d’émission de musique francophone imposés à toutes les chaînes, radio, télé). Chaînes qui y voient d’abord une mesure liberticide et nocive… avant de réaliser progressivement qu’elle offre en fait une vitrine inédite et inouïe à un nouveau genre musical, le rap (dont les auteurs autant que les auditeurs, essentiellement issus des banlieues, sont très peu familiers de l’anglais), qui lui ouvre de nouveaux segments de population. Dans cette brèche commerciale finissent par s’engouffrer quelques opportunistes comme Pierre Bellanger, patron de Skyrock, qui vire sa cuti musicale et ouvre grandes les portes au rap, constatant que l’audience y réagit très bien, à partir de 1996. La radio passe en quelques années de 2,5 millions à 4,5 millions d’auditeurs3.
Quelques années plus tard, une fois bien installée, cette culture recevra ses lettres de noblesse : comme le fait remarquer l’un des plus fervents parrains de ces cultures, le linguiste Alain Rey (préfacier du « Lexik des cités », produit avec des jeunes de l’association Banlieues créatives) :
« Sans le rap, la langue française serait momifiée. Une langue est vivante quand elle comporte des éléments créatifs (…) Contrairement à la poésie moderne, le rap s’appuie sur la rime. C’est elle qui va déclencher un vocabulaire particulier. Par ailleurs, l’écriture rap doit respecter un rythme. Donc le langage va aussi être utilisé comme un matériau (…) Aujourd’hui, cette musique s’est popularisée et son langage correspond plus à une génération qu’à une classe sociale »4.
De plus, comme l’assure l’ethnologue Marc Hatzfeld, les cultures urbaines sont aussi une alternative à l’anglicisation de la langue française, qui est systématique dans le milieu de la communication, des sciences et de l’entreprise, segments du monde social qui est plutôt aux mains des élites :
« C’est l’ouverture du français aux variétés vivantes du verlan comme d’autres vigoureuses audaces orales, dont le slam est une illustration, qui le sauvera de la prédation des sabirs anglo-saxons (…) Il n’y a aucune raison qu’il ne réjouisse pas les amateurs de belles lettres de la même manière que l’argot de Céline, Carco ou Genet a renouvelé une langue française déjà tentée par l’immobilisme conventionnel »5.
Un auteur qui n’est pas loin de considérer que la préservation et le renouvellement d’un certain patrimoine culturel, le plus important qui soit, celui de la langue, se fait par le bas, les couches populaires qui n’ont parfois d’autre richesse que leur langue, leur culture, leur identité, et se défait par le haut, les élites...
Radio, télé, théâtre et seuls-en-scène
Mais les cultures urbaines, motrices de nouvelles manières de s’exprimer, ne sauraient s’arrêter au rap. Les premiers à torturer la langue et s’en flatter sont une poignée d’artistes incubés chez Radio Nova puis de Canal +, parmi lesquels Jamel Debbouze, qui avait été formé au stand up par Alain Degois (aka Papy, au Déclic théâtre de Trappes). Le succès de ces nouvelles formes d’humour absurde, décalé, volontiers auto-parodique, tient en particulier à sa manière de jouer sur les mots, leur sens, et sur les maladresses et les imperfections dans la maîtrise de la langue française (et dont la série de Canal + « H » sera l’un des exemples les plus absurdes, tout comme tant d’autres émissions à l’instar de « SAV des émissions » de Omar et Fred, sur la même chaîne). Ils feront florès sur les scènes théâtrales pour dizaines, y amenant un public qui n’en était pas forcément coutumier (grâce à Omar Sy, Thomas N’Gigol, Stéphane Bac ou même Yacine Belattar et tant d’autres encore). Du théâtre, consécration ultime, certains passeront au cinéma : la réussite la plus aboutie en la matière étant la transmutation par Alain Chabat de « Astérix et Cléopâtre », qui est à la base l’œuvre d’un autre génial mixeur de langue, Uderzo -avec toute la fine fleur de l’humour et de l’actorat populaire, notamment de banlieue mais pas seulement, réalisant une ouvre gouailleuse, truculente et irrévérencieuse.
Sauvages libertés avec les mots
Et quand le slam déferle, depuis le Club-Club de Pigalle, à la fin des années 90, mèche allumée par la transe lexicale d’un Saul Williams halluciné6, c’est bien pour ensauvager une parole qu’on croyait morte7 : il s’agit d’une « Sauvage liberté avec les mots » (définition portée par la légende urbaine de ce mouvement, qui tente ainsi de franciser et transformer en acronyme ce terme anglo-saxon, « slam »). Des centaines d’auteurs, puisant dans la poésie française aussi bien que dans les battles d’impros de l’underground hip-hop américain, ou encore dans l’art oratoire africain, se lancent pendant des années dans des joutes verbales au fond de bars enfumés, revivifiant une tradition disparue, celle du Paris des chansonniers écumant les bougnats de mauvaise vie. Un multiculturalisme réussi s’il en est… De Pilote le Hot à Grand corps malade en passant par D’ de Kabal, Abd-Al-Malik, Ruda, Ninanonyme, John Banzaï, Jacky Ido, Nada, Insa Sanné, Félix Jousserand et tant d’autres encore, ce mouvement polymorphe finira par s’institutionnaliser et proposer des concours internationaux. De proche en proche émergent ainsi de multiples joutes et concours, dont Stéphane de Freitas, dans son magnifique « A voix haute », donnera une enivrante image.
Dernier avatar de cet amour de la langue, les « Dictées des cités », initiées par Abdellah Boudour (de l’association Force des mixités, sise à Argenteuil) puis l’écrivain Rachid Santaki. Ces deux là sont parvenus pendant longtemps, depuis la cité Picasso jusqu’au Stade de France, à Saint-Denis, à faire descendre des centaines de jeunes de leurs tours pour leur faire se saisir d’un stylo afin, sur des tables en plein air, de rédiger telle dictée à partir d’un texte du Petit Prince … Comment ? En les faisant s’asseoir aux côtés du rappeur local Mac Tyer ? En leur promettant de remporter le cadeau de la victoire : une paire de « Victorieuse » (Nike) Air Jordan -octobre 2013 ? Pas sûr. Qui sait… Tout est une question de style, mais l’improbable peut donc se cultiver sur le bitume et fleurir grâce à quelques mots et quelques signaux bien troussés, là est l’essentiel.
N’oublions pas non plus ce que le cinéma donne à voir de ces formes d’expression aussi vives que convulsives, qu’il soit parfois décrié comme celui d’Abdelatif Kechiche (« L’esquive », qui bouscule et rejoue Marivaux), ou lorgne du côté de la fable street la plus météoritique (« Rengaine », de Rachid Djaïdani). Ce dernier, poète lunaire, qui est aussi écrivain (« Mon nerf »…), nous rappelle surtout que dans l’effervescence de cet art urbain, la littérature tient une place de choix : qu’il s’agisse de la relecture du Petit Nicolas par Mabrouk Rachedi (« Le petit Malik »), du succès inédit de Faïza Guène (400 000 exemplaires vendus pour le très frais « Kiffe kiffe demain », traduit en 26 langues), du flippant Zone cinglée (de Kaoutar Harchi) ou de l’ironique et documentaire « Debout – payé » (de Gauz), sans oublier le succès académique d’Alain Mabankou (Verre cassé), triomphalement reçu par le public lors de sa leçon inaugurale au collège de France en 2016, les cultures urbaines finissent même par s’affirmer en collectif d’écrivains des banlieues (« Qui fait le France ? », en 2009). Ultime consécration ? Les séminaires linguistiques sur « La plume et le bitume » pendant des années à l’ENS…
Cette consécration qui ne vient pas de nulle part, elle s’appuie sur une expérience du quotidien, parfois tragique, qui rend les mots aussi urgents qu’importants ; des mots tranchants comme des lames mais aussi des antidotes ou des élixirs. En témoigne cet échange, au lendemain des émeutes de 2005 :
Journaliste : « Vous dites souvent que le propre de la génération de vos parents, c’était de courber l’échine. Quel est le propre de votre génération ?
Jamel Debbouze : Lever l’échine.
Journaliste : Et de la nouvelle génération ?
Jamel Debbouze : Brûler l’échine.
Roschdy Zem : Et le jour où l’échine s’éveillera… »8
La France bigarrée et populaire aime sa langue, et cette déclaration d’amour sous forme de révolution culturelle permanente vaut tous les Goncourt du monde. La France, on l’aime ou on la quitte, le Français, on l’aime ou on le kiffe.
- 1- Interview dans Notre Île n°65, "De Jean Vilar à Alakiss Vilar"
- 2- Voir Sur la tombe de ma mère, éds. Don quichotte
- 3- Natures en pagaille
- 4- Propos recueillis par Emmanuel Marolle, in Le Parisien du 1er août 2016. Lexik des cités, édité en 2007, avec le concours du rappeur Disiz la peste.
- 5- Marc Hatzfeld, in « Le culture des cités », p. 39. On p- Entretien avec Laurent Bouneau : « Je ne m’en cache pas, il y a eu la loi sur les quotas de chanson d’expression francophone (…) Quand en 1996 on décide de jouer du hip-hop, on envoie un message aux producteurs : vous pouvez produire du rap, vous avez un mass média pour le diffuser (…) Cela a ouvert les portes. Il y a eu des sigourrait citer aussi Rabelais !
- 6- Voir le film « Slam » de Mark Levin, en 1998
- 7- Et dont devraient peut-être s’inspirer une bonne partie de la classe politique, qui ne sembla jamais prendre au pied de la lettre, si l’on ose dire, l’alerte de Manuel Valls : « La langue politique est devenue une langue morte ».
- 8- Entretien accordé au Nouvel Obs du 28 septembre 2006