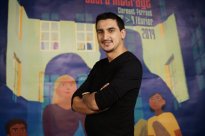RÔLES MODÈLES : POURQUOI ON EN A ENCORE BESOIN

Apparue dans la culture anglo-saxonne, la notion de ‘rôle modèle’ est attribuée au sociologue Robert K. Merton qui la définit comme « une personne dont le comportement, l’exemple ou le succès est ou peut-être une stimulation pour d’autres personnes ».
Le sujet est souvent revenu dans les débats sur les inégalités sociales, mais également au sein de différents mouvements féministes qui soulignent l’importance pour les femmes de disposer de modèles féminins pour pouvoir se projeter, à l’image de Gisèle Halimi ou de Simone Veil, qui ont su inspirer des générations entières.
Si certains trouvent ce concept enfermant, il est rendu nécessaire par une réalité propre à la structure même de notre pays, où la mobilité sociale est extrêmement limitée. Pour Jules Naudet, sociologue : « La France serait un pays déchiré entre l’attachement aux principes égalitaires d’un côté, et le maintien de formes de distinction héritées de sa tradition sa aristocratique de l’autre ». (Source Cairn)
C’est face à ce constat que structures, collectifs et individus se sont lancés dans la démarche d’être ou de fournir des ‘rôles modèles’ à ceux qui en auraient besoin, là où leur présence pourrait faire la différence.
Info, réseau, confiance : le trio manquant
Un constat est à l’origine de la création d’associations : c’est bien souvent le manque de trois éléments clés qui freine les jeunes dans leurs ambitions.
En premier lieu, c’est le manque d’information qui pose problème : quels diplômes, pour faire quoi ? Qu’est-ce qu’une classe préparatoire ? A quoi servent les études longues ? Autant de questions qui restent souvent non abordées, car les parents n’y ont pas été confrontés, n’ont pas la réponse ou le réseau nécessaire pour fournir des outils ou des contacts. Comment se projeter dans une réalité qui n’existe pas dans son environnement proche ?
Vient ensuite la problématique du réseau, qualifiée de capital social par le sociologue Pierre Bourdieu comme « l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées d'interconnaissance et d'interreconnaissance ». Bénéficier de conseils pertinents, trouver facilement un stage ou un premier emploi constituent autant d’embûches pour un.e jeune adulte.
Vient enfin le dernier point, qui n’est pas des moindres, à savoir le manque de confiance en soi. Un sentiment qui peut avoir une incidence très concrète : l’autocensure dans ses projets et ses envies. Tandis qu’elle reçoit le César du meilleur court-métrage pour Maman(s) (2017), la réalisatrice franco-sénégalaise Maïmouna Doucouré déclare en ce sens : « Vous savez le jour où j’ai dit à ma mère que je voulais faire du cinéma, elle m’a dit : ‘C’est pas pour nous. Est-ce que tu vois des gens qui te ressemblent ? ‘. Aujourd’hui, Maman j’espère que j’ai réussi à te prouver le contraire, parce que nous aussi on a besoin de se raconter et d’exister sur les écrans du cinéma français ».
Les limites de l’école comme rempart contre les inégalités
Il semble que la France soit dans un déni quant aux limites du système scolaire « on ne se rend pas compte que notre pays est dans le dernier quart des pays de l’OCDE (et dans le classement PISA, ndlr) et qu’il faut six générations pour sortir de la pauvreté en France », insiste Benjamin Blavier, co-fondateur d’Article 1, une association de lutte contre l’inégalité des chances.
Cet attachement fort à l’école républicaine qui donnerait sa chance à tous de façon égale est une illusion rendue possible par les « exceptions consolantes ». Soit ces jeunes issus de milieux sociaux précaires qui font des carrières brillantes et sont utilisés comme illustration du bien-fondé de cette pensée. Car si l’école fournit un accès à l’éducation pour tous, elle ne permet pas, à elle seule, de palier à toutes les formes inégalités.
C’est quelque chose que Laure, 28 ans, constate dans son engagement au sein de l’association parisienne Accueil Goutte d’Or. Française, d’origine malienne, elle consacre deux soirées par semaine à accompagner durant deux heures un groupe de dix jeunes (du primaire au collège), pour de l’aide aux devoirs. « La vie scolaire est constamment perturbée par la vie quotidienne. Ils ont du mal à se concentrer, car ils ont une convocation au tribunal, un membre de leur famille incarcéré ou encore plein d’autres raisons ».
« C’est un truc de Babtou ça ! ».
Lucide, elle constate : « C’est sûr que le fait que je sois noire font qu’elles me jaugent, veulent savoir d'où je viens, qui sont mes parents… ça ouvre le dialogue sur beaucoup de sujets : les mecs, l’islam, le coran. Les filles et les garçons dans ces quartiers n’ont pas du tout les mêmes problématiques, c’est très genré ».
Si Laure est présente pour l’aide aux devoirs, elle concède que ce n’est pas franchement central dans son lien avec les jeunes : « C’est le prétexte du lien avec l’école, avec la responsabilité. Cela permet surtout de les sortir de chez eux, de les mettre en contact avec d’autres personnes qui ne viennent pas de leur quartier et d’ouvrir une vision sur des choses qu’ils ne voient pas au quotidien ».
Quand ils cherchent un stage, c’est dans une boulangerie ou dans un hôpital. Alors, quand elle leur raconte qu’elle travaille dans le milieu artistique (à la Philharmonie de Paris, ndlr), ils rient. « C’est un truc de Babtou, ça ! ». Ils trouvent ça « cool », mais n’imaginent pas que ça peut leur arriver.
L’accompagnement va bientôt au-delà de l’aide aux devoirs. Il s’agit de corriger une lettre de motivation, d’encourager, d’établir un lien avec les parents, d’organiser des rencontres avec des professionnels qu’ils n’auraient pas rencontrés dans un autre cadre, de trouver des parcours de stage et de faire bénéficier de son réseau.
« On veut que la société soit face à ces jeunes qui chamboulent les stéréotypes »
Guidée par les valeurs de justice, d’égalité, de fraternité et de liberté Article 1 œuvre à grande échelle pour « une société où l’orientation, la réussite dans les études, et l’insertion professionnelle ne dépendent pas des origines sociales, économiques et culturelles ».
Son co-fondateur, Benjamin Blavier, admet que ce projet repose sur une partie de son histoire personnelle : issu d’un milieu relativement modeste, il constate vite que l’école autorise une ascension sociale extrêmement limitée.
Lorsqu’il accède à la fonction de DRH dans une grande entreprise française, sa volonté d’embaucher des personnes à l’image de la diversité de la société se heurte à la réalité. « Plus on monte dans la hiérarchie à la recherche de profils hautement diplômés, plus la diversité se réduit », insiste-t-il. Benjamin Blavier décide donc de remonter à la source, s’inspire des initiatives mises en place par Richard Descoing à Sciences Po (les Conventions Éducatives Prioritaires notamment, ndlr), bien que leur mise en place n’ait pas engendré de changements systémiques.
Son but : diversifier les visages de la réussite. Il créé tout d’abord Passeport Avenir, puis fusionne avec Frateli - autre structure entendant rétablir l'égalité des chances - pour créer Article 1. Via leurs programmes de mentorat et d’ateliers développés avec les écoles, ils touchent aujourd’hui plus de 12.000 élèves et étudiants issus de milieux modestes. « On veut que la société soit face à ces jeunes qui chamboulent les stéréotypes ».
La moitié des jeunes sont « recrutés » via des partenariats qui sont mis en place entre leur établissement grâce à des enseignants référents et Article 1. Les professeurs signalent les jeunes qui ont du potentiel. Interrogé sur la définition de potentiel, Benjamin Blavier reconnaît : « le potentiel c’est une notion dangereuse, c’est pour ça qu’on travaille beaucoup sur les compétences transversales. On doit être capable de décrire, d’expliquer, de développer des soft skills (compétences comportementales, humaines ou encore transversales, ndlr) utiles. On leur apprend à voir qu’ils ont développé des compétences, parfois sans s’en rendre compte ».
La réussite en question
Selon les milieux, la réussite ne renvoie pas à la même chose. Dans le secteur artistique par exemple, il est plus rare que les connexions des parents soient en relation avec la carrière de leurs enfants. Les codes et circuits économiques du marché de l’art nécessitant temps et relations pour être décodés.
C’est pour répondre à cette problématique que Flora Fettah a participé à la création des Contemporaines, avec le programme Passerelles qui se présente comme un marrainage artistique. Sur leur plaquette on peut lire : « Contemporaines aspire à décloisonner l’art actuel en s’engageant dans une lutte contre la minoration, la discrimination et l’invisibilisation des artistes femmes, et les discriminations liées au genre dans le champ des arts visuels ».
Car oui, réussir a des significations diverses. Elles ne se limitent pas à faire Polytechnique ou l’ENA. Le diplôme, même s’il reste un moyen d’acquérir une certaine forme de liberté, ne mène pas toujours à la réussite, notion qui relève bien plus de la sphère de l’intime.
Un grand nombre de jeunes ayant bénéficié des programmes d’Article 1 ont d’ailleurs engagé une réflexion sur la question de l’utilité commune comme chemin de traverse vers la réussite. « On vous a donné les armes, les codes, vous êtes à la frontière des mondes, emparez-vous en ! », les encourage Benjamin Blavier
Car oui réussir, c’est peut-être davantage avoir tous les outils en main pour être libre de son imaginaire. Pour façonner, à sa façon, le chemin qui fait sens, sans y être entravé. Et dans cette approche, nul ne pourra nier qu’avoir un modèle en vue permet de gagner du temps !