
Printemps songeur à Sevran
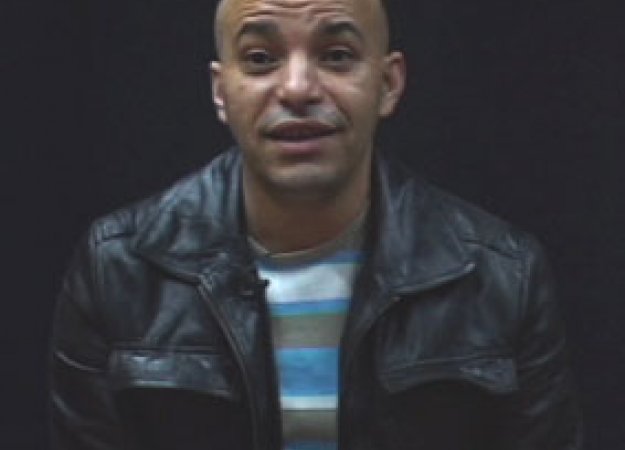
Au quartier Rougemont, à Sevran, face à la bibliothèque, il y a des parkings entre les barres, et des jeunes qui palabrent autour de leurs voitures, sous le soleil. A l’ombre, dans la petite salle de projection de la bibliothèque, une trentaine de femmes, surtout des mères de famille, sont venues voir le résultat de cinq ans de travail, dont trois ans de vidéo... sur la ville et sur elles. Elles se voient, reconnaissent les ami(e)s, les lieux, se bidonnent, entre deux « oooh ! » et trois « aaaah ! » de satisfaction. Premier épisode d'une série de reportages dans le cadre d'un partenariat avec le printemps de la mémoire.
Souvenirs, souvenirs…
En 2006, Karim Yazi, acteur de son état et co-fondateur du Kygel théâtre, commence un travail sur la mémoire. Des vidéos, huit au total, vont être tournées (par Laure Poinsot) comme des petits reportages thématiques (« Exils, exodes, errances », « Cette folle aventure de l’urbanisme », « Espaces collectifs, partage et convivialité »…). Leur matière première : le témoignage de sevrannais sur leur ville, leurs souvenirs, leur identité, l’exil. Une parole pleine d’émotion, de douceur, pour une ville qui est pourtant brûlée par les médias, du fait d’une situation sociale difficile et des faits divers qui en découlent. Tout cela aboutit à un travail diffusé dans le cadre du Printemps de la Mémoire : « La banlieue en héritage ». Les images défilent : scènes de chœur antillais et africains dans une église, image de marchés, photos d’archives de Sevran à l’époque où il y avait une ferme et des champs, et même pas encore les usines (elles ont fermé depuis), interview de Youssef Khahali, jeune chanteur plus si jeune mais déjà nostalgique, regrettant l’univers des halls où il a tout appris, la danse, la chanson et même à embrasser les filles… Bref, quelques instants d’une vie quotidienne à la fois douce et légère, de gens qu’on ne voit d’habitude à l’écran que pour les dénigrer.
Pourquoi toujours le passé ?
Pourquoi ces questions autour du passé, de la mémoire, si souvent dans les quartiers ? Pour Fatima Hamdi, responsable de Rougemont solidarité, l’une des associations qui a été la cheville ouvrière de ce travail en allant chercher une bonne partie des habitants qui témoignent, « on interroge ce qui nous manque. L’isolement est une difficulté, c’est pour ça qu’on parle de l’humain. L’urbain, c’est fait, c’est derrière nous…» Pas toujours, en fait : ici, tout le quartier est en rénovation. Les bailleurs de logements, dans ces situations, cherchent l’adhésion des populations. Et du coup, font naître une parole. Les associations locales qui, à l’instar de divers Collectifs anti-démolition, ne s’opposent pas frontalement à ces opérations au motif qu’elles sont, comme depuis toujours, faîtes sur le dos des habitants, sont sollicitées pour accompagner les projets. « Nous faisons le médiateur entre les habitants et les bailleurs », note Mme Hamdi. « Il faut réconcilier l’humain et l’urbain » reconnaît de même l’une des invitées au débat. Et il y a du boulot : 60% des résidents des immeubles détruits souhaitent être relogés dans le même quartier. Un chiffre que ne comprendraient pas bon nombre d’urbanistes, d’hommes politiques et de journalistes qui se gargarisent avec la « mixité sociale ». « C’est ici qu’on a nos racines ! » clame telle habitante. Mais « vous n’auriez pas envie de replanter vos racines ailleurs, à Paris, par exemple, si on vous le proposait ? » s’interroge tout sourire Mohammed Ouaddane, porteur du projet Printemps de la Mémoire et animateur du débat. La réponse fuse : « Jamais de la vie ! A Paris ? Je ferai quoi là-bas ?! Mon travail est à cinq minutes d’ici ! La reconstruction, c’est pas notre problème ! » Du coup, les relogements se font souvent bon gré, mal gré, même s’il y a parfois des « négociations possibles, à la marge, pour quelques cas », tempère l’une des invitées.
« Ici, on discute »
Mais la question persiste : comment comprendre tous ces « nous, nos jeunes, on n’a pas de problèmes avec eux », qui constellent le débat, quand tant de faits tragiques se produisent pourtant ? L’un des invités, un vieux monsieur qui se présente comme conteur, constate avec philosophie : « Celui qui vit les événements même tragiques de l’intérieur ne voit pas les choses de la même manière que ceux de l’extérieur, qui ont peur ». Mais parfois, ceux qui ont peur ne viennent pas de l’extérieur. Mme Hamdi se désole de ne plus trouver la même mixité qu’avant : « les derniers français qui restent votent souvent à l’extrême-droite. C’est qu’ils ne sont pas bien ici. Ceux qui ont de l’argent ne sont plus là, ils partent en pavillon ». Une des mamans invitées insiste : « Je suis née ici en 74, je suis nostalgique de cette période. Avec les nouveaux, il n’y a pas le même lien. Avant, quand un jeune se mariait, tout le monde se mobilisait. » Mais a contrario, d’autres témoignent qu’elles sont revenues. Elles se sentaient isolées, ailleurs. « A Jean Perrin [un des quartiers de la ville qui borde le canal de l’Ourq], c’est chacun chez soi. Ici, on s’assoit, on discute… » Tout le monde n’est pas d’accord. Le calme est parfois recherché, ici ou ailleurs, sans motos. Mais la tonalité dominante reste : on est ici, et on y est bien.
Une chose est sûre, pour Fatima Hamdi : « ce travail de mémoire motive les gens. Il y a une fierté à se voir comme ça. Ce travail-là n’a rien à voir avec ce que peut faire Luc Besson à Clichy ! » Un euphémisme…
Erwan Ruty
Une pièce sera tirée de ces témoignages : « Ca brûle ». Par Kygel théâtre, qui travaille depuis 15 ans dans les « banlieues pauvres».



