
Patrimoine de banlieue : pas d’oxymore
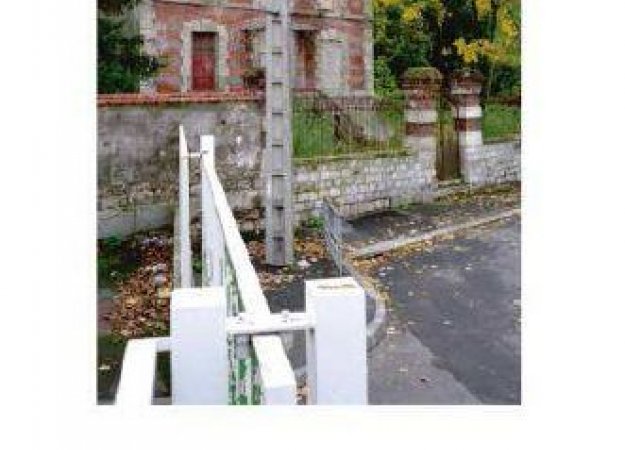
Le patrimoine de banlieue existe-t-il ? Telle était la question que se posaient élus de banlieue, chercheurs, conservateurs de musées et autres acteurs institutionnels lors d’une journée d’étude organisée début 2010 à l’écomusée du Val-de-Bièvre. Aujourd’hui, en publiant les actes de la journée, le musée veut faire profiter de ces échanges ceux qui s’intéressent à cet objet, complexe, en évolution permanente, qu’est la banlieue. Le principal intérêt : le fait que la question se pose.
En effet, la démarche s’attaque à l’idée qu’associer les notions de patrimoine et de banlieue ne va pas encore de soi : la première renvoie à "un ensemble de biens matériels qu’à un moment donné un groupe choisi d’extraire et préserver parce qu’il estime qu’ils constituent un gage de son identité dans le temps". La seconde est celle d’un lieu mis au ban, vu comme une sorte de « soute » de ce qui se fait en ville, là ou dorme les employés et les femmes de ménage pour se remettre du travail.
La banlieue est aussi le lieu où doit se faire la jonction entre les lieux de la grande histoire (la basilique de Saint-Denis, diverses fouilles gallo-romaines) et des lieux longtemps considérés comme a-historiques (les grands ensembles, les villes nouvelles) car trop récents ou « sans qualités ». C’est également un territoire de passage, où les familles ne restent rarement sur plus de trois générations, d’où la difficulté de définir des « identités » qui durent dans le temps.
Ce n’est pas un hasard si cette journée d’étude s’est déroulée au deuxième écomusée de France. Dans ce type d’institutions, dont la participation est un des principes fondateurs, objets du quotidien, tranches d’histoire personnelle, expression artistique, habitat et métiers sont pris en compte pour souligner et valoriser un patrimoine local. La petite histoire, celle du « tu te souviens ici il y avait… » prend le relais dans les territoires délaissés par la grande histoire. La participation des habitants et leur mémoire recueillie par des associations (comme Trajectoires spécialisée dans la mémoire des quartiers populaires et de l’immigration) s’avère alors essentielle dans la définition « par le bas » d’un patrimoine.
En filigrane de la journée d’étude se profilent les enjeux de la politique de la ville et de ses cloisonnements axés sur la redéfinition des territoires et des patrimoines dont ils sont titulaires. Les échanges permettent une approche distanciée de l’idée du Grand Paris, plus ancienne qu’il n’y parait. La patrimonialisation apparait alors comme le fruit des politiques publiques, de décisions à l’époque d’Haussmann ou encore lors de la redéfinition des départements d’Ile de France en 1964.
Parmi les risques de la démarche, celui de développer un « patrimoine du pauvre », « au rabais ». Celui aussi du message « vous êtes bien là », qui ferait du patrimoine un instrument de maintien en périphérie et donc en subordination.
Ces Actes, faits d’interventions aussi diverses que denses, ne sont sans doute pas l’ouvrage idéal à bouquiner sur la plage, mais ceux qui veulent prendre du recul et nuancer leur réflexion sur les banlieues peuvent y faire de bonnes pioches.
YT
Ouvrage disponible sur demande à l’écomusée du Val de Bièvre (41, rue Maurice Ténine - 94260 Fresnes - Tél : 01 41 24 32 24)



