
Le creuset français : toute une histoire
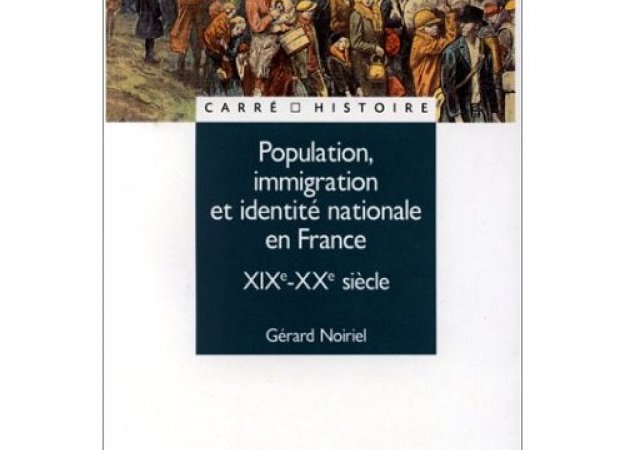
Le 18 mai 2007, avec sept autres historiens, Gérard Noiriel démissionnait de la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration pour protester contre l’« inacceptable » instauration du Ministère de l’Identité Nationale (officiellement, Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire). L’historien expliquait en 2007 les raisons de sa démission à travers le livre A quoi sert l’identité nationale qui reprend la réflexion de Population, immigration et identité nationale en France, ouvrage qu’il avait écrit en 1992. Il associe à sa discipline des enseignements du droit, de la science politique et de la sociologie pour montrer à quel point les notions d’identité nationale et d’immigration sont largement imbriquées en France.
La définition de la Nation : un enjeu de luttes politiques
Dans la lignée du Contrat Social de Rousseau, la Révolution Française va appréhender la Nation comme l’ « association volontaire entre citoyens égaux ». Puis, effrayés par les classes populaires, mises à mal par l’industrialisation et ses premières crises, les Républicains conservateurs en reviennent à une identité nationale « essentialisée » autour du fameux mythe « Nos ancêtres les Gaulois », par opposition à l’ascendance franque revendiquée par les royalistes. Enfin, avec la centralisation française esquissée dès l’Ancien Régime et parachevée par la République, la Nation se confond progressivement avec l’Etat défini par le droit et implanté sur tout le territoire via l’administration.
Il faut un « nous » pour faire « les autres »
Avant qu’un discours xénophobe opposant les étrangers -eux- aux nationaux –nous- puisse avoir une portée politique, il a fallu tout un travail d’unification nationale. Une enquête officielle à la fin du second empire (1870) montre que dans prêt d’un quart des communes, la population ne parle toujours pas le français. Sans compter d’innombrables patois locaux, 7 langues plus ou moins codifiées coexistent en France : l’allemand, l’alsacien, le breton, le basque, l’occitan et le corse. L’unification va d’abord se faire pour les élites de villes avant que les réseaux ferroviaires et routiers, le franc comme monnaie unique et surtout l’école républicaine ne touchent l’ensemble des masses populaires dans les campagnes. Il faudra plus d’un siècle pour que l’assimilation républicaine ne soit plus une utopie. Dans les années 1880 toute une génération va, via l’école, assimiler des notions nouvelles déconnectées du contexte local. Les patois et proverbes locaux vont être remplacés par le français et les proverbes appris à l’école et l’histoire de France va remplacer les histoires locales.
L’Amérique de l’Europe
Le livre de Noiriel enlève tout sens aux expressions « Français de souche » et « Français issus de l’immigration ». L’auteur affirme en effet que la France, qui se caractérise par l’extrême diversité de sa population, peut être considérée comme « l’Amérique de l’Europe ». Il rappelle qu’en 1986 environ 20% des personnes nées en France avaient au moins un parent ou un grand parent ayant immigré au cours des cent dernières années. Et qu’en dépit du baby boom, l’immigration a fourni plus de 40% de l’augmentation de la population française depuis la seconde guerre mondiale. Alors que jusque là l’immigration s’est faite de manière spontanée, à partir de la fin du XIXe siècle va apparaître le « modèle français d’immigration » avec la mise en place d’une législation de l’immigration. Avec la politique de protection des frontières, c’est dorénavant l’Etat, en concertation avec le patronat et en fonction des besoins de main d’œuvre, qui vont gérer les flux migratoires. L’auteur estime ainsi qu’en France l’immigration a eu un impact plus important qu’aux Etats-Unis, où elle est moins continue, et plus irrégulière.
Le poids porté par l’immigration
L’immigration, d’abord européenne (Belges, Polonais, Italiens, Espagnols, Portugais…) puis venue des colonies (Maghreb, Afrique noire…), parfois même recrutée dans les pays d’origine, est sollicitée pour répondre au manque de main d’œuvre dans une période de fort dynamisme économique en France. Le grand patronat fait d’ailleurs preuve de paternalisme en prenant en charge le recrutement massif et le logement des immigrés dans des cités-usines. Pour Gérard Noiriel, ce sont d’abord les paysans des provinces françaises puis les immigrés qui, en plus de la xénophobie, ont dû supporter la plus grande partie des effets négatifs de l’industrialisation : déracinement massif des travailleurs, accidents du travail : « ce sont les immigrés qui ont payé le prix fort pour que le pays puisse réussir sa mutation industrielle sans que les citoyens en payent totalement le prix ».
Assimilation et mobilité sociale
La question de l’intégration des immigrés se pose seulement à partir de l’entre-deux-guerres, quand l’intégration des classes populaires se réalise. Gérard Noiriel estime d’ailleurs que l’assimilation des immigrés repose sur les mêmes principes que l’assimilation des diverses composantes de la société française : alors que la première génération ne fait que s’intégrer économiquement, l’assimilation concerne la deuxième génération, celle qui effectue ses premiers apprentissages dans le pays d’accueil. A certaines conditions toutefois : pour que l’assimilation soit effective, il faut que la communauté ne soit pas fermée sur elle-même (comme dans les cités où habite une seule communauté). Contrairement aux idées reçues, plus que la nationalité d’origine, ce sont les lieux géographiques et professionnels qui déterminent la réussite sociale. Le degré d’intégration, qui varie selon plusieurs critères objectifs (mobilité sociale, naturalisations, mariages mixtes…), est fonction de l’ancienneté de la présence de la communauté.
Conclusion
L’étude historique de l’identité nationale montre aussi que ce sont dans les périodes de crise qu’ont été adoptées des conceptions nationalistes tournées vers les « ancêtres » et le passé. On peut regretter que l’ouvrage ne traite pas la question coloniale, qui influe forcément sur l’intégration des immigrés Nord-africains et subsahariens. D’autres chercheurs, comme Pascal Blanchard, se sont d’ailleurs davantage penchés sur cet aspect. Le livre illustre cependant très bien que pour des raisons historiques et de situation géographique, la société française est par essence métissée et ouverte sur le monde. Le gouvernement annonçait ainsi récemment qu’avec 27% d’unions entre français et étrangers la France a le plus fort taux de mariages mixtes en Europe.
YT



