
Cinéma et quartiers populaires: stéréotypes contre tribunes libres
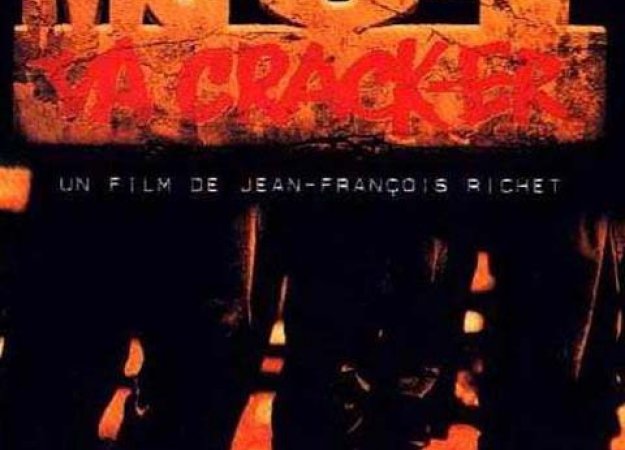
Alors que le Festival de Cannes ouvre à nouveau ses portes, retour non-exhaustif sur les relations ambiguës entre Septième art et quartiers populaires en France.
Si les banlieues et les faubourgs ont toujours été présents au cinéma, il faudra attendre la seconde moitié du XXe siècle pour voir ces territoires s'imposer à l'écran comme un sujet spécifique. Avec la restructuration profonde de ces zones périphériques, ces utopies d'architectes s'annonçaient comme de véritables phalanstères, avant de montrer leurs limites et leur vrai visage en tant que zone de relégation. Symboles d'un confort moderne qui ne tient pas ses promesses, les grands ensembles riment alors de plus en plus avec ennui, tension, violence et discrimination.
Les années 80, avec les espoirs déçus de la gauche au pouvoir, annoncent un virage déterminant: « la banlieue » est un espace morne et moribond. Filmer ce décor immuable devient un exercice de style pour des récits de vie où le réalisme est raison d'être. Même au cinéma, on n’a pas le droit de rêver en banlieue...
Les années 70 : Envie de fuir, déjà, le nouvel habitat urbain
En 1973, Claude Zidi réalise Le Grand Bazar, avec la troupe des Charlots. Ce nanar n'est pas aussi anodin qu'il n'y parait. Il montre sans la banaliser la médiocrité du nouvel habitat urbain, annonçant la crise et le chômage de masse pour les habitants de quartiers dont la déshumanisation ressemble à l'arrivée d'un grand centre commercial, écrasant le petit commerce et le lien social qu'il symbolise. D’ailleurs, en 1974, Les Valseuses commencent par la fuite de Jean-Claude et Pierrot d'une banlieue sordide, faite d'aspirants à la micro-bourgeoisie, prêts à tirer à vue en cas de danger pour leur propriété. Et la même année, Dupont-Lajoie, d'Yves Boisset s'achève en ville, après un immonde été meurtrier sur le lieu des vacances... La banlieue comme terre bien réelle, où, enfermés dans leurs frustrations jusqu'à l'heure des règlements de comptes, les relégués se retrouvent, du beauf au travailleur immigré. Quand ils ne tentent pas de la fuir.
Fin des années 80 : le bilan des années Mitterrand
De bruit et de fureur, en 1988 (réalisé par Jean-Claude Brisseau), raconte le retour à Bagnolet de Bruno, rêveur lunaire de 14 ans, et sa rencontre avec Jean-Roger, petit caïd du collège qui l'initie à la violence et à la dureté du quartier. La rencontre de ces deux contraires n'empêche pas leur destin tragique : Jean-Roger assassine son père et finit à Fleury-Mérogis, Bruno se suicide, désespéré par l'absence de sa mère.
Un an après, en 1989, Colline Serreau emmène Daniel Auteuil, archétype du gendre idéal, en cité, avec Romuald et Juliette. Cette fois-ci, l'histoire et belle et finit bien. Comme souvent chez la réalisatrice, le cinéma décrit un idéal. Juliette, incarnée par Firmine Richard, femme de ménage des bureaux d'une société dont Romuald (Daniel Auteuil) est le P.D.G., vient en aide à l'insensible et trop puissant patron en l'aidant à déjouer un infâme complot. L'amour s'en mêle, nous offrant un Pretty Woman bien de chez nous, l'antiracisme remplaçant le glamour. Plein de bonnes intentions et de clichés, ce film montre les limites d'un certain cinéma bien-pensant qui sentimentalise la réalité sociale.
Années 90 : « L'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage »
Sous l'influence de la culture Hip Hop, le propos change de ton. Influencé par le cinéma américain du ghetto (Menace 2 Society, Boyz’N’The Hood), Matthieu Kassovitz assène une véritable gifle à la société française avec La Haine (1995), phénomène de société qui affiche en noir et blanc la réalité des ghettos français. Un projet musical parallèle sortira en tant que compilation réunissant le panthéon du rap hexagonal. Visuel et poétique, le film fait du banlieusard le héros des tragédies contemporaines.
Ma 6-T va crack-er, en 1997, réalisé par Jean-François Richet, lui répond avec encore plus de rage, refusant le parti pris esthétique pour tout emporter sur le terrain politique. Alors que la Haine commençait au lendemain d'une émeute, il s'agit cette fois-ci de suivre la montée en pression d'un quartier jusqu'à son explosion insurrectionnelle : « La solution est la sédition: révolution! ». Il n'est plus question de fatalité. Il n'y a qu'un ennemi bien connu, identifié et visé: l'État, Léviathan pervers au service de la bourgeoisie capitaliste. Même si la lutte est désespérée, elle reste la seule chance de rédemption. La bande originale réunit à nouveau la fine fleur de la communauté hip hop française pour un opus aux allures d'appel à la révolte.
Aujourd'hui : la culture comme remède au pire qui se dessine ?
Au début du XXIe siècle, le triptyque cité – école – racisme se décline avec L'Esquive (2003), d'Abdelatif Kechiche, dans lequel Krimo, petit rebeu sans charisme enlisé dans la banalité d'un quotidien sordide, tombe sous le charme de la volubile Lydia, jouée par Sara Forestier. À l'école, les élèves découvrent Le jeu de l'amour et du hasard, de Marivaux. Les réconciliant ainsi avec la culture française classique, ce film présente la banlieue comme un espace où la culture peut encore être un baume. Loin des polémiques des deux films précédents, il est reconnu par le milieu avec une unanimité rare. Après Entre les Murs, Palme d’Or à Cannes en 2008, Nous, Princesse de Clèves, film documentaire de Régis Sauder sorti en mars 2011, réactualise le débat en le déplaçant à Marseille. Reprenant une citation du président Sarkozy dans son titre, ce film, dans la lignée de l'Esquive, propose la culture comme terrain d'échange et de rencontre entre des populations si différentes d'un même pays.
Et si cette ultime roue de secours ne fonctionnait pas ? Le contrepoint vient, en 2004, de Banlieue 13. Luc Besson produit et coécrit ce blockbuster n'ayant peur d'aucune outrance, réalisé par Pierre Morel. Nous voici plongés dans la périphérie du Paris dans un futur très proche. Comme dans le film d'anticipation New York 1997 (Escape from New York), un super-flic est lâché dans un territoire hostile digne de Mad Max où la seule loi est celle des gangs. Pour parvenir à ses fins, il est aidé par Leito, indigène de la Banlieue 13, quartier terrifiant ne portant même plus de nom. Un buddy movie prophétique? Définitivement, traiter des quartiers populaires au cinéma ne semble pas pouvoir s’affranchir des enjeux idéologiques. Stéréotypes contre stéréotypes, il s'agit toujours de trouver les causes d'un désastre social. À se demander si la véritable audace ne serait pas d'en faire simplement le décor naturel d'une histoire d'êtres humains...
Eddy Maaroufi



