
Gentrification : mixité sociale ou « entre-soi » ?
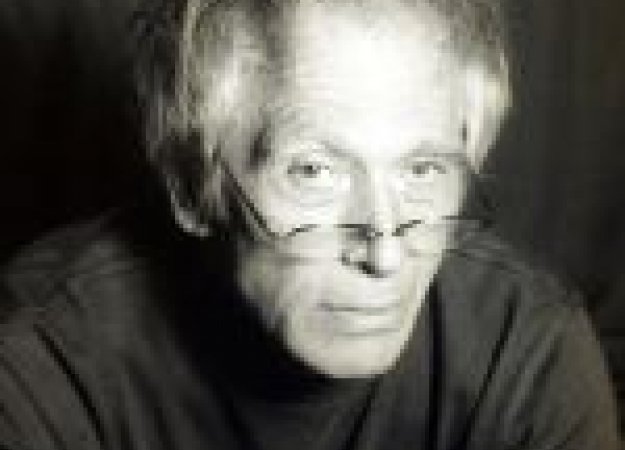
Les bobos qui débarquent dans les quartiers populaires pour acheter moins cher, ça a un nom : la gentrification. Qu’est-ce qui motive les « gentrifieurs » à s’encanailler avec la plèbe ? Comment se passe la rencontre avec les classes populaires qu’ils trouvent dans leur nouveau quartier ? Amènent-ils avec eux un mode de vie plus écolo ? Entretien avec le sociologue et historien Jacques Donzelot, spécialiste de l’urbain et « importateur » du terme gentrification en France.
Comment s’est développé le processus de gentrification en France ?
Le mot a été inventé en Angleterre dans les années 60, il correspond au déplacement de la petite noblesse –gentry- vers les villes. En France il désigne une réalité différente. A partir de 75 ou de 80, les opportunités d’emploi commencent à diminuer quand on est diplômé. C’est l’apparition d’une population qui va se chercher dans la réalisation de soi comme créateur, dans le domaine de la fiction, de la création picturale, dans le journalisme. Cette population-là, qui va avoir un peu d’argent, mais de manière irrégulière, va chercher à rester près des opportunités d’emploi, conjugales, de plaisir et elle va créer un climat, revaloriser la ville d’une certaine manière.
Et on a en même temps les cadres des firmes mondiales veulent pouvoir bénéficier des spectacles et des commodités du centre-ville.
Pour qu’on parle de gentrification il faut qu’on retrouve tout : les plaisirs, pouvoir se rencontrer facilement entre gens du même genre. Il y a une part de segmentation aussi : à Montreuil par exemple on a les intellos précaires, les journalistes free-lance. Dans le bas Montreuil, on a l’impression d’une bohème, des gens qui se retrouvent entre eux, tout contents.
Qu’est-ce que ça implique en termes de mixité sociale ? On pourrait penser que les « gentrifieurs » sont issus d’une classe moyenne qui ne rechigne pas à se « frotter » aux classes populaires.
Non, ils ne désirent pas vraiment s’y frotter. C’est très flagrant dans tous ces arrondissements de l’est et du nord parisien où on voit par exemple les classes aisées qui achètent parce que c’est moins cher. Il n’y a pas de conflit déclaré, il y a une proximité plus ou moins tolérante.
On associe souvent les gentrifieurs aux « bobos » éduqués et écologistes. Quel est l’impact social de l’écologie et du développement durable ? Profitent-ils à tous ?
Dans les quartiers centre, l’aspect écolo, même si des facilitations sont offertes pour rendre l’habitat moins consommateur d’énergie, c’est quand-même plus une option classes moyennes supérieures qu’une option classes moyennes pauvres. C’est un investissement, il faut avoir l’aisance pour le faire, la certitude de son avenir et il faut être propriétaire. Les gentrifieurs se distinguent même souvent par ça. C’est un signal qu’ils envoient au quartier : « moi je prends soin de la planète et de mon environnement, vous, vous êtes un peu négligents, inconscients».
Les éco-quartiers que l’on « vend » dans les quartiers dits défavorisés sont théoriquement réservés à tout le monde. Mais ce n’est pas l’impression que j’ai : un éco-quartier c’est généralement pour attirer les classes moyennes. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas quelques éco quartiers où accèdent d’autres populations. Il ya le maire de Sevran qui fait tout un baratin sur le thème « je suis devenu écolo, moi , ancien communiste, dans une commune qui est le cul de sac du 9-3, parce que la population qui vit dans la commune a le niveau d’eau qui monte dans ses îles [la communauté Tamoule notamment NDLR], donc elle est bien consciente des horreurs du monde. En plus, dans les HLM ils payent une somme faramineuse pour se chauffer. Donc je veux un éco-quartier ». Et il obtient des ronds pour le faire. Mais c’est un cas particulier.
Et en termes de transports ?
La piétonisation, le vélo, le tram…tous les transports « doux » comme on dit sont des éléments attractifs pour ces populations dont l’emploi n’est pas très loin. Ils transforment les villes en remplaçant la voiture et les parkings centraux qui avaient « dévasté » les places. On les libère, on y met des cafés, des restaurants. Des fois ça marche pas, il faut qu’il y ait un certain rapport entre pauvres et riches : si vous allez a Roubaix, la ville la plus pauvre de France, vous avez une place magnifique devant la mairie : des restaurants, des cafés… Ca à coûté de l’argent. Mais le soir, à 8 heures, ils ferment. Quand ils sont propriétaires, leur bien prend de la valeur, ils ont envie de vendre.
Est-ce que les plus pauvres en pâtissent ?
Oui. Les plus pauvres en général ont des emplois en dehors des grandes villes. Sauf les commerçants, mais il faut encore qu’ils puissent se faire livrer. Les restaurants de quartier peuvent en profiter en terme de clientèle. C’est un lien par le commerce. Mais les artisans ne tiennent pas le choc vu le coût du foncier. Sauf s’ils trouvent des créneaux qui correspondent à cette nouvelle population avec des produits qui font « classe ».
Les bobos influencent-ils les classes plus populaires qu’ils rencontrent dans leur mode de vie ? Il y a quand-même des contacts ?
Les bobos quand vous les écoutez en dehors de leurs quartiers, ils se flattent de la population qui avoisine . Ca leur donne l’impression qu’ils vivent dans une ville globale. Mais ça se traduit assez peu par des fréquentations. La méfiance et la gêne sont des deux côtés. Même s’il n’y a pas de frictions énormes. Sauf quand il y a risque sur la valeur du foncier. Il y a une image que certains gentrifieurs renvoient, qui ne correspond pas tout à fait à la réalité : ils ont en général un ami noir ou maghrébin qu’on retrouve quand on va chez eux, qui est témoin, qui montre qu’ils sont bien dans le quartier.
Propos recueillis par Yannis Tsikalakis
La ville à trois vitesses. Editions de la Villette. 2009



