
Le populisme numérique et ceux qui peuvent y répondent
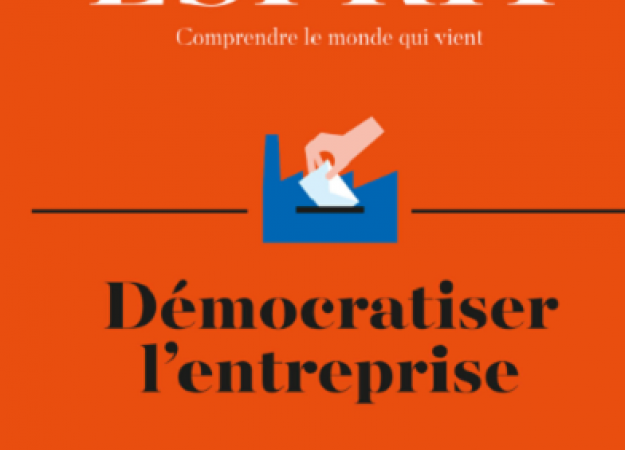
L’exclusion de Rokhaya Diallo et d’Axiom en décembre 2017, du Conseil national du numérique, pose une question : qui est légitime pour réfléchir aux destinées d’une sphère médiatique nouvelle, celle liée aux réseaux sociaux, pour le moins turbulente ? Qui, des « insiders » ou des « outsiders » peuvent-ils le mieux parler aux damnés de la République qui se laissent séduire par le doute puis par les messages de haine qui y sont abondamment véhiculés ?
Car depuis quelques années, un spectre hante les démocraties occidentales : la peur que leurs opinions publiques ne cèdent au déferlement des discours de haine, des « fake news » et des rumeurs complotistes. Des opinions qui se détournent des médias, poumons de démocraties de plus en plus asphyxiées par les réseaux sociaux où prolifèrent ces discours.
Premiers touchés, les jeunes et en particuliers ceux qui, dans les couches populaires, se vivent largement (et souvent à raison) comme laissés pour compte du système. Ces populations sont loin d’être les seules à céder au doute radical qui s’est installé au sujet du bon fonctionnement de la société française. Mais elles sont centrales de par leur nombre et l’importance qu’elles occupent dorénavant dans l’imaginaire national ainsi que dans la production de cet imaginaire (ne serait-que par le biais des cultures urbaines). Et cherchent souvent des messages alternatifs aux grands récits traditionnels.
L’émergence d’un « populisme numérique »
Naguère porteurs de ces grands récits, les médias apparaissent de moins en moins comme des relais d’expression et de dialogue, des « médiateurs » entre les mouvements profonds de la société et les décideurs. En France, il n’y a plus de média fédérant le grand public. L’audiovisuel public ne touche que les populations les plus âgées (autour de soixante ans en moyenne) ; Tf1 ou Canal + ne sont plus les lieux où s’inventent les tendances. Quant à la presse gratuite elle informe certes mais ne représente personne.
Si bien que depuis la fin des années 2000, les opinions publiques sont largement influencées par ces réseaux sociaux : « La sacro-sainte opinion publique n’est plus simplement orchestrée par les médias traditionnels, mais se fait et se défait aussi au sein des réseaux sociaux. Les médias sont désormais des acteurs parmi d’autres, certes plus puissants, mais ils ont perdu le rôle de principal théâtre d’opinion qui était autrefois le leur. Le système politique, du coup, est largement déstabilisé (…) En France, il existe une gigantesque fracture entre les détenteurs du pouvoir et ceux qui sont exclus du champ médiatique. [Ces derniers] ne trouvant pas l’expression de leurs opinions dans les médias, utilisent les réseaux sociaux pour publier et échanger leurs idées (…) »
C’est dans ces limbes, dans ce « clair-obscur » médiatique existant entre un monde éditorial qui s’effondre et un autre qui tarde à venir, que naissent les discours de haine et un véritable « populisme numérique ».
Cas extrême, mais tellement populaire : dès 2015 Dieudonné franchissait la barre du million de fans sur Facebook. Boycotté par les grands médias depuis le milieu des années 2000, l’homme est de tous les réseaux sociaux : Twitter, Instagram, Snapchat... En un an, ses vidéos ont été vues plus de 20 millions de fois sur sa chaîne Youtube, le propulsant, à l’égal de son ami Alain Soral (avec son site Egalité et réconciliation, qui revendique 7 millions de visites mensuelles), parmi les sites « d’information » les plus fréquentés de France. Un succès qui touche la jeunesse « Black-Blanc-Beur » dans toute sa diversité.
Comment alors contrer des discours de haine, lorsqu’ils sont portés par des réseaux sociaux sans ligne éditoriale ?
D’abord en cherchant à identifier d’où ils proviennent et quelles populations ils touchent. Certains s’adressent au public Blanc, pas seulement populaire (dépassant l’équivalent français des « white trash » états-uniens). Ils sont issus de la « fachosphère » née au début des années 2000 à l’instigation de Jean-Yves Le Gallou, activiste d’extrême-droite se revendiquant ouvertement d’Antonio Gramsci et de ses réflexions sur le combat culturel dans la conquête de « l’hégémonie idéologique ». Cette mouvance qui faisait son nid dans les nouveaux médias du web (tout comme Beppe Grillo en Italie) a progressivement dépassé sur leur droite les médias populistes à l’instar des tabloïds britanniques, Fox News (et le groupe Murdoch) ou la Raï et le groupe Médiaset en Italie et a finalement conquis le pouvoir en Russie comme aux Etats-Unis (cf Russia today ou Breitbart news).
La seconde sphère est moins identifiable politiquement, faute de stratégie définie. Elle est plus spontanée. La « journée du retrait » lancée par Farida Belghoul en 2013 (contre les théories du genre qui seraient enseignées à l’école), ou encore les déjà cités Dieudonné et Soral, touchent eux un public beaucoup plus difficile à cerner, aussi bien socialement que culturellement. Mais ce type de réseaux a parfois convergé (en particulier sur la question de l’antisémitisme) vers l’extrême-droite traditionnelle. Ils ont parfois été la première étape d’un effondrement des digues intellectuelles protégeant nombre de populations contre des discours encore plus radicaux, en particulier islamistes. Ces mouvements n’en restent pas moins erratiques et souvent « infra », ou « néo-politiques ». Ils peuvent néanmoins inciter ceux qui y adhèrent à passer à l’action. « [La fracture médiatique] se traduit également par l’incapacité des organisations politiques traditionnelles –partis, syndicats, associations- à fédérer et organiser toute forme de protestation sociale (…) Parallèlement émergent de nouvelles formes de protestation sociale : les « pigeons », les « poussins », les « bonnets rouges »… toutes démontrent que la lutte sociale n’est pas morte et qu’elle réapparaît sur les réseaux sociaux, mais sous des formes éphémères, moins organisées, et bien souvent incapables de présenter aux pouvoirs en place des revendications claires et construites ».
Une fracture médiatique témoin des besoins d’identification des lecteurs, alors que l’opinion publique doute de plus en plus des bienfaits d’une mondialisation libérale qui provoque une destruction des cadres de référence et des structures d’encadrement (partis, syndicats, Eglises, éducation populaire…), renforçant l’anomie et le sentiment de déracinement.
Qui peut le mieux porter la lutte contre le populisme numérique?
Nous sommes entrés dans un univers où domine ce que Pascal Perrineau qualifie de « confiance pour l’en-bas et défiance pour l’en-haut », précisant : « il y a une confiance pour ce qui est proche (…) et considéré comme identique, et une défiance pour ce qui paraît lointain ». Ce qui peut être rapproché du « capital d’autochtonie » dont parle le géopolitologue Christophe Guilluy, soit un retour au local, une démondialisation économique, sociale, politique, un retour au quartier ou au « village » (mesure d’un « small is beautifull » auquel bon nombre de citoyens adhèrent dorénavant) : « Les classes populaires retrouvent un environnement social et culturel, un capital d’autochtonie susceptible de redéfinir un rapport de force avec les classes dominantes ». Pour Guilluy, « la question universelle du village raconte, à l’heure de la mondialisation, la nécessité pour les plus modestes, de préserver un capital social et culturel à l’heure où l’État ne protège plus ». Ce capital d’autochtonie peut être défini comme « l’ensemble des ressources symboliques ou sociales, s’opposant au capital économique ou culturel est constitué notamment d’une notoriété acquise et entretenue sur un territoire singulier (selon des sociologues comme Nicolas Renahy ou encore Jean-Yves Rétière). Adossé au sentiment de l’enracinement local, ce capital a longtemps aidé à une participation à la vie publique et une insertion dans l’économie locale des couches populaires.
Cette notion de « capital d’autochtonie » peut être appliquée au travail médiatique et rapprochée des pratiques de la presse de proximité. Le succès d’un quotidien comme le Parisien (12 journalistes pour 4 ou 5 pages quotidiennes en Seine-Saint-Denis, plus de 100 pour l’ensemble de l’Île-de-France), comme celui de la presse quotidienne régionale, est notamment fondé sur les journalistes « localiers », implantés dans les territoires sur lesquels ils travaillent, et sur l’information de proximité. De là naît la confiance : un sentiment de proximité, entre journaliste et lecteur. On peut étendre le propos aux « médias d’information sociale de proximité » (tels que reconnus par le ministère de la Culture et de la communication depuis 2016), en particulier dans les « quartiers prioritaires » : Bondy blog, Borny buzz (Metz), Trappy blog, Radio HDR (Rouen) et autres Kaïna Tv (Montpellier)… Ces médias permettent une appropriation de la parole par les citoyens (le plus souvent jeunes et éloignés des médias), susceptible de les faire passer d’utilisateurs patentés des réseaux sociaux en producteurs de contenus presse prenant conscience des difficultés et implications du travail médiatique et du débat « citoyen », de les faire participer à la vie locale et mieux connaître leur environnement. Surtout, ils permettent à des citoyens le plus souvent issus des couches populaires, de renouer avec la presse alors qu’elle ne s’adresse plus à eux.
Ces médias, dont certains poursuivent le mouvement des radios libres des années 1980 ou de la presse « fanzine » des années 70, portent bien les semences d’un récit alternatif sur la France, notamment celle des périphéries, contournant les écueils du populisme numérique des réseaux sociaux et compensant l’élitisme de la presse. Ils sont bien constitutifs d’un véritable « capital d’autochtonie », capable d’outiller les exclus de la parole médiatique.
Article initialement parut dans Esprit:



