
De Smaïn à Jamel, le stand-up, trait d’union entre la rue et les artistes ?
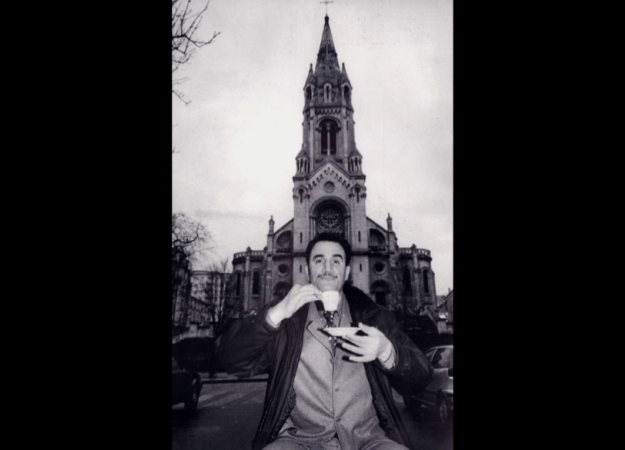
L’humour « made in banlieue » aura eu du mal à s’affirmer dans un paysage artistique français naguère trusté par Muriel Robin ou Raymond Devos. C’est avec Smaïn et surtout le Jamel Comedy Club, par le biais du stand up, que les jeunes des cités s’approprient enfin des lieux dits « parisiens » comme les théâtres. Et apprivoisent aussi le grand public. Comment le stand-up est devenu le trait d’union entre la rue et les artistes ? Dans cette tribune libre, Thierry Grone, lui-même co-auteur d’une web série intitulée « Qui met le coco ? », donne son point de vue.
Peu de place donc pour les minorités visibles, peu de sujets qui les concernent. Toute une génération qui n’a que des cassettes VHS pour rire aux blagues de Gaou. Smaïn sera un des premiers humoristes plébiscité par les quartiers populaires, parlant de ses origines avec ses spectacles A star is beur en (1986) ou T'en veux ? (1989), et son célèbre gimmick « t’en veux ? », où un jeune défoncé propose du shit ; puis viendra Eric Blanc (qui est Noir) et ses imitations de Yannick Noah ou Valery Giscard D’Estaing… sans oublier Pascal Legitimus, au sein du groupe Les Inconnus, qui donne plutôt dans la parodie.
Se tenir debout, face aux siens d’abord… mais pour mieux les vanner
Pas d’accessoire. Pas de costume. Raconter sa vie à travers des histoires drôles sur le mode de la vanne, inspirées du quotidien, et où la langue de Molière est volontiers mise à mal, le verlan et les expressions du bled se retrouvant en première ligne. Mener un spectacle improvisé, qui prend à partie le public. Et réciproquement. De la spontanéité, de la répartie, des punchlines, comme dans le rap, une capacité à rebondir sur ses propres ratages, et à interagir avec la salle. L’identification du public à l’artiste prime, d’autant qu’ils sont tous deux souvent issus de minorités volontiers caricaturées dans l’imaginaire dominant. Il y a donc une part d’autodérision et de retournement du stigmate. Voilà les recettes de base d’un stand up.
D’Eddy Murphy, à Jamel en passant par Woody Allen : un style issu des « minorités »
Un style qui puise son origine dans la culture populaire américaine de la fin du XIXe siècle, la stand-up comedy prend son essor à New York dans les années 1960, lorsque des comédiens comme Lenny Bruce repoussent les limites de la bienséance en abordant des sujets politiques, raciaux et sexuels. Inspiré par ce style acerbe, le comédien Richard Pryor est la figure emblématique de la stand-up comedy et de la contre-culture américaine. Domaine de prédilection des humoristes juifs ou afro-américains (notamment Woody allen et Eddy Murphy), le stand-up est devenu un outil de revendication sociale et d'affirmation identitaire.
En France, Jamel Debbouze est l'un des premiers à importer le stand-up, même si d’autres humoristes comme Desproges, Coluche ou Bedos s'adressaient déjà directement au public, sans composer de personnage, et en parlant des problèmes de société. Jamel et son ancien comparse Kader Aoun (aujourd’hui remplacé par Mohamed Hamidi, lui-même repreneur du Bondy blog en 2006), ont créé le Jamel Comedy Club, diffusé sur Canal+, afin de révéler les espoirs du stand-up comme Amelle Chahbi, Claudia Tagbo ou Thomas Njigol. Jamel devient ainsi « révélateur de talents » qui ont du coup popularisé ce style.
Le stand up, nouvelle vitrine de la banlieue après le rap et le foot ?
Derrière un message comique et un bon moment passé entre public et artistes, cette nouvelle forme d’humour entend refléter la diversité ethnique de la société française. Sous le label : « Qui mieux qu’un mec de la tess peut parler de la tess » ? Pour Spike Boukambou, qui sillonne la banlieue parisienne depuis une dizaine d'années et a lancé des soirées ambiance « scène ouverte » dans des cafés-théâtres, et où les monologues courts se succèdent et sont ponctués par un animateur et des DJ hip-hop, "le stand-up, c'est de l'humour urbain, pas du Bigard. Cela nous permet d'amener au cœur de la ville un public qui ne va jamais dans les théâtres parisiens, car on utilise les codes qu'ils connaissent pour leur parler d'un quotidien qui leur ressemble.» Les comédiens sont à l'image du public : métisse. Grâce à une autodérision corrosive, ils abordent tous les sujets sans complexes, raillent les stéréotypes qu'on leur colle à la peau et prennent leurs distances avec des sujets graves, comme la violence et le communautarisme.
La cité, tu l’aimes ou tu la kiffes
Il est plus simple de rigoler aux blagues Patson avec ses expressions « ça c’est cadeau… » ou « jeux de jambes », que celles d’un Laurent Gerra avec son langage soutenu… Aujourd'hui, les gosses de la rue s'identifient aux auteurs de stand up, car ils se retrouvent dans cette façon dont les jeunes se racontent des histoires et se lancent des vannes dans les halls d'immeubles. Ainsi le stand-up serait le trait d’union entre la rue et les artistes. Un trait d’union qui est avant tout une histoire de génération plus qu’une histoire de banlieue, et qui se retrouve volontiers dans le Comte du Bouderbala. Un style qui ne vient pas forcément de banlieue mais parle comme on parle entre 15 et 35 ans. Un exercice d’autant plus utile qu’on entend rarement ce que pense un jeune de 25 ans dans les médias. Une soupape d’expression pour aborder des questions de société de manière écrite, artistique et drôle. Les scènes de stand-up sont donc bien ouvertes un espace de parole et de liberté nécessaire pour toute une génération, qui n'y avait jusqu’alors pas accès. Par exemple, avant, les seuls comiques beurs qui représentaient les quartiers, étaient obligés d'aller dans le sens du vent. Avec le stand-up, quelle que soit son origine, on peut dire avec humour ce qu’on pense sur la société. Il y ainsi un côté militant : l’idée de « représenter » comme les rappeurs qui parlent de son quartier ; le stand up apporte donc ce que le public demande : la mixité sociale, faire marrer les gens et avoir un rire intelligent.
Mais il y a bien rupture avec les vieilles habitudes de la scène comique française. Pour ses détracteurs, l'explosion du « made in banlieue » ou la théorie du « pour nous par nous » est une nouvelle preuve de l'échec du vivre ensemble en France. Reste donc une question : le public français, et surtout la ménagère de moins de 50 ans, sont-ils prêts a écouter ces nouveaux humoristes des temps modernes ? Si, au-delà de Canal +, des émissions de divertissement jouaient le jeu, sans doute oui…



