
Revue Esprit novembre 2017-Macron et les banlieues : paradoxes d’une politique libérale par Erwan Ruty
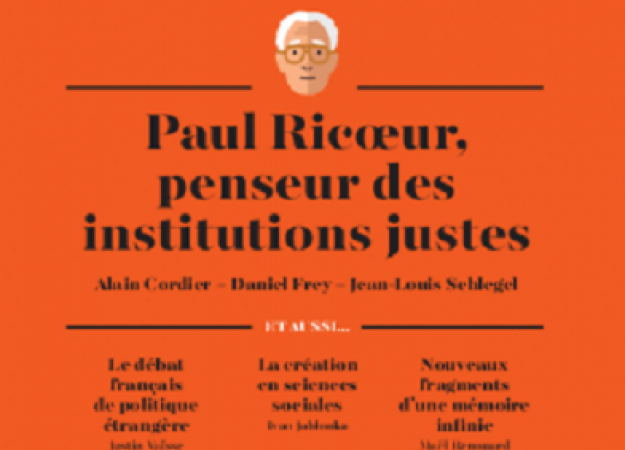
Le 16 novembre 2016, Emmanuel Macron déclarait sa candidature à la présidence de la République à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, dans un centre de formation des apprentis. Il y déclarait que ce département « est l’endroit où l’on crée le plus de start-up ». Un geste fort et des paroles à la polysémie aussi explicite que contradictoire : « espoir », « jeunesse », « formation », « entreprise », « diversité », prononcées sur un territoire dont les populations se vivent comme reléguées.
On est pourtant loin des prismes victimaires qui prévalaient jusque-là autour de la question des « banlieues ». Là réside la première intuition gagnante d’E. Macron : les habitants des quartiers ont besoin de rêver et de faire rêver, pas de faire pitié. Ils se reconnaissent de moins en moins dans la vision misérabiliste qui leur colle à la peau depuis des décennies. Seconde intuition gagnante : la vision entrepreneuriale de l’ancien ministre de l’Économie rencontre un écho profond auprès d’une partie de la jeunesse des quartiers populaires, qui ne croit plus aux modèles d’intégration sociale qui prévalaient naguère : implication dans le milieu associatif (notamment dans la lutte contre les discriminations) ou ascension sociale par la fonction publique.
Les banlieues sont-elles de droite ?
Dans les « quartiers », on y croit de plus en plus. « Les prolétaires sont des bourgeois qui sont dans la salle d’attente » : cette saillie d’un rappeur de Noisy-le-Sec, Nikkfurie, très représentative de cette culture « rap de droite », atteste des ambivalences d’une génération désabusée à laquelle le « macronisme », s’il existe, tente de répondre. « Il faut que les Français aient envie de devenir milliardaires », s’était écrié le futur président (réminiscence du « Enrichissez-vous » de Guizot ?). Les centaines de jeunes des quartiers de banlieues populaires, le plus souvent cadres issus de ladite « diversité », qui se pressent à toutes les manifestations professant le credo de la méritocratie par l’entreprenariat depuis quelques années ne sont pas un épiphénomène : qu’il s’agisse des rencontres des « Déterminés » de Moussa Camara (de l’association Agir pour réussir, à Cergy) depuis 2015 au siège du Medef ou au golf de Sevran (et non plus, comme naguère les rencontres dédiées aux acteurs des banlieues, à la Bourse du travail de Saint-Denis : tout un symbole !) ; du forum « Osons la banlieue » de Saïd Hammouche (de l’association Mozaïk RH, à Pantin, en 2015 – auquel E. Macron avait participé en tant que ministre de l’Économie) au « Startup banlieue » (La Plaine Saint-Denis, 2017), un fait est là : un nouvel espoir a remplacé celui qui prévalait naguère en France pour qui venait des banlieues pauvres et des couches modestes.
Depuis le tournant des années 2010, l’entrepreneuriat paraît à beaucoup l’ultime planche de salut, a fortiori quand la micro-entreprise et l’« ubérisation » démocratisent (tout en le paupérisant) ce rêve méritocratique. Le phénomène a émergé au début des années 2000, dans les discours de l’Institut Montaigne notamment (et de ses alliés comme Respect mag, avant de se diffuser plus largement), via le discours sur la « diversité », dans le sillon des succès de la discrimination positive (affirmative action) états-unienne. Comme sur bien d’autres points, les « banlieues » et leurs habitants ne sont pas étrangers aux tendances profondes de la société française (quoi qu’en pensent ceux qui les voient toujours comme un « ailleurs » qu’il faudrait « intégrer » ou ostraciser). La société française rêve elle aussi de l’entreprenariat : le succès du statut de micro-entrepreneur et la vague d’« ubérisation » des métiers d’employés (taxis, livreurs, commerce, hôtellerie…) rencontrent incontestablement un écho, si ce n’est un besoin des nouvelles générations de Français qui peinent à adhérer aux disciplines du salariat traditionnel… ou n’y ont tout simplement plus accès.
Incontestablement, si ce discours séduit bien des âmes dans les banlieues populaires, en particulier des jeunes de minorités dites « visibles », c’est grâce à la désidéologisation des territoires populaires, qui les fait échapper aux sirènes de la gauche au profit d’une vulgate peu cohérente, oscillant entre social-démocratie et libéral-conservatisme (libérale économiquement, conservatrice en matière de mœurs, mais auréolée d’attentions sociales), fleurant bon l’apolitisme ou le « droite et gauche ». La vague En marche ! est sans racines politiques apparentes (et donc sans antécédents gênants, contrairement aux autres formations qui ont déjà tant déçu – Pcf, Ps, Eelv – ou tant exclu – Ump), dynamique, moderne (outils numériques et réseaux sociaux, attitudes managériales) et inclusive. En effet, la diversité des nouvelles élites En marche ! n’est pas un mythe, qu’il s’agisse des militants ou des élus.
toutes les banlieues sont-elles converties à cette nouvelle hégémonie culturelle ?
Lors du premier tour de l’élection présidentielle de 2017, au-delà d’une abstention de plus en plus massive (phénomène le plus marquant, alors que les élections de 2012 avaient vu un recul de cette abstention, pour cause d’anti-sarkozysme en particulier), c’est le vote Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête dans ces territoires, suivi dans bien des cas par E. Macron (ces deux votes ne touchent pas les mêmes couches sociales dans ces territoires). Au second tour, le sursaut a existé de nouveau mais sans conversion massive des votants des quartiers populaires à la rhétorique d’E. Macron. En fait, ce qui semble surtout caractériser le vote de ces territoires est bien un cocktail de désaffiliation et de désidéologisation : il n’y a plus de vote « de classe », lié à la profession, aux origines sociales ou encore à un « habitus ». Signe d’un opportunisme ou volonté de ne pas être relégué dans une famille politique ni dans un courant de pensée ?
Quoi qu’il en soit, pour parler aux « quartiers », E. Macron s’est positionné sur des axes originaux et qui divisent peu : le testing plutôt que la poursuite de politiques offensives contre les discriminations (comme les récépissés lors des contrôles d’identité ou le droit de vote pour les étrangers aux élections locales) ; laïcité ouverte (pour ne surtout pas ouvrir la boîte de Pandore du débat sur la radicalisation islamiste) ; « emplois francs » ; rétablissement d’une police de proximité ; renforcement des aides à l’éducation à travers les « 12 élèves par classe » pour les Cp-Ce1 en Zep – même si dans bien des cas, ces projets et ces visions attendent des mises en pratique concrètes.
Si E. Macron a vu juste en pariant sur l’engouement des élites dites de la « diversité », le rapport du président à la « politique de la ville », qui est l’un des vieux hommes malades de l’action publique, est des plus ambivalents ; tout en semblant célébrer les 40 ans de cette politique publique, il en sape les fondements : suppression partielle des emplois aidés, annulation de centaines de millions d’euros de crédits dédiés à diverses actions territoriales dans ces zones. La célébration s’apparente donc à un enterrement de première classe, même si cet effondrement du soutien aux politiques de « droit commun » est compensé par quelques mesures médiatiques (comme le doublement proclamé des fonds dédiés à la rénovation urbaine).
Quelle est finalement la marque de fabrique du « macronisme » appliqué aux banlieues populaires ?
On peut y voir une manière de parachever un processus récent de « dématérialisation des banlieues », qui vise à les faire disparaître comme objet spécifique des politiques publiques ; comme territoires dotés d’une culture originale autant que de revendications propres ; comme abcès de fixation de toutes les crises françaises depuis le début des années 1990.
Troquer les « banlieues » contre la « diversité » (des gens) ? Mais la convergence entre le libéralisme présidentiel et une fraction des élites émergentes des quartiers ne saurait cacher le caractère fondamentalement inégalitaire de cette recette : elle s’accompagne en effet d’un désinvestissement de l’État dans des services publics qui assuraient naguère une redistribution indirecte des richesses. Ce retrait public aura pour effet de précariser davantage les plus fragiles…



