
Pari(s) du vivre ensemble : l’éducation, pour « mettre un terme aux orientations subies »
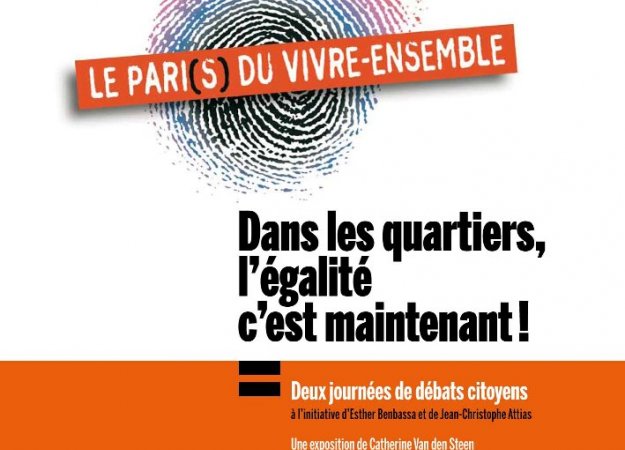
Pendant deux jours, le « Pari(s) du vivre ensemble », a relancé le débat sur l'égalité et la diversité, spécifiquement dans l’éducation nationale ce vendredi 30 novembre. Institutionnels, acteurs de terrain, entrepreneurs ont eu l'occasion d'échanger sur ce « pari ».
C'est dans le cadre prestigieux du Sénat, que les différents intervenants étaient conviés pour débattre sur l'égalité dans les logements, l'éducation, la sécurité et la culture. Esther Benbassa et Jean-Christophe Attias ont eux-mêmes animé le débat dont le sujet était « Education, formation, emploi ». D'un côté des institutionnels représentant le gouvernement ; de l'autre des acteurs de terrain expérimentés sont venus débattre ensemble de l'éducation de nos chères têtes blondes, frisées ou crépues.
Il faut revaloriser certaines filières comme le CAP chaudronnier
« Revaloriser le CAP chaudronnier »
Le premier à se jeter à l'eau est Daniel Assouline, conseiller technique au cabinet de Vincent Peillon, Ministre de l'éducation nationale. Il nous rappelle que « le Président s'est engagé sur la baisse du nombre de décrocheurs. Le recensement de novembre fait état de 180 000 jeunes décrocheurs (Jeunes entre 16 et 24 ans qui n'ont pas fini leur formation). 49% d'entre eux « sortent » du lycée professionnel ». D'un air décidé et combatif, le conseiller de Vincent Peillon lance « Nous devons proposer à chaque jeune un retour à la formation », il ose même un exemple concret : « Il faut revaloriser certaines filières comme le CAP chaudronnier ». Pour convaincre l'assemblée de son exemple, il insiste sur la modernité de la filière, sur le fait que tout soit électronique, bref il essayait de nous convaincre qu'il fallait presque être ingénieur pour être chaudronnier aujourd'hui. L'assistance restant très dubitative, il tente un ultime coup de poker : « Il faut faire un travail sur les stéréotypes sexués, d'ailleurs de plus en plus de femmes suivent la formation de chaudronnier... ».
ne pas trop centrer l'orientation sur les résultats scolaires mais peut-être sur d'autres compétences
« Mettre un terme aux orientations subies »
Que ce soit volontaire ou pas, M. Assouline a soulevé un vrai problème : l'orientation. C'est justement un axe fort de la politique de George Pau-Langevin, ministre déléguée auprès du Ministre de l’Éducation nationale, représentée par sa conseillère Laura Ortusi : « L'orientation est un révélateur pour la réussite scolaire. Malheureusement l'origine, le milieu, les places disponibles restreignent le champ des possibles ». Pour Mme Ortusi, il faut « mettre un terme aux orientations subies, ne pas trop centrer l'orientation sur les résultats scolaires mais peut-être sur d'autres compétences ». Ayant conscience que bien d'autres avant elle se sont attaqués au problème, cette dernière annonce la méthode qu'elle compte utiliser qui tient en deux points. Premier point : une politique d'innovation volontariste. L'occasion de dire qu'un conseil national sur « l'innovation volontariste » dans l'éducation aura lieu début 2013. Second point : la coordination des tous les acteurs. A ce sujet, une journée sur la réussite éducative se tiendra au printemps. Le message est plutôt clair, Mme Pau-Langevin se saisit du problème de l'orientation à bras le corps, par contre pour savoir ce qui sera fait concrètement, il faudra attendre l'année prochaine. Daniel Filatre, conseiller orientation-formation-insertion auprès de Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, va dans le sens de Laura Ortusi sans se montrer plus précis : « Le choix des études doit être vu dans sa globalité dans une amplitude de -3/+3 ». Ce jargon signifie que l'orientation doit être réfléchit dans un processus qui commence 3 années avant le bac et qui continue 3 années après.
Vue du terrain
« Pour l'instant, rien de nouveau, lance Akli Mellouli un brin désabusé. La baisse des crédits pour l'éducation continue. » Pour autant M. Mellouli, adjoint au maire de Bonneuil-sur-marne (Val de Marne), ne baisse pas les bras devant les difficultés : « Dans les quartiers populaires de Bonneuil, les jeunes font des études supérieures, mais ils rencontrent des difficultés financières, donc ils travaillent à coté, chez Mac Do par exemple, et ils finissent par rencontrer des difficultés pour suivre leurs études. Pour pallier à ce problème, nous proposons des contrats étudiants : ces derniers donnent des cours aux jeunes, les accompagnent et ils gagnent de l'argent en aidant la jeunesse de la ville ». Un tel programme existe en effet dans plusieurs autres villes, comme au Blanc-Mesnil avec le « contrat municipal étudiant » (bourse comprise entre 1000 et 2000 euros par an, pour les moins de 26 ans titulaires d’un bac +2 encore en cursus universitaire). Depuis 2005, 500 jeunes blanc-mesnilois ont bénéficié de ce dispositif.
nous faisons donc venir les parents à l'école pour leur dire autre chose que « votre enfant est un cancre
L’implication des parents
Samy Mamlouk, coordinateur du programme « Réussite éducative » à la mairie de Trappes, partage une expérience très similaire : « Certains étudiants animent les ateliers « coup de pouce » destinés aux jeunes. On crée ainsi une passerelle sur le terrain. Durant ces ateliers, les jeunes font des jeux de lecture, d'écriture et les parents y sont associés. L'implication des parents est importante pour la réussite scolaire. » Gérard Willème, proviseur du Lycée Paul Eluard à Saint-Denis, a également misé sur l'importance de l'implication des parents : « Nous organisons des remises de prix pour les élèves, nous faisons donc venir les parents à l'école pour leur dire autre chose que « votre enfant est un cancre ». Ils en ressortent avec une certaine fierté pour leur progéniture et intègrent le fait qu'aller à l'école n'est pas forcément négatif. »
Au Canada, il parlent de « persévérance scolaire »
Quelles solutions durables ?
Pour Samy Mamlouk, il faut « apporter des réponses individualisées, prendre en compte la globalité du parcours d'un enfant. » Il poursuit en précisant que contrairement aux idées reçues, c'est bien l'échec scolaire qui conduit à la violence scolaire. C'est pourquoi il serait souhaitable d'adopter une autre attitude par rapport à l'échec : « Au Canada, il parlent de « persévérance scolaire ». L'appellation est plus positive et peut induire plus facilement une idée de travail commun contre l'échec scolaire. » Même volonté pour Gérard Willème : « Il faut repenser le maillage de terrain, mettre les différents acteurs en synergie. Mais aussi redonner confiance aux jeunes et à leurs parents. » Akli Mellouli a un avis un peut plus tranché de ce qui peut être fait : « Au lieu de créer des ZIP, des ZAP... qu'ils créent plus de zones d'éducation prioritaire ! » Salve d'applaudissements d'une assistance qui ne tarde pas à faire entendre sa voix.
Pour avoir plus d'élèves des quartiers dans les classes prépa, on pourrait passer par une injonction du gouvernement ?!
« Où sont les 14 000 profs promis ? »
C'est le jeu ! Quand le Président de la République a promis monts et merveilles, le gouvernement doit ensuite faire face aux exigences de résultat venant de la population : « Où sont les 14 000 profs promis ? » Pour désamorcer la bombe, Daniel Filatre parle du dispositif « emploi d'avenir ». C'est ensuite Daniel Assouline qui rebondit : « ça ne se fait pas du jour au lendemain, les budgets pour la rentrée 2012 ont été votés en 2011. » Puis, avec la volonté de marquer des points auprès de l'assistance, il poursuit : « Vous savez, il y a encore moins de six mois, j'étais sur le terrain, enseignant dans des écoles Eclair (Ecoles, collèges et lycées, pour l'ambition, l'innovation et la réussite). Une fois que les difficultés des jeunes sont identifiées, elles doivent être prises en charge. Il faudrait envisager un prof de plus dans les écoles, qui les accompagnerait. » Réponse peu satisfaisante, à en croire le public. Arrive une nouvelle question sur l'accessibilité des grandes écoles cette fois. Daniel Filatre rendosse son costume de pompier : « Pour avoir plus d'élèves des quartiers dans les classes prépa, on pourrait passer par une injonction du gouvernement ?! » Question ? Affirmation ? Akli Mellouli ne s'est pas posé la question longtemps avant de lâcher un dernier napalm : « Une remise à plat est nécessaire. Quand les jeunes de quartiers arrivent à rentrer à Sciences Po, ils réussissent, donc le problème vient des conditions d'entrée, il y a discrimination ! »
Sonnés par le coup et sauvés par le gong, tous les intervenants du débat, institutionnels en tête, cèdent leur place aux suivants. Ils laissent l'assemblée avec les mêmes doutes qu'au début du débat, mais avec une question bonus sur la discrimination...



