
La santé mentale lance son appel
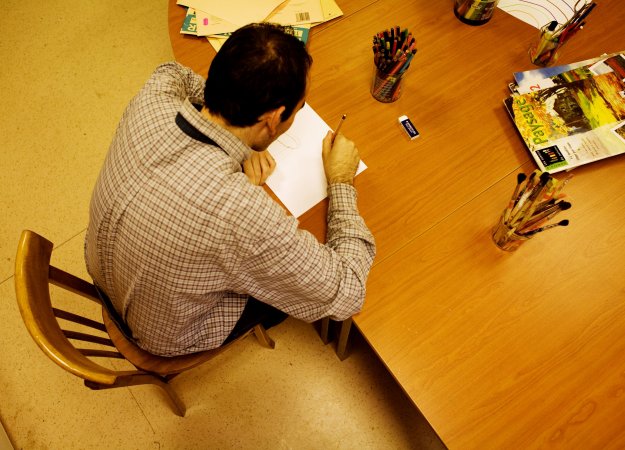
« L’appel des 39 », tout en dénonçant la vision sécuritaire de la santé mentale développée par Nicolas Sarkozy, met en lumière un problème crucial : le manque de moyens alloués au traitement de la souffrance psychologique en France. Une gestion comptable qui frappe en premier lieu les quartiers populaires.
Contre le traitement sécuritaire de la souffrance mentale
Ils ne sont – sur le papier du moins – que trente-neuf. Mais commencent à faire autant de bruit que des millions. « L’appel des 39 »*, initié en Seine-Saint-Denis par divers professionnels du monde de la psychiatrie, renvoie une vague de revendications en écho à la politique de Nicolas Sarkozy en matière de santé mentale. Le 2 décembre 2008, le président de la République se fendait d’un discours dont ses conseillers en communication ont le secret. Quelques jours après un fait divers tragique**, Nicolas Sarkozy annonçait un virage tout sécuritaire dans le traitement de la souffrance mentale en France. « Unités fermées », « systèmes de vidéosurveillance », « chambres d’isolement », « dispositif de géo-localisation » des malades, « soins ambulatoires sans consentement » du patient…
En d’autres termes, revenir sur des décennies d’évolution des soins, qui cherchent avant tout à intégrer les patients dans la société plutôt qu’à les en exclure. Une simple politique sécuritaire, oubliant l’aspect humain des traitements, basée uniquement sur le choc de l’opinion et décidée à l’emporte-pièce ? Pas seulement. Car lorsqu’on regarde derrière le paravent de la répression, on découvre surtout la baisse des moyens que subit le monde hospitalier psychiatrique depuis quelques années. Qu’on se le dise : s’il est prompt à donner du bâton, l’Etat est en revanche beaucoup moins généreux désormais en termes de financement.
Etablissements de soins au bord de la crise de nerfs
Pour en donner un aperçu, les 39 du 9-3 ont ouvert les murs de Ville-Evrard. Ville-Evrard ? Une ville dans la ville. Une cité qui s’étend sur quelque 120 hectares, sur la commune de Neuilly-sur-Marne, dans l’est de la Seine Saint-Denis. Des écoles, des centres de formation, une vieille église, des cèdres centenaires. Spécialisé dans le traitement de la maladie mentale, l’établissement de santé publique (EPS) de Ville-Evrard répond aux besoins en psychiatrie de 34 communes du département. Les 39 y ont donc convié le public début juin. Un forum pour mieux montrer à quel point les coupes budgétaires (sur l’eau, les conditions d’hygiènes, la réfection des bâtiments, la vie commune entre soignants et patients…) mènent peu à peu les établissements de soins au bord de la crise de nerfs. Pourquoi avoir choisi le 93 pour ouvrir les yeux du public ? Non pas que la population souffre davantage dans les quartiers populaires qu’ailleurs. Si les causes sont parfois différentes, les maux restent les mêmes et les études sur le terrain montrent que les situations de souffrance mentale sont aussi nombreuses à Neuilly-sur-Seine qu’au cœur des cités dortoirs.
Autant de souffrance psychologique à Neuilly qu’à La Courneuve
La différence ? Les professionnels libéraux, psychiatres ou psychologues, infirmières en psychiatrie, ont désormais déserté les quartiers. Pas assez riches ni assez solvables pour s’offrir leurs services. Dans certaines villes de Seine-Saint-Denis, on ne compte désormais plus un seul psychiatre. Les services publics sont aujourd’hui les seuls à assumer, avec de moins en moins d’argent, une tâche que ne font qu’alourdir les conditions socio-économiques. Et qui tend à devenir, dans ces conditions, un défi impossible à surmonter : soigner sans exclure, aider des personnes souvent précarisées sans les marginaliser davantage… « Nous accueillons ici tous types de personnes, un public sans cesse plus large, touché par des souffrances psychiques diverses, constate Daniel Zylberberg, psychologue et doyen du Centre Médico Psychologique (CMP) de La Courneuve. Des gens en dépression après un licenciement, ou subissant des pathologies lourdes, telles que la schizophrénie. La psychiatrie libérale, en ville, ne permet pas un suivi régulier ni un accompagnement social des patients comme nous le faisons ici. »
Accompagner au quotidien
Car l’enjeu, aujourd’hui, est d’accompagner les patients dans leur quotidien. Peu à peu, les moyens de traitement de la santé mentale sont sortis des murs de l’hôpital pour coller aux besoins de la population. « Dans les années 90, nos équipes se constituaient en associations pour pouvoir sous-louer des studios afin de sortir les gens de l’hôpital et les aider à se réinsérer socialement, à les rendre autonomes », poursuit le docteur Nahory, praticien hospitalier au CMP. « Notre vocation est aussi de prendre en charge des pathologies au long cours, qui vont évoluer parfois sur plusieurs années », rappelle Daniel Zylberberg. A l’opposé même des méthodes imposées par le gouvernement, qui s’empressait de publier dès le 22 janvier dernier une circulaire pour mettre en application le dogme présidentiel...
A ce stade, l’image d’Epinal des fous en camisole de force enfermés à l’asile a sérieusement jaunie. Sur le terrain, les professionnels s’essoufflent à le répéter, les patients atteints de troubles ne sont pas plus dangereux que les autres. Et c’est là que le bât blesse selon les signataires de l’Appel des 39. « En amalgamant la folie à une pure dangerosité sociale, en assimilant la maladie mentale à la délinquance, est justifié un plan de mesures sécuritaires inacceptables », clame leur profession de foi.
Une vision d’un autre âge
En d’autres termes, derrière des mesures de sécurité, affleure une vision de la souffrance mentale d’un autre âge. Soucieux de « protéger la société et nos compatriotes (…) de cette violence éruptive, imprévisible et soudaine », Nicolas Sarkozy rappelait dans son discours que « des gens dangereux dans la rue, c’est un scandale ». Sauf que… « Nous ne sommes pas plus exposés au danger auprès des malades que quand on circule dans le métro », confiait l’an passé une infirmière en centre médical. « Les malades mentaux dangereux, c’est un mythe, prévient le docteur Nahory. En revanche, la maladie mentale est un facteur de désinsertion et d’isolement social et familial. »
A charge pour les professionnels des soins psychiatriques dans les quartiers de s’en débrouiller. Entre système D, bricolage, et dévouement. « Les gens subissent toutes formes d’agressions, sur le plan social ou économique, constate le docteur Jean-François Le Goff responsable d’un des quatre secteurs de soins du 93. Il y a la pauvreté, le racisme… Dans certains centres, nous traitons mille personnes par an. C’est considérable. Malheureusement, la politique des gouvernements successifs est de diminuer les moyens alloués à la santé. Sur mon secteur, nous comptons 19 lits pour une population de 70 000 personnes. Trois fois moins que les recommandations de l’OMS. »
Inventer des formes nouvelles de thérapie
Reste à compter sur la solidarité des réseaux mis en place entre hôpitaux, centres d’accueil et d’orientation, appartements de fortune ou les structures qui ont poussé sur le bitume des banlieues pour traiter les pathologies les plus lourdes. A l’hôpital Avicenne, la maison des adolescents accueille chaque année mille jeunes de 15 à 19 ans – une période essentielle. Invente des formes de thérapie, sollicite des artistes comme Grand Corps Malade pour donner une claque au destin. Partout, sur le terrain, des assistantes sociales sont à l’écoute du bouche-à-oreille du quartier pour détecter ce qui ne va pas, conscientes que l’environnement social influe profondément sur la façon dont la souffrance se développe. Ici, dans tel hôpital de jour, on a instauré l’art, de la photo à la poterie (puisqu’on n’a pas encore imposé d’en revenir aux bonnes vieilles camisoles de force), comme moyen de remettre les patients en selle. L’art, c’est bien : ça ne coûte pas cher. Jusqu’ici, tout va donc (presque) bien.
Cyril Pocréaux – Ressources Urbaines



