
La culture des cités, un concept réducteur? - Ressources Urbaines
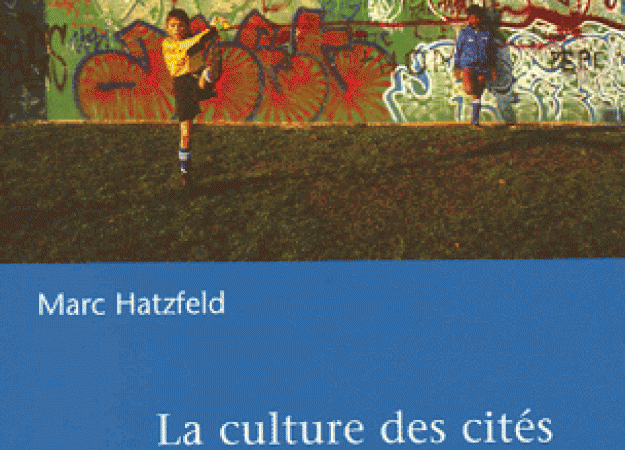
Dans son ouvrage consacré à la culture des cités1, Marc Hatzfeld entreprend de répondre à la stigmatisation des classes populaires, habitant les logements sociaux à la périphérie des centres urbains et cibles des préoccupations médiatiques et politiques. Dans son essai, au style clair et concis, l’auteur s’attache à « positiver » les arts, le langage, l’économie, les pratiques rencontrés dans les quartiers populaires, ce que les sociologues définissent comme les styles de vie et les anthropologues qualifient de « culture »2. L’auteur procède à un « inventaire des ressources des habitants de cité », qui semble destiné à réhabiliter ces populations auprès du « grand public ». Cet ouvrage s’inscrit ainsi dans la lignée de plusieurs travaux de recherche, qui présentent « le monde des cités » comme une force3, à la culture agonistique4, avec ses codes et ses rites5. Marc Hatzfeld montre bien comment ces pratiques répondent à des règles, des formes d’expressions qui possèdent leurs sens, une histoire, toute une richesse. Cependant, ces analyses rencontrent deux principales limites.
Parler de culture pour envisager les pratiques et les formes d’expression des classes populaires ne va pas sans poser plusieurs difficultés. Premièrement, les styles de vie décrits dans l’ouvrage concernent principalement ceux des jeunes de milieux populaires considérés comme les moteurs de cette culture. Bien que l’auteur souligne la diversité des situations, le terme de culture tend à généraliser les pratiques des adolescents et jeunes adultes à l’ensemble des habitants des cités. Les réflexions engagées sur l’homogénéité et sur l’autonomie des cultures populaires6 ne sont ainsi que peu mises à profit. Deuxièmement, l’accent porté sur l’origine historique, sociale et économique de ces pratiques et formes d’expression n’est parfois pas suffisant pour permettre d’appréhender leurs sources. Ainsi, cet angle d’analyse, malgré toutes les précautions prises par l’auteur, prend le risque d’alimenter des lectures culturalistes, qui ont toujours la vie dure7.
Enfin, vouloir démontrer les dimensions positives, créatives, originales, subtiles et in fine essentielles à la société française de ces pratiques répond de trop aux discours de stigmatisation. Cet angle d’approche donne paradoxalement du crédit aux discours dominants et négatifs sur ces pratiques par un effet de renforcement8. Le sens critique de certaines pratiques aurait peut-être mérité une analyse plus approfondie pour pallier à cette tendance. Cependant, il apparaît nécessaire de dire que cet ouvrage (et cette collection) se destine avant tout à la découverte et à la vulgarisation. De ce point de vue, « La culture des cités » offre une introduction originale sur les enjeux concernant les cultures populaires. L’ouvrage esquisse par ailleurs des pistes de réflexion et avance des propositions pour faire avancer la reconnaissance des pratiques et cultures populaires.
Samir Hadj Belgacem / Ressources Urbaines
1Hatzfeld (M.), La culture des cités. Une énergie positive, Paris, Autrement, Collection Frontières, 2006.
2Cuche (D.), La notion de culture en sciences sociales, Paris, La Découverte, Collection Repères, 1998.
3Kokoreff (M.), La force des quartiers. De la délinquance à la politique, Payot, 2003.
4Sauvadet (T.), Le capital guerrier. Concurrence et solidarité entre jeunes de cité, Paris, Armand Colin, coll.Sociétales, 2006.
5Lepoutre (D.), Coeur de banlieue. Codes, rites et langages, 1997, rééd. Odile Jacob, coll. « Poches », 2001.
6Richard Hoggart a notamment relancé ces questionnements dans les années 1950, en analysant les effets de la culture de masse sur les pratiques des classes populaires
Hoggart (R), La culture du pauvre. Étude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre, Paris, Éditions de Minuit, 1970 [1957].
7Voir le lien constestable établi entre immigration subsaharienne et délinquance dans le dernier ouvrage de Lagrange (H.), Le déni des cultures, Paris, Le Seuil, 2010.
8Concernant l’envers et l’endroit du discours dominant et ses variantes voir : Rigouste (M.), Variantes du discours sur l’intégration : « L’immigré, mais qui a réussi... », Le Monde Diplomatique, juillet 2005.



