
Banlieues d’Europe motive l'engagement européen
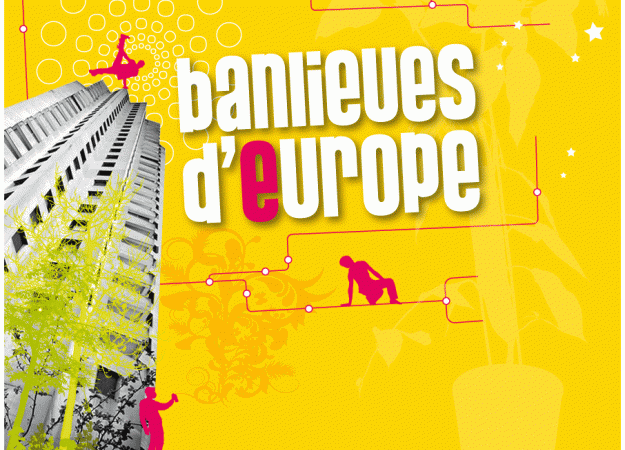
Mais où est l’Europe dans les banlieues ? Alors qu’il ne semble pas y avoir de frottement entre ces deux univers, nouveau coup d’œil sur quelques expériences passerelles. Avec, en deuxième épisode, l’expertise de l’association lyonnaise Banlieues d’Europe, réseau de plus de 300 partenaires européens qui travaille depuis près de 25 ans sur « les périphéries », notamment culturelles, du continent.
L’Europe compte plus de 25 millions de chômeurs. 25% de jeunes sont au chômage en France (56% en Espagne, 8% en Allemagne…). Dans les banlieues françaises (ZUS), on le sait, ce taux est de plus de 40% pour les jeunes hommes. Question : comment attirer les subsides lointains vers ces personnes qui en ont le plus besoin ? « Il y a des choses qui ont quand même été mises en place pour les jeunes en difficultés », assure Charlotte Bohl-Mustafa, chargée de mission pour Banlieues d’Europe, qui organise notamment des formations pour les cadres associatifs qui voudraient travailler avec les institutions bruxelloises. « Il y a par exemple le dispositif Jeunesse en action », intégré au fameux programme d’échanges Erasmus. Un programme qui s’est récemment ouvert aux stagiaires et aux apprentis. Entretien avec la chargée de mission, pour aller plus loin.
P&C : Les programmes dédiés aux personnes en difficultés rencontrent-ils effectivement ces personnes, qui sont en général éloignées des dispositifs ?
CB-M : En effet, 41% de ses bénéficiaires ont fait des études supérieures, alors que seuls 11% des 18-39 ans a ce niveau d’études en moyenne. Et seuls 12% des jeunes qui en bénéficient estiment être « en difficulté » ! L’agence qui gère ce projet a des pratiques qui ne suffisent pas pour toucher les jeunes dans les centres sociaux, les missions locales… Mettre trois dépliants dans une MJC, ça ne suffit pas ! Et les personnels des structures d’insertion eux-mêmes ne connaissent pas ces programmes, et parfois pensent qu’ils ne sont pas faits pour les jeunes dont ils s’occupent. Il y a un vrai travail d’accompagnement des porteurs de projets à faire, pour qu’ils trouvent des cofinancements, des partenariats... Mais il y a une « Stratégie jeunes urbains » de l'Europe, à destination des jeunes des quartiers, les « youth disadvantaged sub-urbans » : « Youth and the city ». Ces programmes se sont arrêtés en 2013, mais ça fait quand même une base d’interpellation des décideurs ! Ces projets peuvent être une réponse au décalage entre les jeunes et les décideurs. Les programmes « Europe créative », « Erasmus » et les fonds structurels (Fond Social Européen, Fonds Européen de Développement Régional) sont les soutiens principaux pour nos projets. Ils financent la mobilité, les échanges, les études, le service volontaire européen, la coopération, y compris pour les jeunes travailleurs…
P&C : Vous avez récemment organisé une rencontre autour de la citoyenneté européenne. Qu’en est-il ressorti ?
CB-M : Il y avait des Français, des Allemands et un Kossovar. On se demandait comment vivre avec plusieurs identités, qui se nourrissent l’une l’autre. Les participants étaient quadrilingues… on a remarqué un très grand décalage entre leurs questions très concrètes et les réponses un peu générales des intervenants, sans précisions sur comment recréer un lien entre élus et habitants…
P&C : Quels projets avez-vous porté ?
CB-M : Il y a eu par exemple un projet « Wesh le monde » : le centre social de Vaulx-en-Velin nous a contacté pour emmener un groupe de 13-15 ans, qui travaille sur un journal. Ils voulaient rencontrer un autre groupe de jeunes. On les a aidé à trouver des partenariats. Les animateurs ne sont pas toujours très à l’aise en anglais, surtout les Français ! On leur dit pourtant que la langue n’est pas un problème. D’ailleurs, on remarque que certains jeunes ont plusieurs langues, soit scolaires, soit parce qu’ils sont héritiers de l’immigration. Ceux-ci sont plus à l’aise entre différentes langues, ils ne voient pas ça comme un atout ! Ces voyages les valorisent. Ils ont beaucoup plus de « compétences interculturelles » que les autres, ils savent mieux jongler ! Ils arrivent très bien à communiquer, et puis on peut toujours budgéter des traducteurs ! C’est un endroit de valorisation de ces compétences dévalorisées. Et puis certains Français qui ne se disent pas Français se rendent compte à quel point ils le sont en allant à l’étranger ! Ces expériences peuvent questionner ou valoriser les identités plurielles. Pour certains, c’est dur de sortir du quartier. Aller dans un autre pays les aide à se prendre en main.



