
Je parle donc je suis
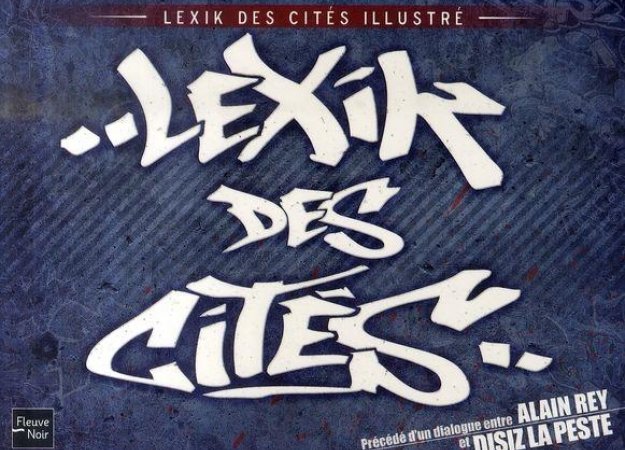
La langue attribuée à Molière serait sans doute méconnaissable pour le dramaturge, tant les influences externes ont été multiples depuis le XVIIe siècle. Dans les quartiers, la langue française est malmenée, modifiée, enrichie pour s’ajuster à une réalité multiple diverse. Ne sommes-nous pas ce que nous parlons ?
Si vous posez vos oreilles quelque temps à Villiers-le-Bel, ne vous étonnez pas de ne rien comprendre malgré votre « parler ghetto » quasi parfait ! « Salam, tchek en wifi, ça sort ou pas ? » (traduire par « Bonjour, on se salut, ça va ou pas ? ») / « Pepel’s, c’est quoi ton kiub ? » (Tranquille, tu fais quoi ?) / « T’as cassé ton français lourd ! » (Tu dis la vérité !) / « C’est Mabe, allez, range ton corps ! » (Ce n’est pas bien, allez va-t-en!)…
Autant d’expressions beauvillésoises qui vous feront vous sentir comme un étranger. Pourtant, la langue parlée à Villiers-Le-Bel est née il y a plus de dix ans et comporte des mots aussi variés que « mabe », mauvais en Lingala, ou « pepel’s », tiré de pépelé, « tranquille » en zaïrois. « Kiub » ? Utilisé pour « bien » ou demander, quel est le problème, ou « qu’est-ce que tu fais », selon le contexte. Le terme vient du nom d’un collectif de rappeur américain, QB, pour Queens Bridge, quartier de New York d’où sont issus des grands noms du rap US, de Nas à Mobb Deep. Et donc « Kiub », à la sauce Villiers.
Tibault Baka, l’un des instigateurs de cette langue locale, a pour projet de créer un dictionnaire du parler propre à Villiers. Son titre ? Le petit Mamadou, pour « valoriser notre langue et apporter la contribution des gens des quartiers à l’enrichissement de la langue française, explique-t-il. C’est d’ailleurs pour ça qu’on a appelé notre langue locale le français Aka ! » c’est-à-dire sur le modèle du vocable américain « Also Known As » (a.k.a.), utilisé dans le rap pour signer de son pseudonyme (exemple récent : Axiom a.k.a Icham ou Laouni a.k.a La Fouine etc). De la langue arabe, aux influences hip-hop américaines, en passant par des imprégnations noires africaines, « ce langage traduit complètement le pluriel de ces quartiers » estime M. Ivora, professeur d’histoire géographie au collège Léon Blum, en plein cœur de « Vyler » - Villiers avec l’accent américain.
Identité ghetto multiple
Parler cette langue, « c’est une manière de montrer que t’es d’ici » explique Samir, 22 ans, pion au collège Léon-Blum. Pour marquer leur territoire, beaucoup de quartiers populaires ont développé leur langage. Qui n’a pas entendu parler du montreuillois, où les influences tsiganes ont donné des expressions telles que pillave (boire), bicrave (vendre ou dealer), linchave (partir), mots qui se sont diffusées sur l’ensemble du territoire pour intégrer le parler des cités en général ? A Evry, un collectif de jeunes est allée jusqu’à publier en 2007 un Lexik des cités ou l’on retrouve plusieurs milliers de mots aux origines multiples. L’écrivain Mabrouk Rachedi travaille à l’élaboration d’un lexique de l’argot avec des élèves d’un collège de Troyes. « Nous avons retracé les origines et les influences des mots utilisés par les élèves et on a été surpris du nombre de mots d’origine étrangère », s’étonne-t-il. Se concentrer sur de l’argot ? « Evidemment, ça participe à la diffusion d’une forme de multiculturalisme, même à des endroits où les minorités de la diversité ne sont pas très visibles. Mais le risque, c’est l’enfermement dans un vase clos : quand je demande la définition d’un mot d’argot, ils me répondent par un autre mot d’argot » admet l’auteur.
A Villiers, même si les jeunes utilisent tous la même langue de base, chacun y apporte sa touche en fonction de ses influences. Au point, parfois, d’éprouver des difficultés à se défaire de l’emprise de ce langage. « Quand je vais à Paris, personne me comprend » explique Kenny, 14 ans, habitant du quartier du Puit. « Je fais un effort, mais c’est vrai qu’en premier je parle la langue d’ici. Je ne sais pas pourquoi, ça vient tout seul... » Samir, le surveillant, l’avoue : « Ils seraient capables d’aller en entretien et de parler ce langage… ». « Ils savent faire la différence, assure tout de même M. Ivora. Ce qui est inquiétant c’est que, effectivement, ils peuvent ne pas comprendre des mots même simples issus du français. » Et si ce malaise de la langue traduisait celui d’un multiculturalisme qui peine à être reconnu, et dont les richesses sont niées ? Ceux qui vivent au quotidien cet état de fait se réapproprient leurs différences avec leurs moyens, notamment le langage. Au risque d’être tellement décalés qu’ils risquent, aussi, de se retrouver en marge de la société.
NADIA SWEENY / Presse & Cité



