
« Il n’y a plus de communion que dans la consommation »
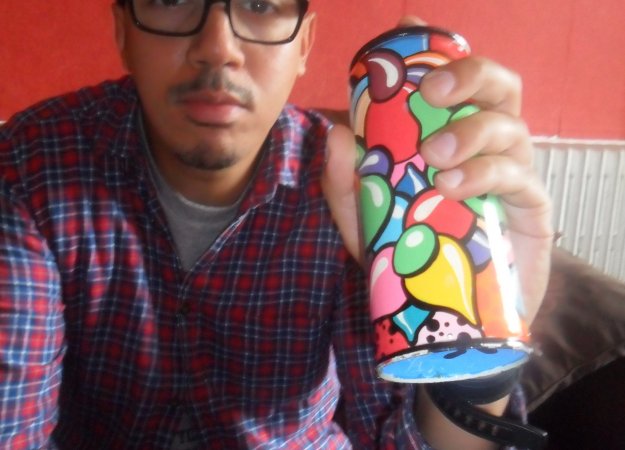
Karim Madani a été l’un des pionniers d’une certaine littérature urbaine sous influence états-unienne. Ex-journaliste fondu de Hip-Hop qui verse de plus en plus dans la Science-Fiction, il sort «Le jour du fléau», descente aux enfers d’un flic accro dans une ville futuriste entre Gotham City, New York et Paris, et qui lorgne du côté d’Abel Ferara. Il revient sur son attachement aux Etats-Unis et à l’empreinte de la culture de l’Oncle Sam dans la nouvelle culture universelle dont il se fait l’un des hérauts littéraires français.
Quels ont été tes premiers contacts avec les Etats-Unis ?
Je suis de 72, j’ai biberonné des séries B, du Don Siegel autant que le cinéma du Nouvel Hollywood. Mais c’est les villes qui m’ont fasciné. New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago… J’y ai fait une vingtaine de voyages. A une période où par exemple New York était encore crado, comme dans Taxi Driver. J’ai trouvé ça très cinématographique ! J’ai pas mal pour couvrir une partie de l’actualité musicale pour des magazines Hip-Hop. Ca m’a permis de voir les choses de l’intérieur. D’aller dans les logements sociaux, dans des mondes plus parallèles, underground. J’ai pu chroniquer une culture alternative de la rue qui reste peu connue. Alors qu’en fait tu peux être aussi à l’aise dans le Bronx, à Brooklyn qu’à Barbès ou à Belleville. Il y a le même agrégat de communautés, le même patchwork, même si c’est plus exacerbé là-bas… Mais les faillites des villes, les pannes d’électricité, les graphs, le côté tiers-monde qu’il y avait avant Giuliani, tout ça n’existe plus.
Les villes ont une place considérable dans tes livres…
Gotham city [dans Batman], c’est une ville-monde, une ville prototype. Une matrice, une architecture post-industrielle fantasmée, que je transpose ici en France. Mais pour moi, c’est autant une ambiance psychique qu’un modèle narratif. De Price à Pelecanos en passant par Himes, la ville est un personnage, comme dans l’expressionnisme allemand : quand un personnage souffre, un building est décrit de la même manière, comme un corps cancéreux, gangrené, souffreteux… Aujourd’hui, les contes, le petit chaperon rouge, ça ne se passe plus dans la forêt, mais à Belleville !
La littérature française est-elle à l’aise dans cet univers, habituellement ?
Non, il y a une incapacité des écrivains français, notamment dans la mode de l’auto-fiction, à parler de la ville moderne du XXème siècle, avec son bouillonnement, son magma post-industriel. Ce bruit, cette fureur n’existent pas. La culture littéraire française apprécie plus Auster, qui aime bien la vieille Europe, la bonne cuisine, l’art allemand… que Pelecanos ! Si bien que Spike Lee a clashé Paul Auster en disant qu’il faisait monter les prix des loyers en invitant ses potes chez lui ! Chez moi, les deux cultures, la française et l’américaine, sont fusionnelles, comme chez Moebius par exemple.
Le hip-hop a marqué ton style ?
J’essaie de sortir de l’influence du hip-hop américain. Ce mouvement est moins intéressant maintenant, je trouve. Même si j’ai été marqué par cette culture hip-hop, je n’ai pas envie d’être enfermé là-dedans. En France, on t’enferme un peu trop vite ! Mes derniers livres sont plus électro, jazz… J’ai 38 piges, aussi. C’est une question de génération !
On a l’impression que la nouvelle génération est marquée par un certain déracinement, une mondialisation, une «déterritorialisation littéraire»…
Le déracinement se remarque autant chez les jeunes de banlieue que chez les Blancs, il y a une identité internationale de plus en plus évidente, avec Internet, les nouveaux jobs... Moi, je me suis construit une culture musicale en achetant des vinyles à New York. Maintenant, grâce à Internet, tu as tout en un an, de chez toi. Je ne dis pas que c’était mieux avant, mais cette culture est un puzzle. Tu as mille morceaux sur ton I-Pod, comme dans un buffet all-inclusive. Tu as tout à volonté, tu picores, mais tu n’écoutes rien… De même, on est dans une ville de plus en plus universelle, et pourtant, on se cristallise beaucoup plus sur les différences.
Il y a quand même un creuset…
C’est un creuset consumériste, qu’on retrouve dans les grandes surfaces, qui sont des cathédrales modernes. Il n’y a plus de communion que dans la consommation…Le métissage actuel chez les jeunes est beaucoup plus consumériste. Un jour on mange africain, le lendemain chinois… La télé-réalité a imposé un modèle, tout en créant un vide. C’est une culture globale standard, avec ses petits Jay-Z par intérim qui paradent à Châtelet, habillés en Zara…
Propos recueillis par Erwan Ruty



