
Des blousons noirs aux rappeurs des « tié-quars » : 30 ans de cultures musicales des quartiers
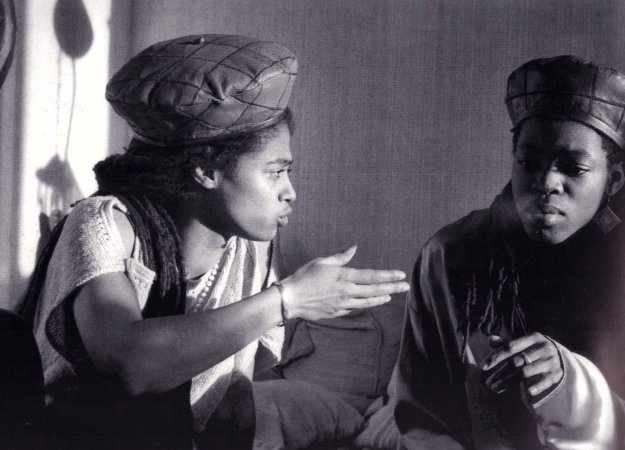
3 décembre 83. Toumi Djaidja et ses acolytes arrivent à Paris, dépeints en véritables rock stars par « Libé », qui met en exergue les riffs de Bob Marley et les volutes de fumée qui les accompagnent. Le « phénomène beur » est monté en épingle par la presse. Les quartiers populaires et les enfants d’immigrés fougueux sortent de l’ombre et ouvrent un nouveau chapitre de la pop culture française.
Zonards et funky
« 83 c’est la sortie de Thriller » rappelle Mouss Amokhrane, du groupe Zebda, formé dans le quartier des Izards à Toulouse. « Dans la culture de quartier, on est à fond dans la musique noire américaine, la funk, la soul, on aime les petits pas de danse funky ». « Barry White et James Brown auraient pu redistribuer des royalties en banlieue renchérit Ali Guessoum, activiste culturel et responsable de l’agence de communication Sans Blanc. On a été des ambassadeurs de la funk en France, j’ai des potes en 82 qui avaient 5000 vinyles chez eux, c’était des encyclopédies vivantes, ce qui ne tombe pas de nulle part : les rythmes afro-berbères sont un peu funk. On a une culture de danse, bien plus que le binaire de la polka ou de la valse. On n’a pas connu le formatage de l’Eglise qui interdisait les rythmes considérés comme diaboliques ».
Au début des années 80, quels que soient leurs origines, les banlieusards se reconnaissent dans l’identité de classe de la périphérie portée par les loubards, les blousons noirs. Ca écoutait du Renaud, se souvient Ali Guessoum. C’était les loubards, les vieux disaient espèce de « blouse noire », pour parler des blousons noirs. On pouvait s’identifier à eux parce que c’étaient des représentants des quartiers, de la zone. A l’époque il n’y avait pas encore de revendication identitaire. Le territoire, c’était la banlieue et la classe, c’était celle de l’ouvrier, du besogneux, du zonard ou de la jeunesse.
Reggae music
Peu après sa mort en 81, Bob est le king dans les quartiers et la richesse musicale du reggae inspire, crée des passerelles entre les genres. « Certains dans le quartier sont connaisseurs et nous font découvrir Steele Pulse, Burning Spear et surtout le raggamuffin ; on se met à toaster, relate Mouss. Les premières fois où Massilia Sound System vient jouer à Toulouse, ils viennent avec un jeune mec qui s’appelle Chill, Akhenaton (…) Avec les Clash, le ska-punk, le fait que certains punks sont très proches des jamaïcains, on s’ouvre au rock. Et puis il y a Carte de séjour ».
Rockeurs, rebelles ou ringards ?
En 1986, le groupe Carte de Séjour du rockeur Rachid Taha joue devant 100 000 personnes à la Concorde et reprend Douce France de Charles Trenet. Le tube agit comme une déflagration dans la société française. Jack Lang distribue le disque à l’Assemblée nationale. « Ça nous a désinhibés, se souvient Ali Guessoum. Le fait d’avoir des ambassadeurs, un côté rebeu rebelle, affirmé, à la mode, ça a été un électrochoc. Pourtant le rockeur rebeu fera relativement peu d’émules dans les quartiers. « Le rap a ringardisé le rock, qui s’est embourgeoisé. Au départ c’était un truc de révolte, après ça s’est installé dans une espèce de confort, l’industrie du disque l’a codifié. La rage est devenue une institution. Alors qu’on était encore libres dans le hip-hop ».
Pour Mouss, dont le groupe a de très nettes influences rock « il y a toujours eu dans les quartiers un ou deux héros qui osent dire « moi je m’en fous, je ne suis pas funky, je suis rock and roll ». Alors que le hip-hop, une culture de danse, sportive, est associé de fait à la culture quartier, dans le rock, il y a un côté ringard, blaireau dans le sport (…) Par contre au début des années 90, à la grande époque du mouvement alternatif [Zebda] va rencontrer un groupe comme la Mano Negra qui va nous impressionner, parce qu’ils sont à la fois rock, mais avec plein d’influences, reggae, latino, même un peu hip-hop. Ils ne sont pas froids dans le style. Ils jouent au foot, ils font danser, bouger, il y a une chaleur. Le rapport au corps, ça joue. Tu peux faire la bringue, mais t’es pas non plus complètement défoncé ».
Back to the roots
86, c’est aussi l’année du premier concert de raï à Bobigny, avec Khaled et Mami. « Avec Raïna Raï, qui a électrifié le raï, c’était ce qu’on écoutait en vacances, un souvenir du bled, avant que ça perce à la télé, c’était écouté par les algériens ou certains branchés », indique Ali Guessoum. « N’oublions pas ce qu’on écoutait à la maison, précise Mouss qui avec son frère Hakim a repris des chansons de l’immigration algérienne dans Origines Contrôlées. C’est notre complexité. Même si je fais du rock ou du ska sur scène, je danse toujours kabyle dessus [un des premiers morceaux de Zebda s’appelle d’ailleurs Mala Diural – A la skabyle », NDLR]. C’est comme ça que j’ai appris à danser dans les mariages, à exprimer quelque chose ».
Eclosion et explosion du rap français
Moins de 10 ans après les premiers tubes hip-hop de Kurtis Blow, Sugarhill Gang et Grandmaster Flash sur des samples de funk, le hip-hop est digéré dans les quartiers. Au début des années 90, Il peut être restitué sur fond social, à travers l’émergence du rap français. « C’est les petits frères de tous ces mômes qui avaient des collections de vinyles de funk qui ont pris le relais derrière les platines quand les groupes de rap ont émergé, explique Ali Guessoum, qui à l’époque réalise des pochettes d’albums de rap. Un courant musical qui va atteindre des sommets qualitatifs dans l’underground avant que son succès ne lui fasse largement dépasser les frontières des quartiers. Au point de devenir la nouvelle variété dans les années 2000. « Dès qu’il a rencontré le succès, le hip-hop a connu exactement la même chose que le rock estime Ali Guessoum. Les chefs de produit des maisons de disque, qui viennent du marketing, se sont dit que les bad boys ou la banlieue sont un bon produit. Les artistes qui faisaient des chroniques sociales et un journalisme des quartiers se sont surtout intéressés à leur ego et aux chaussures qu’ils portaient. C’est devenu un truc libéral où l’individualisme et la frime sont de mise ».
Pour Mouss « le hip-hop n’est pas différent des autres styles musicaux, avec le succès il devient populaire. Une partie des artistes reste puriste et l’autre se tourne plus vers la variété. Le hip hop n’avait aucune raison de rester underground, c’est une culture. C’est une façon d’être, une musique actuelle, une modernité. C’est aussi la preuve que les quartiers existent. Ça aide les jeunes des quartiers d’avoir des musiques qui leur ressemblent. Les quartiers populaires portent depuis toujours les énergies de l’avenir, les modes, les styles qui finissent par être associés à tout le monde ».
Ou comment, de la périphérie, la culture des quartiers a fini par occuper le cœur de la scène culturelle hexagonale.



