
Réseaux sociaux: les citoyens numériques en marche
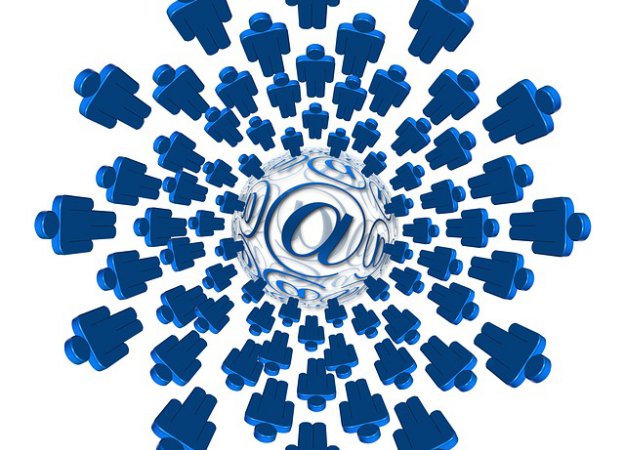
La Manif’ pour Tous, les Bonnets rouges, les Pigeons. Trois mouvements citoyens, trois revendications différentes, et pourtant, il partagent le même point d’origine : le web. En France, Internet est devenu le catalyseur d’une expression, voire d’un engagement citoyen. Retour sur une tendance qui, sans être sans faille, prend beaucoup d’ampleur.
En 2008, David* assiste au match amical de football entre la France et la Tunisie. Cet étudiant en droit d’une vingtaine d’années se rappelle avoir « été outré » par le sifflement de la Marseillaise lors du match. Son mécontentement, il avait décidé de le porter sur le web, en créant la page Facebook « Contre les cons qui sifflent et crachent sur la France ! ». D’abord seul, il est rapidement rejoint par une dizaine de personnes. Puis une cinquantaine. Cinq ans plus tard, la page, toujours active, totalise 282 000 « likes ». Sans le savoir, David venait de mettre les pieds dans l’activisme numérique.
pas besoin d'être un expert pour se faire entendre
Car David, à travers sa page Facebook, ne représente qu’une goutte d’eau dans l’océan de l’activisme numérique. "Mouvement citoyen de Savoie", "Hollande-Dégage": il existe autant de coalitions numériques qu’il y a de courants idéologiques. On dénombre 52,842 « likes » sur la page Facebook « Mouvement citoyen pour la démission de François Hollande ». Le compte Twitter « Hollande-Démission » est suivi par 9 965 abonnés. La clé de ce succès ?
L’effet « mégaphone » de ces médias. « Les réseaux sociaux sont comme une chambre d’écho, pour amplifier la portée d’un engagement. » déclare Christophe Alcantara, enseignant-chercheur en sciences de l’information et de la communication à Toulouse. « Plus des individus sont connectés, plus leur message peut se propager. L’avantage premier, c’est ce que cela exclut toute notion de lieu ou de temps». La simplicité qu’apporte le web aux mouvements citoyens est aussi un atout. « Pour utiliser les réseaux sociaux, il n’y a pas besoin d’avoir une pratique assidue du web, ou d’en être un expert. » poursuit Christophe Alcantara.
Prendre part à la société
La seule prédisposition nécessaire, c’est l’engagement politique. Ou plutôt, le désengagement. « Je ne crois plus en la classe politique, ni en sa capacité d’action » déplore David. « Ma page Facebook rassemble de nombreuses personnes qui, comme moi, n’ont plus foi en la politique et ne se sentent plus écoutés ».
Et selon lui, cette communauté a un réel poids. « La page Facebook de Jean-Luc Mélenchon compte un peu plus de 187 000 likes. La mienne atteint environ 100 000 de plus, sans avoir la même visibilité » assure-t-il, avec un brin de satisfaction. « Cette page me permet de prendre part à la société, de pouvoir exprimer un avis que je ne retrouve pas dans les médias classiques ».
Pour Antoine Dubuquoy, consultant en médias sociaux, les réseaux sociaux répondent aussi à des questions d’exposition.
« D’un point de vue politique, la parole est généralement accaparée par les partis et des personnalités politiques. De ce fait, le peuple n’a pas le droit à la même exposition médiatique. Les réseaux sociaux mettent tous ses utilisateurs sur le même plan. »
Le web, quel echo dans la vie réelle ?
Les « likes » de la page Facebook de David ont-il le même écho dans la vie réelle ? Pas vraiment. « Il faut tempérer l’activité qui en ressort de ces réseaux, selon Christophe Alcantara. Très souvent, on est dans des cas de surréaction, notamment quand une affaire génère du buzz. On l’a vu dans le cas des « sans-dents » qui a pris une grande ampleur en quelques jours. Il faudra voir si cette entité perdure dans le temps, et si elle aura un poids réel ».
Un avis partagé par Antoine Dubuquoy. « C’est facile de liker une page, rejoindre un groupe Facebook, suivre quelqu’un d’influent sur Twitter. Mais cela ne témoigne pas forcément d’un engagement politique». On peut évoquer le slacktivism [activisme paresseux, en anglais] une tendance née aux Etats-Unis. Cela regroupe toutes les actions menées sur le Web (pétitions, groupes,…) mais qui n’ont pas forcément d’écho dans la vie réelle.
En somme, ce n’est pas le web qui fait naître l’activisme, mais il le véhicule. Selon Christophe Alcantara, « les réseaux sociaux ne sont pas une finalité mais un outil. La cause reste au centre du mouvement. Internet ne fait que catalyser un problème. »
* le prénom a été modifié



