
Initiatives
Ressources
Zoom participation : Vu d’ici, quand les habitants d’un quartier prennent la plume

Il faut 20 bonnes minutes de transports pour se rendre du RER Blanc-Mesnil à la maison des Tilleuls. Ce centre social à l’architecture accueillante dénote dans cette cité du Blanc-Mesnil dont il porte le nom. Un grand panneau signalétique vante les mérites du centre commercial du quartier. Mais vu les quelques boutiques qui restent ouvertes, il n’a visiblement pas tenu ses promesses de dynamisme et de proximité. En ce samedi après-midi l’équipe du journal Vu d’ici y partage une galette à l’occasion de la parution d’un énième « dernier numéro ». Dans la salle où se tient la réunion informelle, des gamins du quartier jouent au baby foot, alors qu’une partie de l’équipe, visiblement émue, semble espérer que ce ne sera pas la fin de la publication. Malgré les difficultés financières qui menacent la pérennité du journal, les convives sont très attachés à cet outil d’expression qui a été pendant 5 ans une vraie réussite en termes de participation.
Un contexte d’urgence sociale
La naissance de Vu d’ici est étroitement liée à l’activité du centre social. Zouina Meddour co-directrice éditoriale de la publication en était la directrice de 2002 à 2008. « Il y avait une demande précise de participation des habitants dès l’élaboration du projet de centre social explique-t-elle. Nous avons écouté les habitants. Les premières à s’exprimer étaient les femmes avec des demandes classiques comme la cuisine et la couture. Puis il y a eu une réflexion : pourquoi on vient dans un tel lieu ? Est-ce pour la cuisine ou pour autre chose. Très vite s’est exprimée la question de la stigmatisation et de l’image négative des quartiers populaires ». Ce constat à débouché en 2004 sur un travail sur l’image, notamment celle des femmes rassemblées dans le collectif « Quelques unes d’entre nous », accompagnées par la photographe Joss Dray. Puis très vite un discours accompagnant les images s’avère nécessaire. Plusieurs des femmes qui souhaitent s’exprimer ne sachant pas lire et écrire, Marina Da Silva, journaliste au monde diplomatique, est sollicitée pour les accompagner. Celle-ci constate « un problème de « mal-vie » dans le quartier : un centre commercial sinistré, un enclavement du à des problèmes de transport importants… ». Le travail réalisé donnera lieu à des expositions dans la ville mais aussi à l’étranger (Portugal, Belgique). Alors que l’exposition se trouve à Bruxelles éclatent les révoltes de 2005. « Les révoltes étaient très importantes dans le quartier, se remémore Zouina Meddour. Le gymnase a brûlé, il y a eu une tentative d’incendie à la piscine, une Molotov a été jetée dans le hall de la Maison des tilleuls. L’équipement est resté fermé pendant 2 mois. On a du accompagner la colère, apaiser le climat. Le quartier s’est trouvé sous les feux de la presse du monde entier. D’où la nécessité d’un travail sur le poids des médias ». Choqués par les images véhiculées et par la déformation de leurs propos, les habitants décident dans un premier temps de ne plus répondre aux médias, puis une conférence de presse est organisée pour qu’ils puissent donner leur point de vue sur ce qu’ils vivent. Dans la foulée, le réalisateur Roland Moreau est sollicité pour faire un documentaire sur le ressenti des habitants face aux événements.

Le journal comme véhicule d’expression citoyenne
C’est lors de la projection du film réalisé, Ceci est notre quartier à 93°, suivie d’un débat public sur le rôle des médias, avec notamment Alain Gresh du Monde Diplomatique, qu’est née l’idée du journal. « On avait du mal à couper les habitants qui s’exprimaient explique Zouina Meddour. Alors qu’avec l’écriture la personne qui s’exprime peut aller au bout de son point de vue ».
Un groupe d’une quinzaine d’habitants se réunit pendant trois mois pour élaborer le projet du journal, qui s’oriente vers une formule trimestrielle. Puis intervient une période de recherche de financements et enfin deux mois de formation à l’écriture avec notamment la participation de Denis Sieffert, directeur de la rédaction de l’hebdomadaire Politis.
Le premier numéro de Vu d’ici paraît finalement en novembre 2006. Bien que le point de départ soit le quartier, la publication ne porte pas uniquement sur le local, qui n’est qu’un point de vue (Vu d’ici) : « Le projet est parti des émeutes. C’est un socle. Dans ce contexte, l’idée est de parler du quotidien mais aussi d’avoir un regard sur ce qui se passe dans monde » explique Zouina Meddour.
Pendant un an et demi Marina Da Silva va accompagner le projet en étant sur place à mi-temps. « Ca n’a pas été difficile de trouver des gens pour écrire, ce qui est difficile c’est de sortir le journal en temps et en heure, les contraintes en termes de délai de fabrication et de parution ».
Les rédacteurs du journal ont des profils très variés. Seule une minorité d’entre eux a déjà un rapport à l’écrit. « Il y a eu une minorité de gens à l’aise en écriture explique Marina da Silva. Comme Farid [Taalba] qui écrit des Nouvelles ou Samir [Hadj Blegacem] qui écrit une thèse de sociologie et travaille sur l’analyse des révoltes. Il nous a aidés à partir de 2007 à mettre en place des enquêtes de terrain. La plupart des profils restent quand même des gens qui ont eu peu, voir pas du tout, d’expérience en termes d’écriture. Pour plusieurs femmes du collectif [Quelques une d’entre nous] on a fait une transcription de propos tenus à l’oral. Il n’y a pas eu vraiment de réécriture, mais beaucoup d’allers-retours pour envoyer les gens plus loin dans leur sujet, notamment pour les sujets d’enquête et d’investigation. Il m’est juste arrivé de donner des titres quand les textes n’en avaient pas et de couper certains textes trop longs ».
Albert Mériau est depuis sa retraite président de l’amicale de locataires de France Habitation, qui représente la moitié des logements du quartier. A l’origine du nom du journal et membre du conseil d’administration, il a suivi le projet depuis sa création : « Il y a des personnes qui ont appris à écrire à cette occasion. Moi j’avais déjà l’habitude de par mon action syndicale, j’étais habitué à faire des comptes-rendus. J’ai par exemple interviewé un ancien pour qu’il donne l’histoire du quartier ( ...) Mohamed qui nous a rejoint a une formation syndicale, il écrit comme il parle, en phonétique ».
Tout en s’adaptant à des profils riches mais atypiques pour une rédaction, le journal, avec 14 numéros en 4 ans a pratiquement tenu la périodicité trimestrielle qu’il s’était fixé, et ce, malgré diverses difficultés financières.
Un succès participatif
La participation est, bien entendu, pour ce type de média, le principal critère de succès. Avec plus de 150 contributeurs depuis la création du journal, il est largement rempli. Marina Da Silva en témoigne : « Ce qui nous a surpris tout le temps, même quand la dynamique s’est essoufflée faute de moyens, c’est le nombre de gens qui voulaient écrire et voir leurs textes publiés (…) Le journal a eu un impact important dans la ville, lorsque nous avons mené deux enquêtes sous forme de micros-trottoirs nous avons été surpris par le taux de réponse» . Outre le nombre de contributeurs c’est également leur diversité qui témoigne de ce succès. « Un des points fort du projet c’est la palette très large des contributeurs, explique Zouina Meddour. Il y a une très grande mixité en termes de tranches d’âge, de sociologie. La place des femmes est très importante, notamment quand le collectif des femmes nous a rejoints, le premier groupe étant majoritairement constitué de garçons. »
Un autre des facteurs de ce succès est certainement le format papier qui permet au journal de circuler sur tout le territoire de la ville « Le journal est distribué en mairie, dans les forums culturels, dans les cafés et les autres centres sociaux, relate Marina Da Silva. Le fait qu'il soit au format papier, que les gens se le donnent de la main à la main est très important. Certains on fait la Fête de l’Huma ou des manifestations avec. »
La circulation du journal a fonctionné comme un mode de recrutement atypique en permettant à des citoyens très différents de rentrer en contact avec l’équipe pour y participer. A l’image des collégiens du Collège Descartes, désireux au départ d’obtenir une aide pour la réalisation de leur journal scolaire, ou alors à l’exemple de Sophie Labat assistante sociale dans le quartier : « J’ai notamment participé à des micros-trottoirs dans le quartier. J’ai pu retrouver des techniques d’analyse présentes dans mon travail. J’ai aussi beaucoup appris car Marina est exigeante et attend une rigueur dans le travail. Pour moi c’est essentiel que des médias comme ça existent car beaucoup de clichés sont véhiculés sur les habitants des quartiers populaires, qui sont souvent instrumentalisés et ont rarement la parole ».
Le prix de la liberté
Réaliser un média participatif d’expression citoyenne a un coût malgré le caractère gratuit des contributions. « Au départ nous avons reçu un soutien de la Fondation Abbé Pierre, du Conseil Régional d’Ile de France et de l’Etat à travers le CUCS avec un budget de 30000 euros au total pour payer le maquettiste, la journaliste, l’iconographe et surtout l’impression qui représente la plus grosse part du budget. Nous n’avons pas souhaité toucher à la version papier au profit d’un blog » explique Zouina Meddour.
Sa liberté d’expression, le journal va « la payer »à cause d’un article jugé trop « politique » par certains bailleurs. L’Etat va retirer ses financements suite « à un papier de Mustapha sur l’affaire des badges mettant en cause le préfet, relate Zouina Meddour. Heureusement nous avons été soutenu Par Hervé Bramy, Président de la maison des Tilleuls et Président du Conseil général à l’époque».
Alors qu’il a été reproché à l’équipe d’avoir des accointances avec le PC ou encore d’écrire des papiers à la place des participants ( !), Marina Da Silva revendique à la fois un point de vue et un fonctionnement démocratique : « C’est une démarche collective, nous échangeons beaucoup, même s’ il y a une ligne éditoriale, c’est un espace ouvert à d’autres éclairages. Nos points de vue ne sont pas si homogènes que ça, sur la question de la sécurité par exemple. Nous avons des bagages politiques différents, mais il y a une unanimité sur la stigmatisation du quartier. Parler aussi de ce qui est beau dans le quartier fait partie du positionnement comme le fait d’assumer le terme de révolte en refusant le terme émeute. »
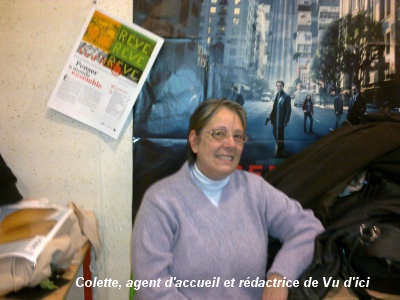
Quelles perspectives ?
« Ce qui est sûr, c’est qu’il faut au minimum 15000 euros pour 3 numéros, là on n’a plus rien et pas de perspectives, regrette la rédactrice en chef. C’est un budget trop important pour une maison de quartier mais pas pour une ville ».
Zouina Meddour, qui a pris du recul par rapport au projet, continue de le suivre de manière plus espacée. C’est au tour d’Olivier Canzillon, directeur de la Maison des Tilleuls depuis 2008 de prendre la relève.
Bien que le projet n’ait pas entrainé de vocation professionnelle, il a modifié le rapport à l’écrit et donc au monde, d’un grand nombre de participants. A l’image de Colette Bonin, chargée d’accueil : « J’ai d’abord intégré l’atelier d’écriture lié au collectif des femmes. J’ai écrit mon premier article pour le journal avec retenue en me disant que je ne savais pas écrire. Pouvoir être lue et que ce soit compréhensible m’a donné de l’assurance. On a tous eu besoin de raconter ce qu’on avait ressenti en 2005. En faisant des micros-trottoirs j’ai rencontré des gens intéressants que je n’aurais jamais rencontrés sans le journal. Ecrire sur mon métier d’hôtesse d’accueil a suscité des vocations chez les jeunes. Ce n’est pas parce qu’on n’a pas un savoir précis qu’on ne peut pas écrire, c’est à la portée de tout le monde. ». L’équipe ne demande qu’à retrouver des financements pour permettre à d’autres habitants, à l’instar de Colette, de s’émanciper à travers l’écriture.
Y.T.
