
Fight club médiatique
Ressources
Enquête « Banlieue de la République » : quel traitement médiatique ?
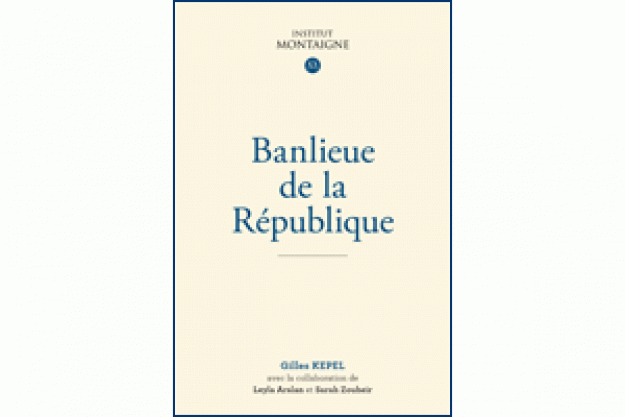
Peut-on concilier le temps long de la recherche et le temps court médiatique ? Un début de polémique est né suite à la publication de l’enquête « banlieue de la République » réalisée par l’institut Montaigne à Clichy-Montfermeil, certains médias ayant fait le choix de mettre en relief la question de l’islam. Celle-ci ne représente pourtant qu’une partie du travail des chercheurs sous la direction de Gilles Kepel .
Leyla Arslan, docteure en sciences politiques, auteure de « Enfants d'Islam et de Marianne » et chargée d’étude à l’institut Montaigne a participé à l’enquête. En réaction au titre du Monde « Banlieues, islam : l'enquête qui dérange » et au buzz médiatique suscité, elle a écrit une tribune intitulée « L’Islam est un marqueur d’intégration » dans le quotidien du soir. Une volonté de recadrer l’interprétation de l’enquête par des journalistes un peu trop hâtifs, en quête de sensationnel ? Pour la chercheuse « Tous les médias n’ont pas eu le même angle. Dans la presse « chaude » il y eu un traitement rapide, une version restrictive de la manchette du monde, celle de l’opposition Islam contre république, sans restituer l’enquête dans sa réalité. (…) Dès le deuxième jour il y a eu un traitement plus social, notamment une double page dans Libération reprenant chaque chapitre de l’enquête -sauf le chapitre « politique »- ce qu’on regrette. On a également fait des chats de presse pour recadrer, en passant à chaque fois le message que l’enquête ne porte pas juste sur le religieux qui ne représente qu’une partie du rapport, qui arrive d’ailleurs en bout de chaîne. »
Du religieux au social
A la décharge des médias un peu trop pressés de tenir une « preuve » de « l’islamisation » des quartiers en négligeant les autres aspects de l’enquête, quelques circonstances atténuantes : La plus grande partie de l’équipe de chercheurs, son directeur Gilles Kepel en tête, est constituée de spécialistes des questions liées à l’Islam. Par ailleurs le titre de l’enquête ne renvoie-t-il pas à celui de l’ouvrage de Gilles Kepel « Les banlieues de l’Islam » publié en 1985 ? « Au début ça a été pensé comme ça, explique Leyla Arslan. Quand l’Institut Montaigne a fait appel à Gilles Kepel la première reflexion était : « Que s’est-il passé depuis « Les Banlieues de l’Islam » ? Mais les autres chapitres ont pris davantage de place. On aurait pu s’attendre effectivement à ça –Une prédominance de la question religieuse NDLR-vu le profil des chercheurs, mais le discours est autre, il porte sur le social, le politique, l’éducation. C’est d’autant plus marquant que ça vienne de spécialistes du religieux. » Le fait que ces spécialistes du religieux aient progressivement privilégié les facteurs politiques économiques et sociaux ne montre-t-il pas que le poids de l’Islam dans le rapport à la République est souvent surestimé? Dans sa thèse Leyla Arslan défend d’ailleurs que c’est plutôt les parcours sociaux qui influent sur l’expression du religieux et de l’ethnicité.
A défaut donc de faire monter d’un cran la méfiance vis-à-vis de la religion musulmane quels sont les nouveaux éléments de réflexion amenés par ce travail de recherche ? « Le côté plutôt nouveau est de parler des quartiers quand il n’y a pas d’émeutes et de poser les choses de façon globale. L’aspect politique ne concerne pas que la politique de la ville sous l’aspect rénovation urbaine comme c’est souvent le cas. L’enquête restitue des enjeux et des problématiques à travers la parole des habitants. Ce n’est pas un rapport d’évaluation des politiques publiques comme on peu en trouver dans la Documentation française ou dans les rapports de l’ANRU. L’idée est de restituer la parole des habitants, leurs représentations, apporter de l’humain (…) Il y a des termes qui reviennent instinctivement dans le vocabulaire journalistique que nous n’avons pas utilisé, comme le terme ghetto. Sur le terrain nous n’avons pas eu à faire à des gens qui se construisent de façon fermée, les gens sont demandeurs de République, de mobilité géographique, ce n’est pas que des jeunes à casquette qui tiennent les murs. L’idée est de donner à voir une image des quartiers plus complexe».
Creuser le local pour penser le global ?
Autre confusion à ne pas faire : prendre la partie pour la globalité. L’enquête porte en effet sur les territoires de Clichy et Montfermeil, d’où sont parties les émeutes de 2005, des lieux « emblématiques », mais pas forcément représentatifs des banlieues françaises. « L’idée était de prendre un territoire plutôt qu’un échantillon au niveau national, précise la chercheuse. Cela permet de pousser à bout un certain nombre de problématiques. Il y a bien sûr des particularités ; à Clichy la question du trafic de drogue est moins importante qu’à Sevran. Le fait de se focaliser sur un aussi petit territoire permet une approche transversale plutôt qu’un traitement segmenté. Cela permet de creuser plus profondément les questions identitaires, religieuses, d’éducation. »
Pour se faire sa propre idée, la meilleure option reste de lire l’enquête ou a défaut son résumé.
Yannis Tsikalakis
http://www.banlieue-de-la-republique.fr
