
Les 10 leçons sur l’empowerment de Marie-Hélène Bacqué
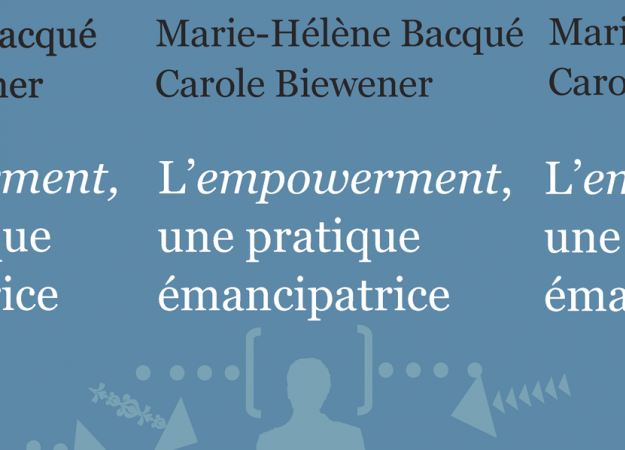
Sociologue spécialiste des quartiers, la nouvelle coresponsable de la mission sur la participation des habitants confiée par le ministre de la Ville François Lamy, publie avec Carole Biewener un opuscule dédié à ce nouveau fétiche venu d’outre-atlantique, l’empowerment. Pour réveiller la démocratie locale, participative, communautaire ? On en rêve, mais on peine à y croire. Résumé en 10 points.
Un concept américain
Comme tout ce qui brille, qui fait de la mousse et qui fait courir les médias, l'empowerment est une invention américaine, remontant aux années 1970. Elle est apparue à la lisière du monde de l'action sociale (pratique) et de l'université (théorisation) ; témoignant une fois de plus de l'extrême rapidité avec laquelle l'intelligentsia états-unienne parvient à tirer des enseignements des expériences de terrain.
Un concept qui fut radical
L'empowerment est un processus par lequel des individus vont se responsabiliser et se doter d'une conscience sociale, qui peut devenir collective, leur permettant de s'émanciper et de développer des capacités d'action pour se prendre en charge eux-mêmes, et changer leur environnement. Ainsi, il s'agit, par exemple dans le domaine de la santé, de faire des usagers les premiers moteurs de leur propre guérison, et non plus des malades passifs (technique en particulier utilisée par Act up dans la lutte contre le Sida, les séropositifs agissant à égalité avec le pouvoir médical et non plus comme de simples patients). Emancipation individuelle et transformation sociale, collective, donc.
L’empowerment à usage des féministes et des minorités Noires
C'est d'abord dans le milieu féministe que ce concept est né (lutte contre les violences sexuelles et sexistes). Puis dans les communautés Noires (lutte contre les discriminations). Il s'agit donc de techniques ayant émergé dans les marges, les minorités, chez les « subalternes » (Violence against women et Mouvement des droits civiques).
Internationalisation de l’empowerment
Le concept connaîtra un succès particulier dans les pays du Tiers-monde (devenus plus tard « émergents »), notamment en Inde, où des programmes d'aides aux paysans pauvres sont développés massivement, en particulier au profit des femmes dans le domaine du micro-crédit (ainsi, en 2011, 97% des prêts accordés par la Grameen Bank le sont au bénéfice de femmes -soit 8,4 millions d'emprunteuses). Il s'agit en l'occurrence de favoriser l'éducation, pour « lutter contre les sources de subordination », « rompre l'isolement, le manque de confiance en soi, l'oppression exercée par certaines coutumes ». De « donner aux femmes des espaces de partage de leurs expériences ».
L’empowerment à la sauce néolibérale
« Mais sans tenir compte des rapports structurels d'inégalité et en considérant leurs choix comme des actions rationnelles, [la volonté de responsabiliser] consiste à renvoyer aux seuls individus la responsabilité morale de leur situation » notent les auteures.
Ainsi, lentement, après l'apogée puis le déclin des mouvements contestataires, le durcissement de la critique de l'Etat, et l'émergence du néolibéralisme (Reagan, Thatcher) ainsi que des méthodes de management apparues concomitement dans le monde de l'entreprise, le concept change de sens : il s'agit dorénavant de mieux organiser les relations entre les administrations et les usagers (participation des citoyens à la vie publique locale, par exemple). De mieux développer ses capacités d'accès aux « opportunités » qu'offrent les marchés de la consommation, du travail et de la propriété, ainsi qu'aux droits civiques (sans quotas). Le tout afin de « sortir les pauvres de l'assistanat » et de la « logique de la victimisation ». De redonner du pouvoir aux corps intermédiaires (associations, Eglises, familles...). Et enfin de permettre aux individus (et non plus aux collectivités ou aux communautés) d'accéder au « rêve américain ».
Acclimatation française difficile de l'empowerment dans les quartiers
Aux Etats-Unis (comme en France , mais avec trente ans de retard), le concept aurait trouvé un sens nouveau avec la vague libérale et la compression des budgets sociaux. Menée « par en haut », la politique de la ville semble souvent rétrécir le « terrain du changement social à celui de la modernisation de l'action publique », jugent les auteures. Pour résumer, les pouvoirs publics n'ayant plus de sous, ils diraient aux pauvres, exclus et minorités : « débrouillez-vous, prenez-vous en main ». Cette approche paraît en effet émerger, dans les quartiers, en France dans les années 2010 (et même avant, avec l'émergence du concept d'égalité des chances) : on met tout le monde sur la même ligne de départ, en essayant plus ou moins d'aider les plus démunis : ceux qui courent dans le couloir handisport pouvant quand même partir avant les autres. Mais tout le monde doit courir, le meilleur gagner. Les quartiers doivent s'organiser ; c'est un fait. Mais peuvent-ils le faire aussi bien que n'importe quel « Pigeon » entrepreneurial à qui il suffit d'envoyer quels messages rageurs à ses amis Facebook bien placés dans la sphère médiatico-politique pour faire plier un gouvernement dans sa volonté de réforme fiscale ? Quel acteur des quartiers a ce pouvoir ?
A quoi peut servir l’empowerment ?
A développer des contre-pouvoirs à l'usage des minorités, des « subalternes », à l'intérieur ou en marge des organes de représentation (partis, conseils municipaux, parlements...). A remettre une partie du pouvoir d'agir aux mains des collectifs et communautés de base, dans les quartiers. A reconnaître leurs expériences et capacités de création, d'organisation. Mais « mise en oeuvre dans une période d'affaiblissement des formes traditionnelles de structuration du mode ouvrier, [l'empowerment] reste une politique conduite et décidée par le haut, avant tout initiée par des professionnels », notent Marie-Hélène Bacqué et Carole Biewener. Or, le pouvoir ne se donne pas (d'en haut vers le bas). Il se prend. By any means necessary ?



