
Qu'est-ce qu'être de droite, de gauche? Entretien avec Henri Rey
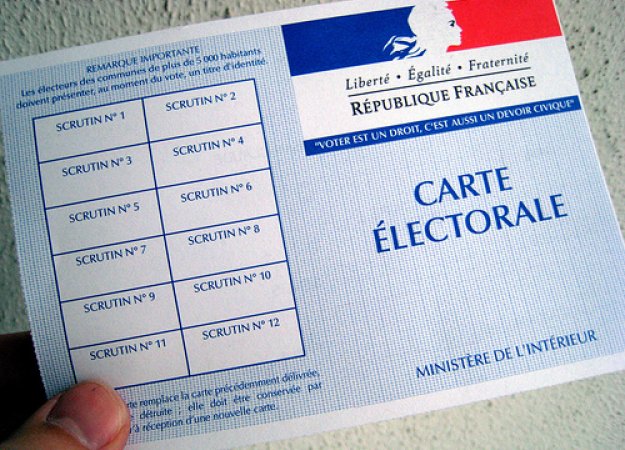
« Ni gauche ni droite », « Tous pareils ! » voire « tous pourris ! » Des réflexions courantes dans les quartiers de France. Au comptoir, mais pas seulement. A se demander si le vieux clivage qui balise notre vie politique a toujours du sens. D’autres pousseront même le raisonnement, se demanderont s’il en a jamais eu. Direction Sciences Po. Ou plus précisément le CEVIPOF. Henri Rey y est directeur de recherche, spécialiste des comportements politiques dans les périphéries urbaines.
Est-ce qu’il y a des valeurs propres à la droite et des valeurs propres à la gauche qui permettent aux gens de se définir par rapport à ce clivage ?
Il faudrait plutôt employer le pluriel. Les droites, les gauches. Il y a à la fois des intersections et des différences pérennes entre les deux. A l'origine c'était la place occupée à l'assemblée pendant la révolution française par ceux qui étaient pour le droit de véto du roi et ceux qui étaient contre. Vous avez un paradoxe aujourd‘hui. Beaucoup de gens vont vous dire « gauche, droite c'est pareil, ils font tous la même chose ». Ils parlent là des partis et des hommes politiques, des gouvernements. Pas des valeurs de leurs sympathisants. Car si vous leur demandez de se situer sur un axe gauche-droite, Il n'y a jamais eu autant de gens capables de le faire. Ca veut dire qu'il y a un repère très profondément ancré dans les représentations des citoyens, qui savent où « se mettre ». Plus qu'il y a 20 ou 30 ans.
Est-ce que la répartition des valeurs n’a pas évolué au fil du temps ? La volonté d'un Etat très présent a-t-elle toujours été de gauche ?
On en revient à cette notion plurielle des deux gauches. La première de tradition étatiste, jacobine, a un côté autoritaire et pense que l'Etat doit jouer un rôle important, y compris dans l'économie. Puis il y a la deuxième, représentée par Michel Rocard ou la CFDT, qui met l'accent sur la société civile. Elle réintroduit des notions libérales dont la droite s'est faite le champion contre la gauche interventionniste. Et à droite, la fusion des deux familles que sont les gaullistes, étatistes, qui se veulent au-dessus des clivages, et de la droite libérale ne marche pas si bien que ça. La particularité française de la prééminence du président et du scrutin à deux tours entraîne une bipolarisation. Ce qui pérennise des notions de droite et de gauche dont le contenu est devenu parfois vide ou superposé. Vous avez quand même malgré ça un certain nombre de valeurs qui distinguent encore droite et gauche. Quels que soient les discours, on assigne l’autorité, la sécurité, aux hommes politiques de droite. Alors même que des hommes politiques de la gauche, comme Chevènement ou Jospin, ont fait des efforts pour que ça ne soit plus discriminant. On voit que François Hollande dit qu'il créera des postes de gendarmes et de policiers. Malgré ce chemin parcouru par la gauche, on lui reproche toujours d'être angélique. On oublie que quand le parti communiste était encore fort il y avait un contrôle social, ou du moins un encadrement social, dans les milieux populaires.
Traditionnellement l’ouverture aux autres, la tolérance au niveau des mœurs, ce sont quand même plutôt des valeurs de gauche ?
Le libéralisme culturel, la permissivité, sont assez bien reliés au vote de gauche. Les électeurs soucieux des questions du genre, favorables au mariage homosexuel ou à l’homoparentalité sont plus ceux de la gauche que ceux du centre droit et bien évidemment de l’extrême droite. Ce qui ne veut pas dire qu’on ne retrouve pas ce libéralisme dans les élites des partis du centre droit et de la droite. Même si vous prenez le Front National, le style Marine Le Pen par exemple, qui se présente comme une femme divorcée, libre, qui ne vit pas avec son compagnon, ce n’est pas l'image « famille, patrie », l'aspect famille est un peu dégagé. A l’inverse, je me souviens de la position de cette gauche un peu « raide » sur la question par exemple de l'avortement. Jeannette Vermeersh-Thorez, la femme du grand dirigeant communiste Maurice Thorez, disait qu'on n'a pas à imiter les mœurs des femmes bourgeoises. Il y avait une forme de réticence à tout ce qui était pilule, contraception, libéralisme des mœurs.Il y a eu une évolution depuis, mais on voit qu’on n’a pas d’un côté toutes les libertés et de l’autre toutes les contraintes.
Les quartiers populaires votent majoritairement à gauche alors qu’on attribue des valeurs plutôt traditionnelles (famille, religion, autorité, traditions…) aux populations issues de l'immigration récente. Ces votes n'ont-ils pas été perdus par la droite libérale en essayant de séduire la droite protestataire ?
Il y a bien-sûr une très grande dissuasion du discours xénophobe, du Front National et de tout ce qui paraît dialoguer sur le même registre. Mais ces valeurs d’attachement à des structures familiales ou à la religion, qui peuvent apparaître un peu décalées dans une société sécularisée, ne sont pas à regarder de manière univoque. Elles ne sont pas nécessairement vues de manière antagonique avec les valeurs de la gauche. Elles sont réinterprétées dans un autre sens. Il est possible que ces valeurs soient plus lues sur un mode de solidarité que sur un mode de contrainte d’un héritage. Surtout dans ces périodes et dans ces territoires où le chômage est très développé.
Aujourd'hui on à une droite souverainiste et une droite mondialiste, avec un peu l'équivalent à gauche. Est-ce que ce clivage n'est pas aussi important que le clivage gauche / droite ?
C'est une vraie question, de savoir si le clivage ouvert/fermé est en train de se substituer à celui de gauche ou droite. En vérité les deux existent, il n'y a pas substitution de l'un par l'autre. Il y a une vraie interrogation sur l'identité politique : où est l'Etat, où est la Nation dans ce partage entre le niveau local qui a pris de l'importance avec la décentralisation, le niveau européen qui est flou et le niveau national qui est faible. Où va-t-on? D’où le développement de l’idée d'un retour aux frontières. On l'a plus entendu du côté du Front National, mais aussi un peu sous la forme du protectionnisme européen proposé par Arnaud de Montebourg lors des primaires socialistes. On l'a entendu plus fort encore avec Mélenchon dans la campagne des présidentielles. Ca existe à gauche comme à droite, puisque il y a ce trouble.
Est-ce qu’on peut penser que l’opposition droite-gauche perdurera tant que se posera la question de la répartition des richesses ?
On annonce toujours la fin de ce clivage mais ça reste un repère important. Le « ni gauche ni droite » qu’on entend correspond à un rejet des partis. En termes de valeurs, la gauche est toujours plus rattachée à des notions de solidarité, de tolérance. Et la droite c'est davantage l'autorité, l'efficacité économique. On est dans cette idée que si on veut réussir il faut donner de soi-même, être volontaire. La répartition des richesses reste une question essentielle. L’ « indignation » est un haut le cœur quand pendant que certains sont dans les pires difficultés, d'autres exagèrent dans l'appropriation des richesses. On voit bien que ces notions de justice, d'égalité sont fortes. Elles vont s'illustrer dans des mesures concrètes de fiscalité, dans la répartition du logement social entre les villes, dans la question de poursuivre ou pas la politique de rénovation urbaine. On en a fait la moitié, est-ce que l'autre moitié va être financée?
Propos recueillis par Yannis Tsikalakis
Rey Henri, Démocratie participative et gestion de proximité Paris, La Découverte, 2005.
Rey Henri, La gauche et les classes populaires, Paris, La Découverte, 2004.



